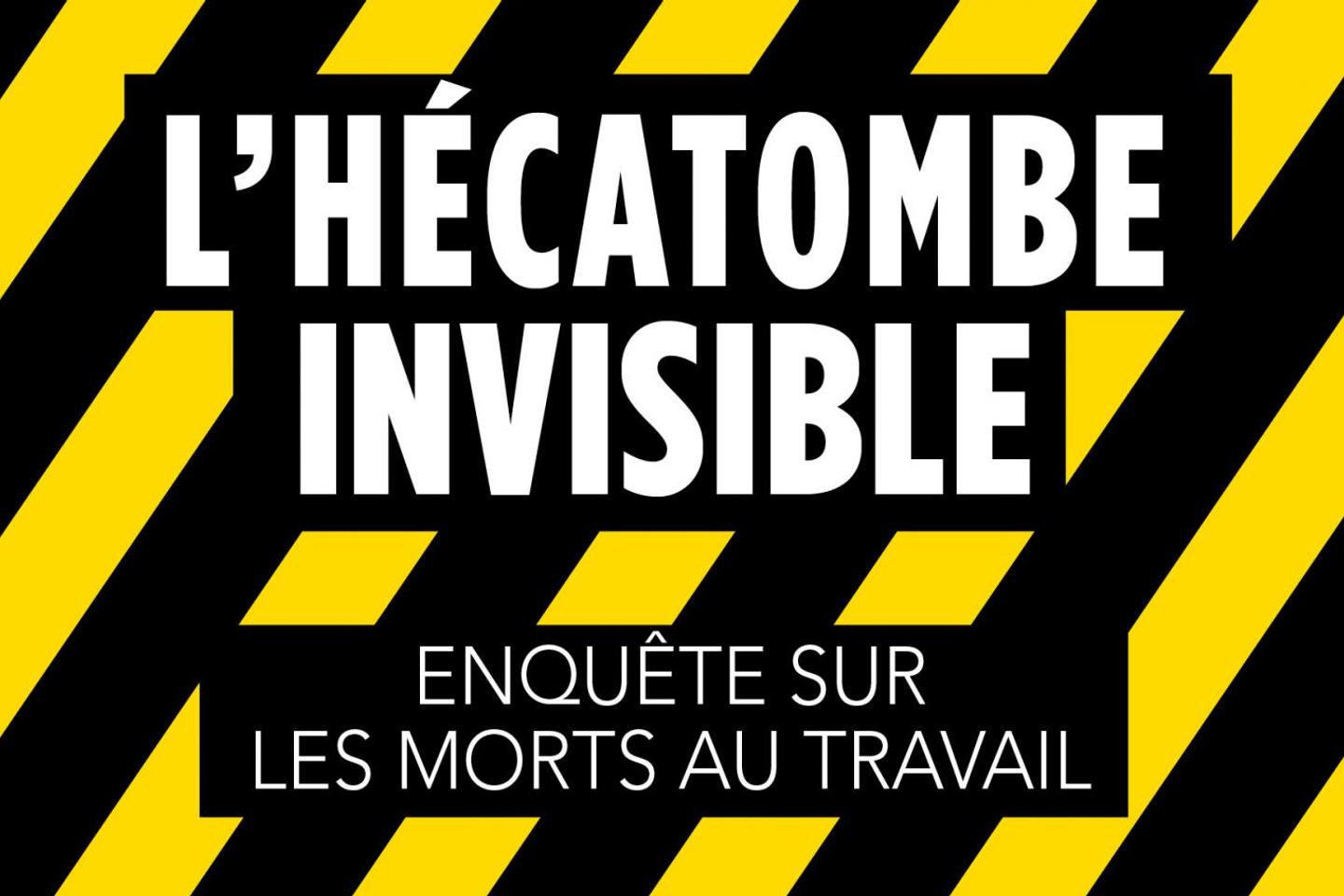Réforme des retraites : le dispositif sur les « carrières longues » ne profite pas aux travailleurs les plus éprouvés

Voilà deux notes que l’exécutif et les parlementaires auront en tête au moment des arbitrages sur la réforme des retraites. Publiées lundi 6 mars par l’Institut des politiques publiques, elles montrent que le système dit des « carrières longues », réservé aux personnes ayant commencé à travailler tôt, ne profite pas principalement à celles qui sont les moins qualifiées ou les plus abîmées par leur emploi. Allant à rebours des idées reçues, un tel constat est susceptible d’influencer des choix à venir, puisque le gouvernement – aiguillonné par des députés de droite – envisage d’étendre le dispositif, selon des modalités incertaines à ce stade.
Créé en 2003, rendu plus généreux en 2012, le mécanisme des carrières longues permet de partir à la retraite avant l’âge légal – soit 62 ans, aujourd’hui. Pour bénéficier de cette dérogation, il faut avoir commencé sa vie active avant 20 ans et afficher une « durée d’assurance » au moins égale à celle qui est requise pour une pension à taux plein (quarante-trois ans, à terme). Ces règles ont un impact significatif : pour la génération née en 1953, par exemple, elles ont offert la possibilité d’un départ anticipé dans près d’un cas sur quatre, si l’on raisonne sur le régime général.
Ce corpus de normes « est souvent vu comme touchant des personnes peu diplômées (…), ayant plus souvent exercé des métiers manuels » ou physiquement éprouvants, écrit Patrick Aubert, l’auteur des études. Or, le lien entre la pénibilité professionnelle et le fait d’être éligible au dispositif n’est « pas aussi évident qu’il n’y paraît ».
Ceux qui ont eu droit à une retraite avant 62 ans « pour carrière longue » ont « une espérance de vie égale, voire supérieure à celle des autres retraités non invalides ». Ils semblent aussi « moins souvent en situation de handicap ». Ainsi, parmi les individus qui sont partis à 60 ans ou à 61 ans durant la période 2017-2020, 5 % disent avoir été fortement limités dans leurs activités au cours des douze premiers mois de retraite et 10 % déclarent avoir été « limités mais pas fortement » (contre 7 % et 16 % chez ceux qui sont partis à 62 ou 63 ans, « hors invalidité ou handicap »).
« Trous de carrière »
Si l’on s’intéresse aux catégories sociales, l’étude montre que les ouvriers et les employés non qualifiés sont « nettement sous-représentés » dans les départs anticipés. De même, seuls 2 % des bénéficiaires du système de carrières longues font partie des retraités les plus modestes, s’agissant de la génération 1954.
Il vous reste 19.19% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.