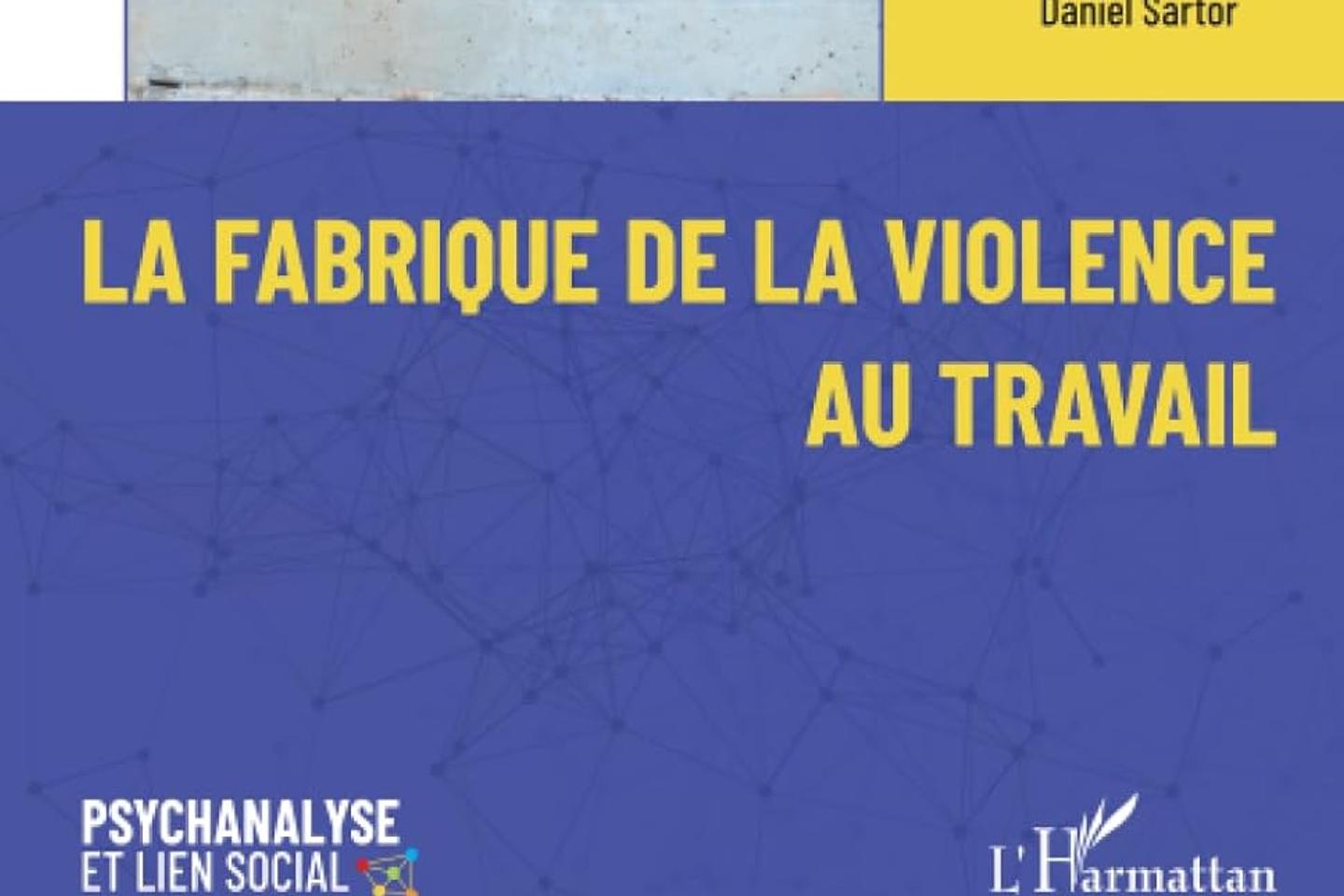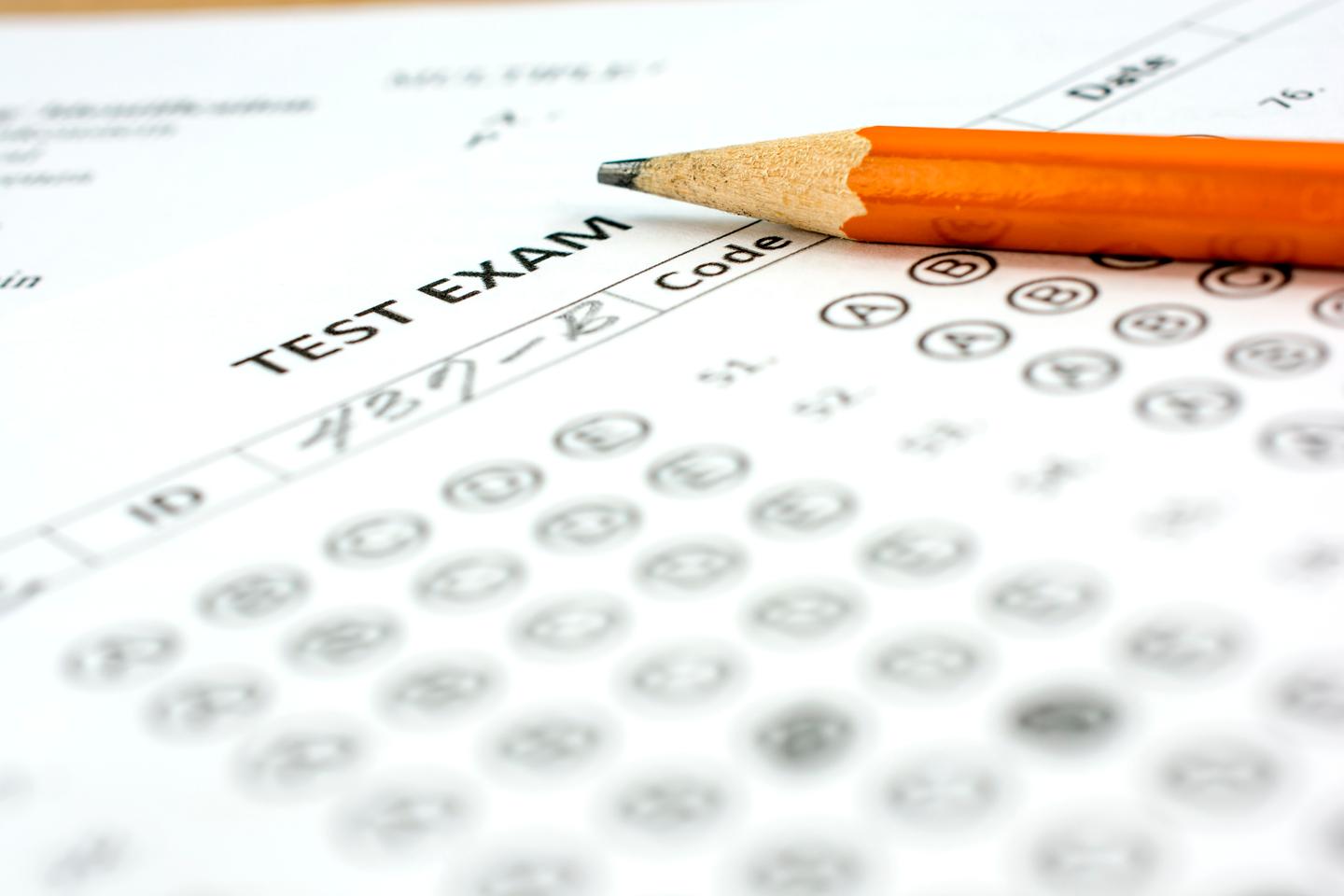Appel à témoignages : salariés, fonctionnaires, comment vivez-vous les épisodes de fortes chaleurs sur votre lieu de travail ? Racontez-nous

La Société éditrice du Monde souhaite présenter dans ses publications une sélection de témoignages, sous forme d’écrits, de photographies et de vidéos (ci-après désignés ensemble ou séparément « Contribution(s) ») qui lui sont soumis librement par les internautes.
Contenu de la Contribution
Votre Contribution doit respecter la législation en vigueur, notamment la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les articles 9 et 9-1 du code civil sur le droit à la vie privée et au respect de la présomption d’innocence et les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Aucune Contribution contraire à la loi ne pourra être publiée.
Une orthographe et une mise en forme soignées sont exigées (pas de textes en lettres capitales, pas d’abréviations ou d’écrits de type « SMS »).
Vous devez être l’auteur des textes, photographies et vidéos que vous proposez dans le cadre de votre Contribution, ou avoir l’autorisation de leur auteur pour leur publication dans les conditions ici définies. Le nom de l’auteur doit toujours être mentionné, de même que la date et le lieu où ont été pris vos documents photographiques ou vidéo et rédiger une légende descriptive.
Votre Contribution doit être signée de vos prénom et nom. Les demandes d’anonymat en cas de publication seront examinées par la rédaction de la Société éditrice du Monde au cas par cas.
La Société éditrice du Monde se réserve le droit de refuser toute Contribution, ou d’effacer toute Contribution préalablement publiée, pour quelque cause que ce soit, notamment si :
- elle est contraire à la loi (racisme, appel à la violence ou à la haine, diffamation, pornographie, pédophilie, sexisme, homophobie, …).
- elle est contraire aux règles de conduite du Monde.fr et des autres publications concernées (mauvaise orthographe, propos non conforme au sujet demandé, forme peu soignée, …).
- son sujet ou sa forme présente peu d’intérêt pour les lecteurs, la Société éditrice du Monde étant seule décisionnaire à ce titre.
- elle a déjà été proposée et publiée ou elle est similaire à un témoignage récemment publié.
- elle contient la représentation ou la désignation d’une personne physique pouvant être identifiée, en particulier une personne mineure.
- elle contient la représentation d’une œuvre pouvant relever du droit d’auteur d’un tiers sans l’autorisation de celui-ci.
- elle contient des photographies ou vidéos dont la qualité technique est insuffisante (photos floues, vidéos illisibles ou de mauvaise définition, bande son inaudible, …), la Société éditrice du Monde étant seule décisionnaire à ce titre.
Règles applicables à la Contribution
En participant à cet appel à témoignages, vous autorisez la publication totale ou partielle de votre Contribution sur le site Le Monde.fr, dans le quotidien Le Monde, dans M le Magazine du Monde et/ou sur toute autre publication ou site où la Société éditrice du Monde publie du contenu éditorial (Facebook, Twitter, Digiteka, Instagram, etc., dans le monde entier, pour la durée d’exploitation de la publication concernée.
La Société éditrice du Monde est libre de publier ou non les Contributions qui lui sont proposées.
Votre réponse à l’appel à témoignages, ainsi que votre autorisation pour l’exploitation éventuelle de votre Contribution, sont accordées à titre gracieux et ne peuvent donner lieu à une quelconque rétribution ou gratification ou versement de quelque nature que ce soit, à quelque titre que ce soit.
Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Société éditrice du Monde, et communiquées aux seuls journalistes à l’origine de l’appel à témoignage et aux équipes techniques en charge de la gestion du traitement.
Elles ne seront utilisées que dans le cadre de cet appel à témoignages. Les données associées à une Contribution sont conservées pour une durée maximale de deux ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données, retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter dpo@groupelemonde.fr
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.