« (In)volontaires aux JO » : derrière l’appel aux bénévoles, la suspicion d’un « travail dissimulé »
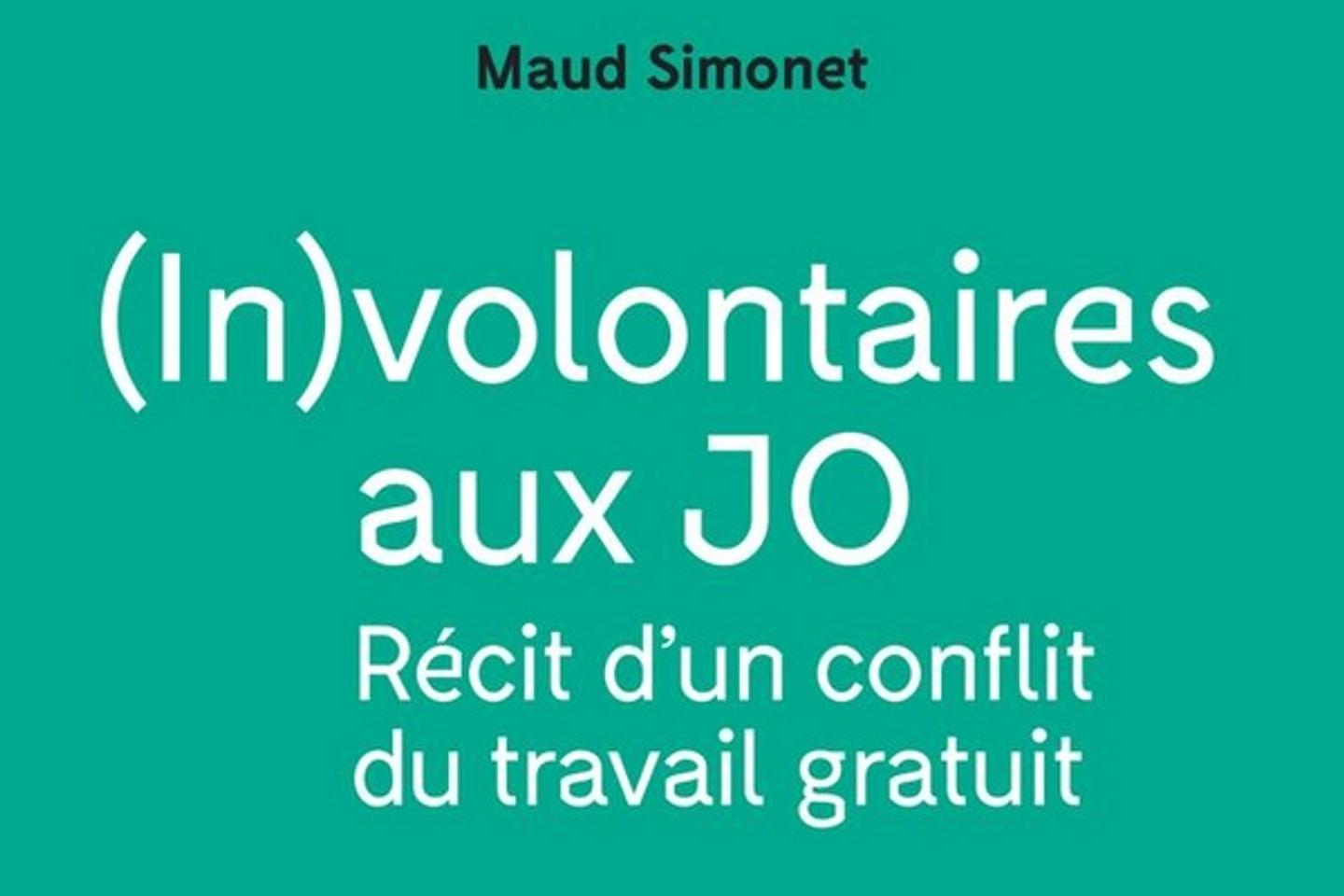
Au printemps 2023, plus d’un an avant les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris, un collectif écologiste décide de jouer les trouble-fêtes. Saccage 2024, c’est son nom, tente d’alerter l’opinion sur les « effets sociaux et environnementaux délétères de l’événement ». Ses membres estiment, en particulier, que l’appel massif aux volontaires – 45 000 seront recrutés par le comité d’organisation, le Cojop, et 5 000 par la Ville de Paris – s’apparente à du « travail dissimulé ». Quelques mois plus tard, des inspecteurs du travail leur feront écho en dénonçant le « non-respect du droit du travail » par l’Etat.
De quoi ternir l’image des JOP ? Ce ne sera pas le cas. La contestation portée par Saccage 2024 ne débouchera que sur la démission d’un petit nombre d’« (in)volontaires » durant l’événement. Aucun d’entre eux ne décidera de porter l’affaire en justice pour demander la requalification du « faux bénévolat » en contrat de travail. Dans leur immense majorité, les bénévoles des JOP garderont un excellent souvenir de l’expérience accomplie, et la France célébrera avec ferveur sa « parenthèse enchantée ».
Reste toutefois, à travers les critiques émises, une petite musique dissonante qui pousse à s’interroger sur les frontières juridiques entre bénévolat et travail salarié. Une petite musique arrivée aux oreilles de la sociologue Maud Simonet, qui décide de mener l’enquête auprès d’acteurs de cette mobilisation, mais aussi de volontaires et de salariés des JOP. C’est ce « récit (…) moins consensuel » de l’été olympique français qu’elle délivre à travers l’essai (In)volontaires aux JO (Textuel, 192 pages, 18,90 euros).
« Travail de l’amour »
Au fil des pages, l’autrice souligne les « indices de subordination » permettant de démontrer l’existence d’une relation de travail – et, par là même, d’un « déni de salariat ». Elle met ainsi en lumière que le choix des tâches à accomplir, des sites d’affectation, mais aussi les horaires de travail ont été imposés aux volontaires. De même, les missions se sont inscrites dans « une ligne hiérarchique (…) très descendante ». Le « caractère essentiel » de l’apport des volontaires à l’événement est largement souligné. « Ce qu’on a senti, c’est que ça [ne] pouvait pas se faire sans les volontaires. C’est une main-d’œuvre gigantesque », juge ainsi l’un d’eux. Enfin, « le fait que des salariés et des volontaires aient pu être assignés aux mêmes tâches » confirmera la porosité des sphères du bénévolat et du travail rémunéré.
Il vous reste 35.27% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.







