« Les prédictions pessimistes sur les conséquences de l’automatisation par l’IA sur le marché du travail ne sont pas nouvelles »
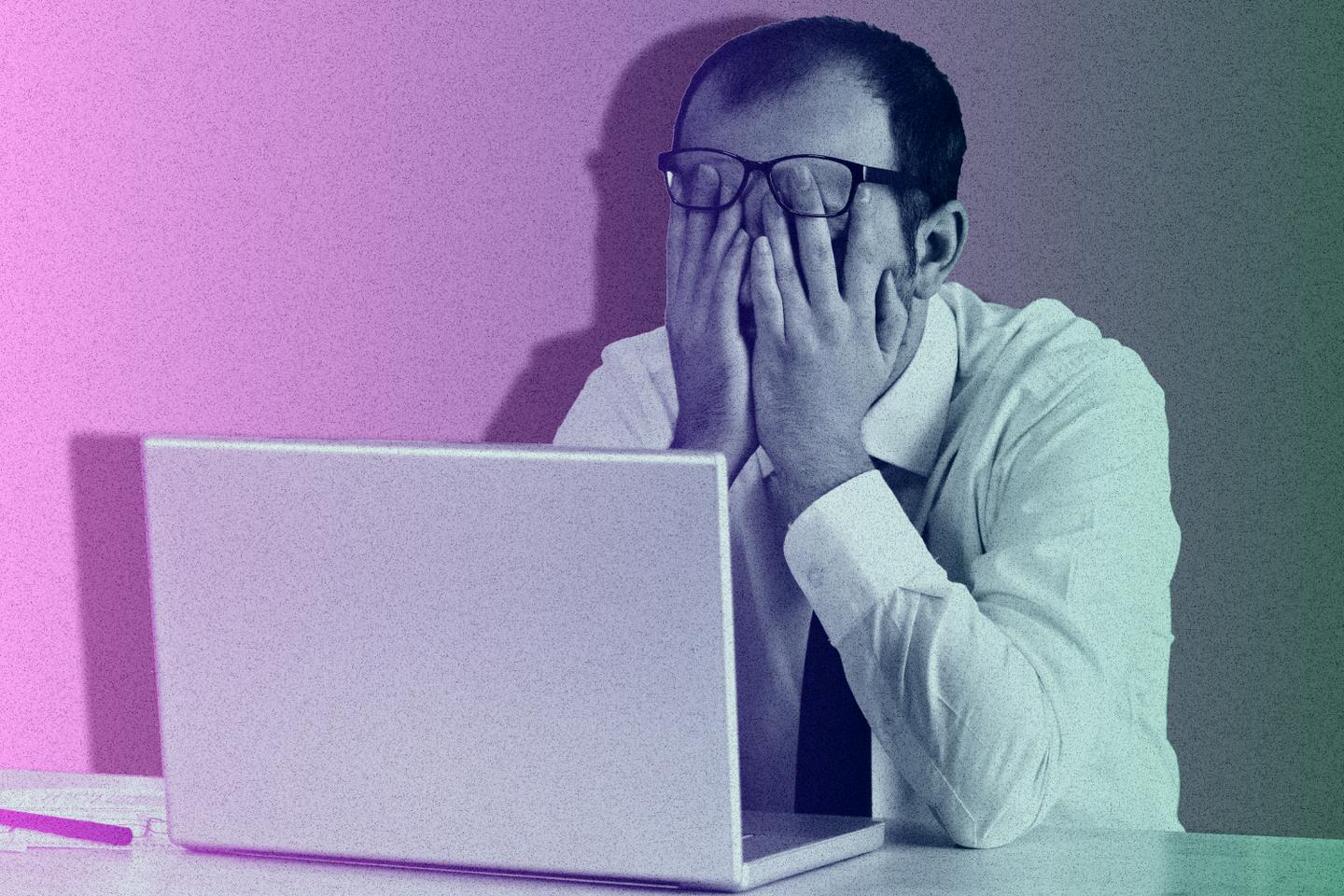
Cela fait presque dix ans que, dans un discours resté célèbre, Geoffrey Hinton, un des pères de l’intelligence artificielle (IA) moderne et Prix Nobel de physique 2024 pour ses travaux dans ce domaine, déclarait qu’il était urgent de ne plus former de radiologues. Vu les progrès fulgurants de l’IA dans la reconnaissance d’image, il était, selon lui, « parfaitement évident » qu’elle dépasserait dans les cinq ans les capacités humaines dans ce domaine et rendrait les radiologues obsolètes.
Aujourd’hui, motivés par la volonté d’entretenir la frénésie actuelle d’investissements dans ce secteur, les dirigeants des nouveaux géants de l’IA sont aussi friands de prophéties fracassantes. En janvier, Dario Amodei, PDG d’Anthropic, à l’origine du chatbot Claude, dont l’entreprise est actuellement valorisée à 350 milliards de dollars (environ 300 milliards d’euros), a publié un long texte dans lequel il prédit que l’IA remplacera la moitié des emplois de cols blancs débutants à un horizon de cinq ans. Plus fort, Mustafa Suleyman, directeur de l’IA à Microsoft, affirmait, début février, que l’IA remplacerait, d’ici à dix-huit mois, la plupart des tâches des cols blancs.
S’il est trop tôt pour savoir si ces deux derniers auront raison, il est clair que la prédiction de Geoffrey Hinton sur les radiologues a mal vieilli. Ces médecins n’ont pas disparu, mais sont aujourd’hui aux Etats-Unis, pays où les hôpitaux utilisent le plus l’IA, la troisième spécialité médicale la mieux rémunérée. Depuis dix ans, leur nombre a même augmenté de plus de 17 %, ce qui n’a pas suffi à combler une forte demande. En témoigne un article, publié en mars 2025 par l’Association de radiologie nord-américaine, s’intitulant : « La pénurie croissante de radiologues : défis et possibilités ».
Chômage technologique
Les prédictions pessimistes sur les conséquences du progrès technologique et de l’automatisation sur le marché du travail ne sont pas nouvelles. Certains des plus grands économistes de leur temps, de David Ricardo, au XIXe siècle, observant la première révolution industrielle, jusqu’à Wassily Leontief, au XXe siècle, face à l’informatique, ont également douté des bienfaits du progrès technologique pour les travailleurs. Leontief avait d’ailleurs bien conscience que deux siècles de progrès technologiques n’avaient pas jusqu’alors entraîné de chômage technologique massif.
Il vous reste 54.25% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.







