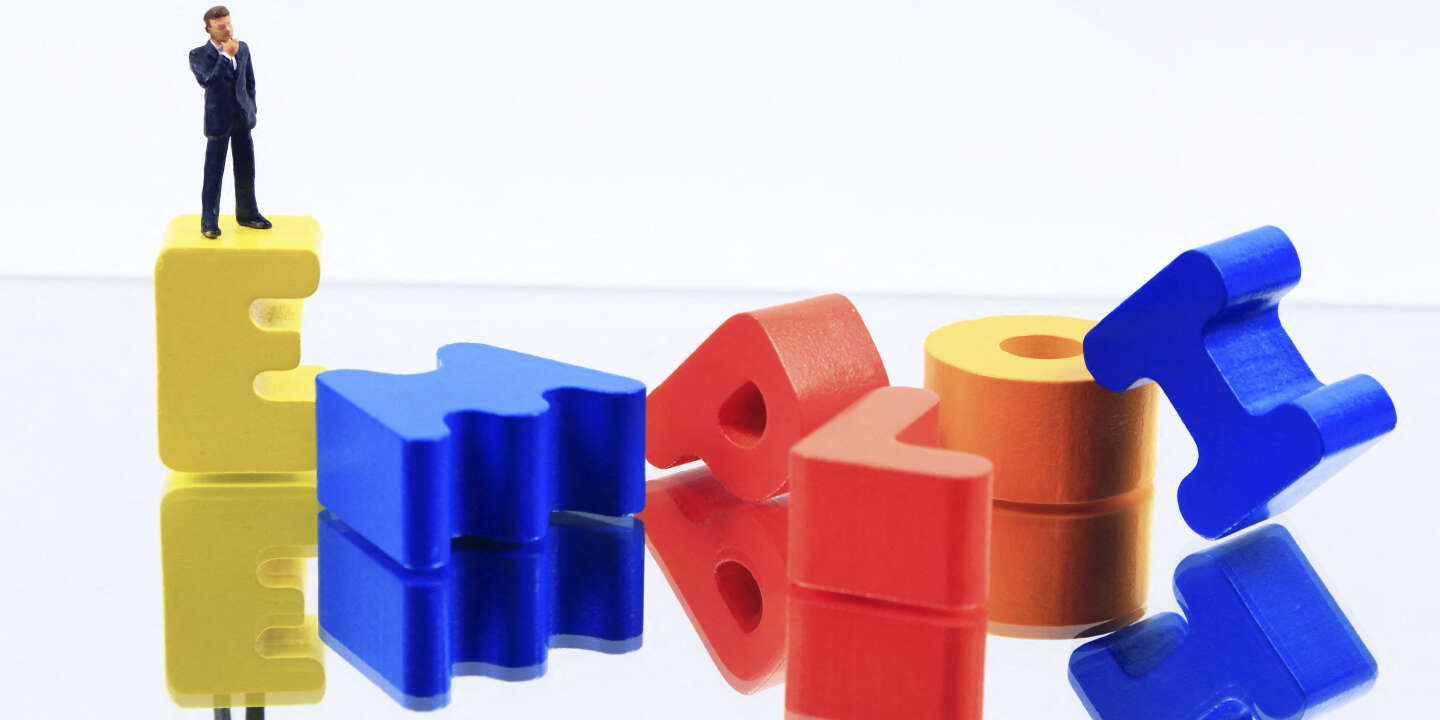Budget des ménages : ce qui change le 1er décembre

En attendant le 1er janvier, traditionnellement marqué par un grand nombre de mouvements tarifaires et d’entrées en vigueur de mesures affectant le budget des ménages, les nouveautés sont peu nombreuses ce 1er décembre. Plusieurs échéances fiscales sont toutefois à noter.
- Changer de mutuelle à tout moment est autorisé
A compter de ce 1er décembre, il est possible de résilier son contrat de complémentaire santé à tout moment, dès lors qu’il a au moins douze mois. Sans frais, et sans avoir à justifier sa décision.
Jusqu’ici, à quelques exceptions près, on ne pouvait changer de mutuelle qu’une fois dans l’année, en s’y prenant au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat.
La règle est donc désormais la même que pour les assurances auto, moto ou encore habitation. Attention, en revanche : s’il a été question ces dernières semaines d’appliquer aussi à l’assurance emprunteur cette possibilité de résiliation à tout moment de l’année, la mesure n’a finalement pas été adoptée par les parlementaires et la résiliation annuelle (possible une fois par an) reste donc de vigueur pour ce type d’assurance, pour les contrats de plus de douze mois.
- + 2,4 % pour les tarifs réglementés du gaz
Pour le cinquième mois consécutif, les tarifs réglementés du gaz sont en hausse en décembre, de 2,4 % en moyenne. Dans le détail, « cette augmentation est de 0,6 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 1,4 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 2,5 % pour les foyers qui se chauffent au gaz », précise la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
« )} }, « legend »: { « enabled »: « », « reversed »: « », « layout »: « horizontal », « verticalAlign »: « top », « align »: « left », « margin »: 40, « y »: -30, « x »: 0, « itemStyle »: { « fontSize »: 13, « font-family »: « ‘Marr Sans’,Helvetica,arial », « fontWeight »: « normal », « color »: « #2A303B » }, « itemMarginBottom »: 10 }, « series »: [ { « stack »: « null », « name »: « null », « lineWidth »: 2, « color »: « #4dbcd4 », « type »: « line », « yAxis »: « 0 », « visible »: true, « dataLabels »: { « enabled »: false }, « step »: « », « data »: [ [ 100.0, « #4dbcd4 », « pt0 », true, false ], [ 99.2, « #4dbcd4 », « pt1 », false, false ], [ 99.2, « #4dbcd4 », « pt2 », false, false ], [ 97.1168, « #4dbcd4 », « pt3 », false, false ], [ 96.4369824, « #4dbcd4 », « pt4 », false, false ], [ 95.954797488, « #4dbcd4 », « pt5 », false, false ], [ 89.429871258816, « #4dbcd4 », « pt6 », false, false ], [ 88.98272190252192, « #4dbcd4 », « pt7 », false, false ], [ 88.1818774053992, « #4dbcd4 », « pt8 », false, false ], [ 86.0655123476696, « #4dbcd4 », « pt9 », false, false ], [ 88.64747771809971, « #4dbcd4 », « pt10 », false, false ], [ 89.1793625844083, « #4dbcd4 », « pt11 », false, false ], [ 88.37674832114858, « #4dbcd4 », « pt12 », false, false ], [ 85.46031562655071, « #4dbcd4 », « pt13 », false, false ], [ 81.5291411077294, « #4dbcd4 », « pt14 », false, false ], [ 77.9418588989893, « #4dbcd4 », « pt15 », false, false ], [ 76.9286147333024, « #4dbcd4 », « pt16 », false, false ], [ 74.7746135207699, « #4dbcd4 », « pt17 », false, false ], [ 74.56524460291179, « #4dbcd4 », « pt18 », false, false ], [ 75.5345927827497, « #4dbcd4 », « pt19 », false, false ], [ 75.9878003394462, « #4dbcd4 », « pt20 », false, false ], [ 79.55922695540015, « #4dbcd4 », « pt21 », false, false ], [ 80.83217458668658, « #4dbcd4 », « pt22 », false, false ], [ 82.77214677676704, « #4dbcd4 », « pt23 », true, false ] ], « keys »: [ « y », « color », « id », « marker.enabled », « dataLabels.enabled » ] } ], « accessibility »: { « enabled »: true }, « exporting »: { « enabled »: false }, « credits »: { « enabled »: false }
} );
});
Cela « s’explique notamment par l’évolution des prix sur le marché mondial du gaz », indique la CRE, ajoutant que depuis début 2019 ces tarifs ont « baissé en tout de 17,2 % ».
Elle rappelle par ailleurs qu’à partir de ce 1er décembre « les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont supprimés pour tous les consommateurs professionnels ; les consommateurs professionnels disposant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel et n’ayant pas souscrit une offre de marché basculeront automatiquement en offre de marché par défaut chez leur fournisseur historique ».
- Revalorisation pour les professionnels des établissements de santé et des Ehpad
Dans le cadre du Ségur de la santé avait été actée, cet été, une revalorisation en deux étapes des professionnels des établissements de santé du secteur public et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de la fonction publique hospitalière : au 1er septembre 2020 puis au 1er mars 2021.
Il vous reste 36.61% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.