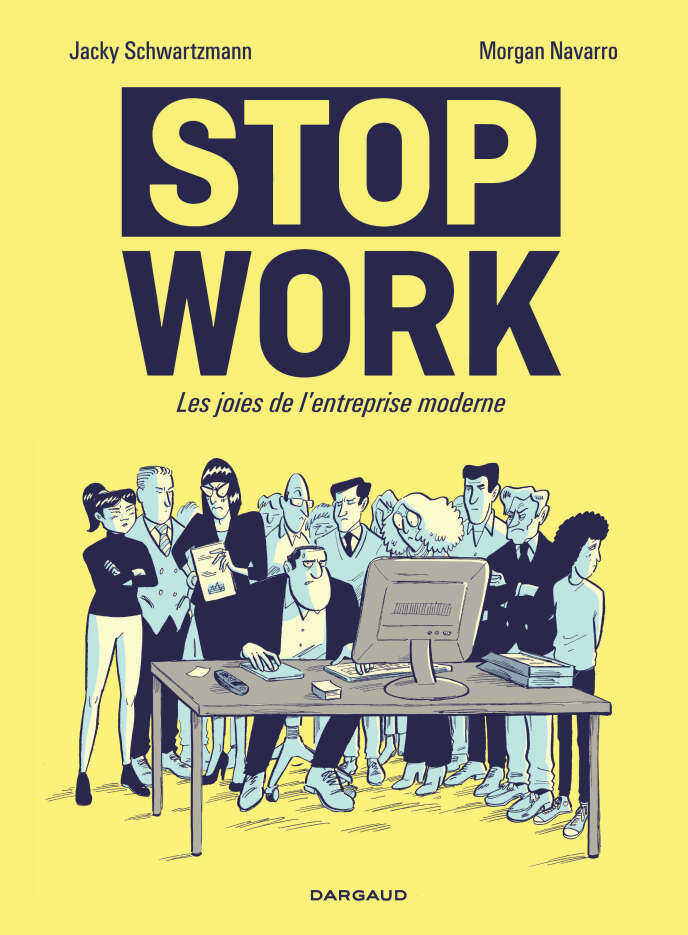Suzanne Berger : « Nous sommes à la veille d’une nouvelle organisation technologique »

Et si la crise accélérait l’émergence d’une nouvelle forme de mondialisation ? Peut-être bien, car les nouvelles technologies, telles que les imprimantes 3D, permettent de repenser les chaînes de production, explique Suzanne Berger, professeure de sciences politiques au Massachussets Institute of Technology (MIT), et autrice de plusieurs ouvrages sur la mondialisation. Intervenante aux rencontres « Aix en Seine » (3 au 5 juillet à Paris), elle insiste sur la nécessité de protéger les communautés fragilisées par l’ouverture des frontières.
Cette crise va-t-elle sonner le glas de la mondialisation telle que nous l’avons connue ces dernières années ?
La pandémie a frappé dans un contexte où celle-ci était déjà remise en question. La montée des populismes, comme le Brexit, souligne le mécontentement croissant des populations à l’égard d’une mondialisation jugée incapable de fournir une protection efficace contre une série de dangers, attisant la peur de l’étranger.
Beaucoup ont aussi découvert pendant cette crise que certains produits n’étaient pas disponibles à cause de la rupture des approvisionnements. Dans certains pays, cela a intensifié le désir de produire chez soi. Mais ce serait une erreur.
Enfin, les institutions internationales, telles que l’Organisation mondiale de la santé [OMS], ont été incapables d’agir efficacement face au Covid19 – en partie à cause de l’attitude des Etats-Unis, mais pas seulement. Les maux du multilatéralisme sont plus larges. Cela pose une question fondamentale : y a-t-il une incompatibilité entre la mondialisation et la démocratie ?
Y a-t-il vraiment incompatibilité ?
Je ne pense pas. Mais il est urgent d’imaginer comment protéger ceux qui sont exposés lorsque l’on ouvre les frontières. Les politiques d’ouverture doivent s’accompagner de politiques intérieures évitant que certains secteurs industriels ne paient le prix fort, accompagnant les communautés souffrant le plus du déclin industriel, comme on l’a observé aux Etats-Unis au début des années 2000.
C’est essentiel, car le nationalisme, incontrôlable à bien des égards, nous met en danger : les tensions risquent de ne pas se limiter à l’économie et de déraper en conflits bien réels.
La mondialisation fait des perdants. Pourquoi ne l’a-t-on pas compris plus tôt ?
En partie parce que ce mouvement s’est singulièrement amplifié après 2001, à la suite de l’entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce [OMC], sans que l’on en mesure tout de suite les conséquences. Celle-ci a entraîné des pertes d’emplois aux Etats-Unis, localisées dans certaines industries et régions, où l’on a observé un niveau élevé de vote en faveur de Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle.
Néanmoins, la gestion calamiteuse de la pandémie par celui-ci va peut-être changer la donne dans ces régions.
Comment l’attitude des Etats-Unis à l’égard de la Chine a-t-elle évolué depuis 2001 ?
Si l’on schématise, le désir des industriels américains de faire du business avec la Chine l’a longtemps emporté sur d’autres considérations. Désormais, ces industriels ont changé d’attitude : ils ont épuisé les possibilités de produire à bas coût dans l’Empire du Milieu, et se heurtent à l’impossibilité d’y vendre des produits plus haut de gamme, car Pékin bloque.
Du côté politique, les démocrates comme les républicains ont également ouvert les yeux. Ils ont longtemps été trop naïfs à l’égard de la Chine, aveuglés par la recherche de profits liés aux implantations d’usines sur place, fermant les yeux aux problèmes politiques et démocratiques.
Cette prise de conscience peut-elle accélérer des relocalisations vers les Etats-Unis ?
Je ne crois pas. La production de masse ne reviendra pas aux Etats-Unis. Ce n’est d’ailleurs pas souhaitable, car les emplois dans de telles usines sont difficiles. En outre, la base industrielle du pays a changé : elle est plus spécialisée, s’est tournée vers les nouvelles technologies. En revanche, il est possible de diversifier les sources d’approvisionnement en nous tournant vers d’autres pays d’Asie, comme le Vietnam.
Comment ces chaînes de production peuvent-elles évoluer au cours des prochaines années ?
Après les années 1980, l’organisation des entreprises, jusque-là très verticale, a été bouleversée en partie sous la pression des marchés financiers : les entreprises ont désintégré leurs structures industrielles pour, par exemple, fabriquer en Chine un produit imaginé aux Etats-Unis.
Aujourd’hui, nous sommes peut-être à la veille d’un renversement de cette tendance à la désintégration, au profit d’une nouvelle organisation technologique et industrielle, grâce aux nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle et les imprimantes 3D. Il ne faut néanmoins pas surestimer la vitesse de ces changements.
Que voulez-vous dire ?
Il y a quelques années, on prédisait qu’en 2020 les robots auraient remplacé un grand nombre de travailleurs et que les voitures autonomes auraient chassé les véhicules traditionnels. Certains de mes collègues du MIT sont encore convaincus que l’automatisation va détruire beaucoup d’emplois. Je pense plutôt qu’elle s’inscrira en complément, et que ce mouvement sera plus lent qu’ils ne l’estiment.
Mes étudiants et moi allons voir comment les entreprises américaines adoptent les nouvelles technologies : il y a une forme d’inertie, en particulier dans les TPE et PME. C’est lent, coûteux, et elles auront encore moins de marges de manœuvre financières pour investir dans ces technologies, au sortir de cette crise. D’autant que l’achat d’un robot représente un quart seulement du coût lié à l’intégration de ce dernier : il faut également changer les modes de production, les logiciels, l’organisation…
La récession va-t-elle pénaliser un peu plus encore nos usines ?
Aujourd’hui, les inquiétudes portent moins sur l’industrie que sur les services, en particulier le tourisme, première victime de la pandémie.
L’essor du télétravail, qui devrait durer, aura également des impacts collatéraux sur certains secteurs. Notamment sur l’immobilier commercial – qui, à l’avenir, aura besoin d’autant de bureaux si l’on travaille plus à la maison ? –, mais aussi, les services liés : restaurants implantés autour des entreprises, pressings, etc.
Quelles sont les autres tendances à l’œuvre accélérées par cette crise ?
Cela n’a pas de rapport avec la pandémie, mais l’un des événements les plus significatifs est, selon moi, le mouvement de protestation contre les violences policières et le racisme déclenché par la mort de l’Afro-Américain George Floyd. Il y a beaucoup de Blancs dans les manifestations. Nombre d’entreprises et d’Etats américains ont pris des mesures pour limiter ce qui s’apparente à du racisme institutionnalisé.
La prise de conscience et la reconnaissance de ces injustices sont plus profondes encore que pendant les années 1970. Je pense que cela aura des conséquences sur la prochaine élection présidentielle, et au-delà.
Les protestations Black Live Matters ont, en outre, inspiré des mouvements dans d’autres régions du monde. Cela restaure un peu le soft power américain, mis à mal ces dernières années, et l’image des Etats-Unis, toujours à même d’inspirer un mouvement positif au-delà de leurs frontières.