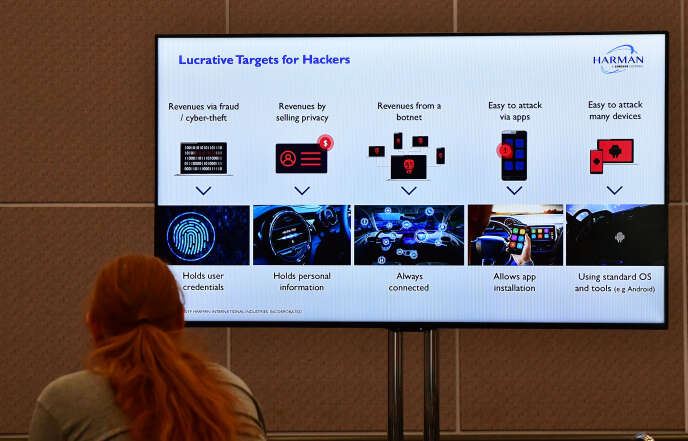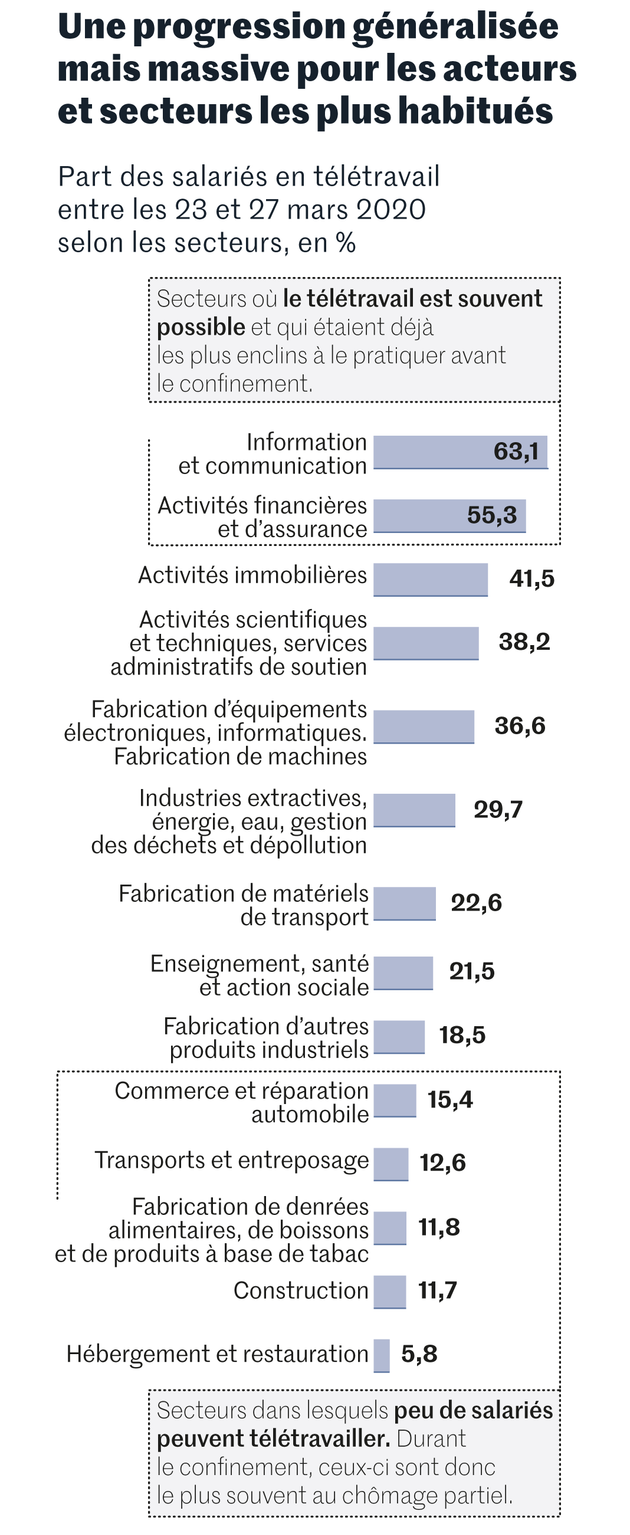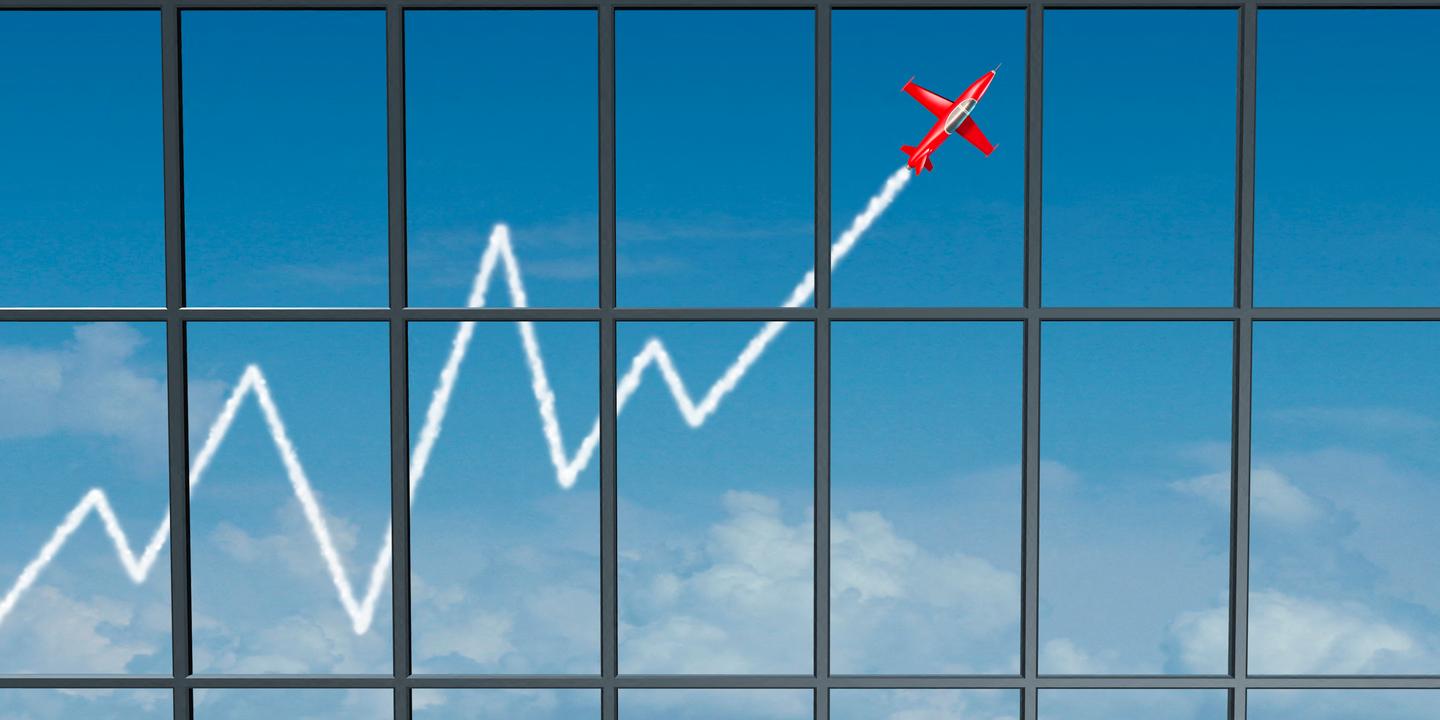L’avenir de Conforama suspendu à l’obtention d’un prêt garanti par l’Etat

Dans le secteur de la consommation, Fnac Darty l’a eu (500 millions d’euros), Castorama et Brico Dépôt, propriété de Kingfisher, viennent de l’obtenir (600 millions d’euros), la Cafom, propriétaire d’Habitat et de Vente-unique.com, aussi. Mais Conforama attend toujours l’obtention du prêt garanti par l’Etat (PGE) d’environ 300 millions d’euros, selon nos informations, qu’elle a sollicité il y a plusieurs semaines.
La dernière réunion sous l’égide du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), avec les quatre banques concernées (Crédit du Nord, LCL, HSBC et BNP), vendredi 15 mai, n’a pas débloqué la situation.
Au 7 mai, 386 658 entreprises de toutes tailles avaient obtenu une enveloppe de 65,799 milliards d’euros. Pour le distributeur français de produits d’ameublement, la situation est de plus en plus tendue. Sans cet apport financier, il risque dans les prochaines semaines la mise en redressement judiciaire.
1 900 emplois supprimés en France sur 9 000
Après le scandale financier lié à des irrégularités comptables de son actionnaire principal, le groupe Steinhoff, en 2017, Conforama avait été pris dans une tempête financière qui a abouti, en juillet 2019, sur un vaste plan de restructuration : 32 magasins Conforama en France fermés en 2020, et 10 Maison Dépôt, entraînant la suppression de 1 900 emplois – sur quelque 9 000 en France. Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) avait été mis en place pour accompagner le départ des salariés et la fermeture des magasins programmée en trois vagues, à partir du 15 avril.
Quelques acquéreurs pour les magasins s’étaient même présentés, comme But et Lidl. Tandis que les résultats financiers de Conforama avaient commencé à s’améliorer. Le chiffre d’affaires était en hausse de 1 % au quatrième trimestre 2019, par rapport à 2018, et la tendance se poursuivait jusqu’en février. « Cela n’était plus arrivé depuis longtemps. Les efforts de tout le monde commençaient à porter leurs fruits », raconte Jacques Mossé-Biaggini, délégué syndical central FEC-FO. « Les difficultés étaient éteintes. Les objectifs financiers étaient tenus. On était sur un retour de la rentabilité dès 2020. Le Covid-19 nous a fait sortir de la trajectoire », assurait-on du côté de la direction, début mai.
Depuis plusieurs semaines, la direction de Conforama négocie avec difficulté cet apport financier. L’Etat a même accepté d’augmenter sa garantie à 90 %, au lieu de 80 % dans d’autres dossiers, pour que le prêt soit bouclé. Rien n’y a fait. L’une des quatre banques, BNP, ayant même séché la dernière réunion, vendredi 15 mai, organisée par le CIRI. « Et HSBC semble moins intéressé à soutenir des investissements français, indique M. Mossé-Biaggini. Avec l’augmentation de l’engagement de l’Etat, c’est difficilement compréhensible. » A l’AFP, la banque française a répondu, samedi 16 mai, que, « si un nouveau projet industriel et commercial de long terme, et mobilisant les actionnaires actuels ou de nouveaux actionnaires, devait se dessiner, BNP Paribas l’examinerait. »
« C’est le serpent qui se mord la queue ! »
Or, sans ce prêt, outre une mise à mal de la situation financière de l’entreprise, pas de financement du plan social pour les salariés. « Le PSE devait être financé par la tranche B de l’emprunt théoriquement consenti par le panel de créanciers dirigé par Helen Lee Bouygues. 110 millions d’euros devaient rentrer, mais les créanciers conditionnent maintenant ce versement à l’obtention du PGE. C’est le serpent qui se mord la queue ! », se désole M. Mossé-Biaggini. Certains salariés ayant déjà quitté l’entreprise, environ 1 500 personnes sont encore concernées. « Les propositions de reclassements internes devaient être envoyées à partir du 11 mai, et les premières notifications de licenciement devaient partir début juin. Tout est gelé », poursuit le syndicaliste.
Rien de signé non plus du côté des acheteurs potentiels des magasins. Après avoir annoncé dans les médias son intérêt pour une dizaine de magasins, But s’est retiré des discussions au début de l’année.
Pour le moment, Conforama n’a rouvert que 19 magasins en libre-service sur 182. Les 16 magasins de la première vague de fermeture ne rouvriront pas, et les 13 autres de la seconde vague, prévue début juin, sont en suspens. Les derniers sont censés fermer le 15 octobre. Une situation compliquée pour l’ensemble des salariés de Conforama, qui « sont plongés dans l’insécurité quand à la viabilité de leur entreprise et la pérennité de leur emploi », a indiqué la CGT dans un communiqué, samedi 16 mai.