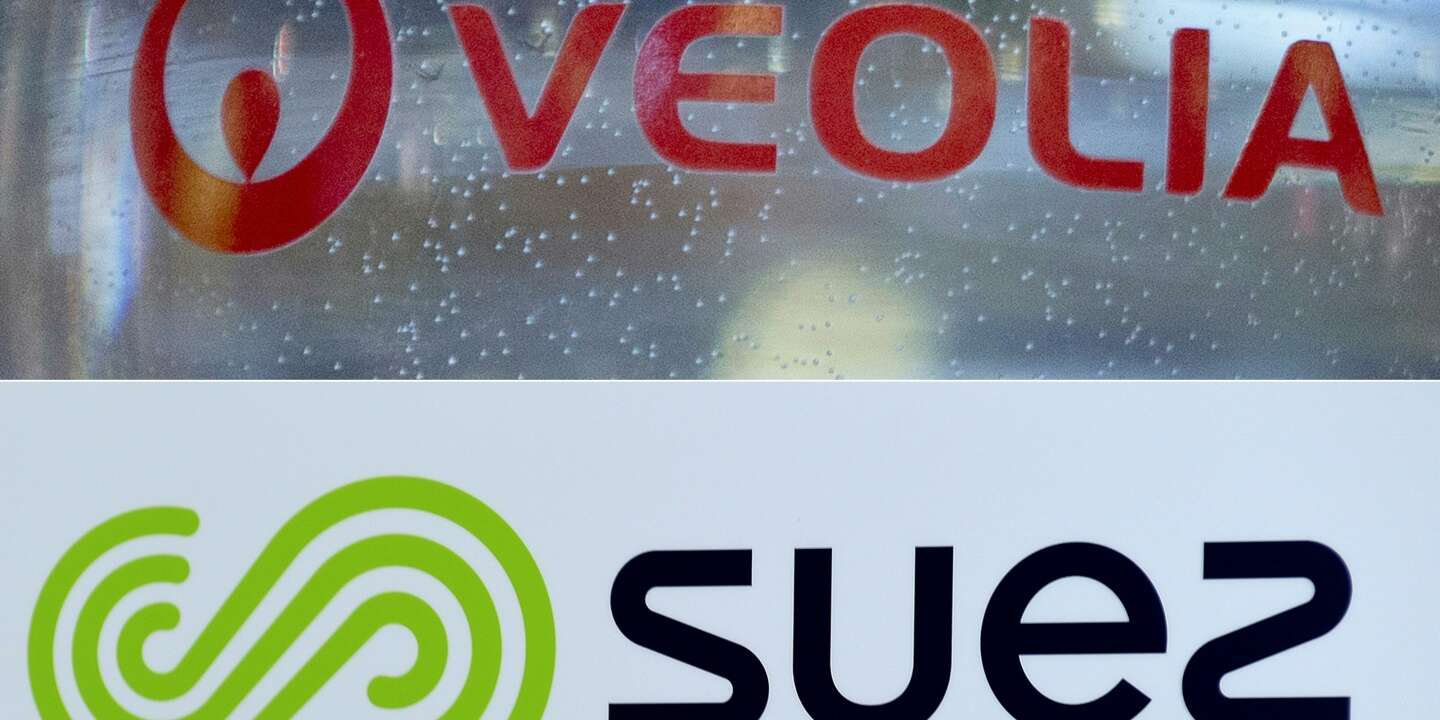Les « aidants » qui travaillent peuvent désormais prendre un congé indemnisé
Brigitte Bourguignon a sorti le dossier de l’ornière en arrivant au ministère de la santé en juillet. Dix mois après le vote de la loi du 24 décembre 2019 qui prévoyait sa création, le congé rémunéré pour les proches aidants doit enfin devenir, jeudi 1er octobre, « un droit réel », selon la ministre déléguée à l’autonomie.
Ce dispositif était une « mesure phare » du plan présenté par l’ancien premier ministre Edouard Philippe en octobre 2019 en faveur des salariés devant prendre soin d’une personne handicapée, malade ou d’un parent âgé – sur 8 millions à 11 millions d’aidants, en France, on estime que 4 millions à 5 millions sont des salariés. L’entrée en vigueur de cette mesure était programmée pour octobre 2020. Mais le décret qui l’organise était resté jusqu’ici dans un tiroir. La crise sanitaire a mobilisé l’administration sur d’autres urgences. « Et il y a eu un manque de portage politique », admet-on au ministère.
Le décret devrait paraître au Journal officiel. Mais il y est bien précisé que les dispositions prévues s’appliquent « à compter du 30 septembre 2020 ». Tous les salariés du secteur privé et public, les indépendants ainsi que les demandeurs d’emplois pourront bénéficier de ce congé indemnisé.
Sa durée maximale est de trois mois mais il peut être renouvelé jusqu’à un an sur l’ensemble de la carrière d’un salarié. Le montant de l’indemnisation est fixé à 43,83 euros par jour pour une personne en couple et à 52,08 euros par jour pour un aidant qui vit seul. Elle sera versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de la mutualité sociale agricole.
Le montant de l’indemnisation fustigé
Ce dispositif « a le mérite de poser une première pierre. Il aura besoin d’évoluer dans le temps », a réagi Paul Christophe, député (Agir ensemble) du Nord, fortement mobilisé à l’Assemblée nationale sur ce dossier. Son souhait serait que la durée du congé puisse être allongée pour aller jusqu’à trois ans « fractionnable ». Les associations d’aidants saluent, elles, « l’avancée » mais jugent que les modalités financières sont perfectibles.

Écouter aussi Paroles d’aidants : « Je ne veux pas que la vie de mon fils dépende de la mienne »
Pour Claudie Kulak, fondatrice de la Compagnie des aidants, présidente du collectif « Je t’aide », le faible montant de l’indemnisation risque de dissuader beaucoup d’aidants d’interrompre leur contrat de travail. Mme Kulak suggère que les salariés qui prennent ce congé puissent continuer de percevoir une part de leur rémunération en complément de l’indemnisation versée par la CAF. « Il faut que les branches professionnelles s’emparent du sujet et que les entreprises et notamment les PME s’impliquent davantage dans l’aide aux aidants », dit-elle.
Il vous reste 11.9% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.