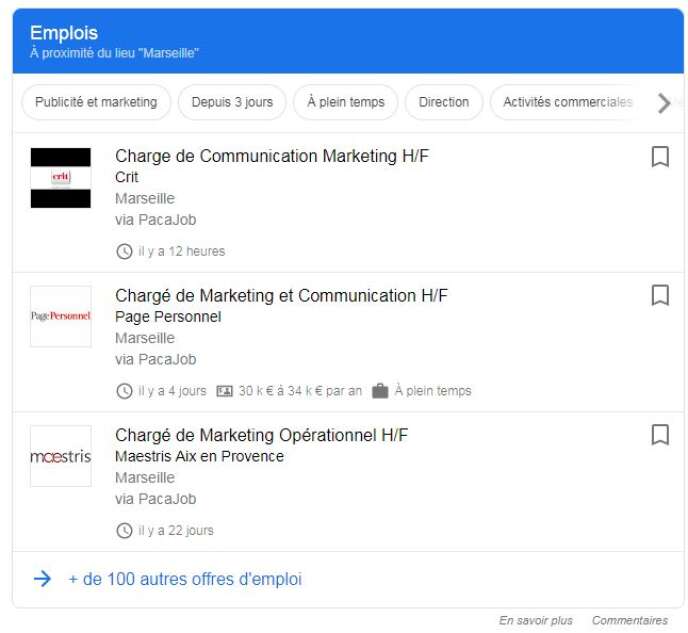Actuellement, d’un simple clic, les expatriés peuvent découvrir tous les bons plans dont ils ont besoin sur les réseaux sociaux. Agathe, 30 ans, qui vit à l’étranger depuis l’âge de 7 ans, se retient que cela n’a pas continuellement été le cas. « Quand j’étais au collège à Djibouti, en 2000, il n’y avait même pas de téléphone », déclare-t-elle.
L’unique opérateur local, Djibouti Télécom, venait de s’introduire, en 1999. « Je me souviens que mes parents allaient aux soirées organisées par l’ambassade pour rencontrer d’autres expatriés et échanger des conseils pour trouver un médecin ou un coiffeur », mentionne la jeune Franco-Canadienne, expatriée au Mali depuis trois ans, qui a désiré garder l’anonymat.
Sur seulement Facebook, 92 millions d’expatriés sont structurés par pays ou par communauté. Les Français y ont leur groupe dans presque tous les pays du monde, de l’Indonésie au Pérou en passant par la Nouvelle-Zélande. Certains, comme « Français en Nouvelle-Zélande », assimilent plusieurs dizaines de milliers de membres. « Mon utilisation des groupes sur Facebook a explosé depuis que je vis au Pérou », ajoute Lauriane Brulebeaux, 37 ans. « Il y a le groupe des expats, celui des mamans, ou encore celui des entrepreneurs… En tout, je suis active dans une bonne dizaine de groupes, sans établir ceux que je regarde seulement de temps en temps », déclare la jeune maman.
Les réseaux sociaux assistent amplement la solidarité entre les expatriés, témoigne Michaël Briffaud, installé aux Etats-Unis depuis août 2018. Quand il s’est déplacé à Washington, tout le monde lui a conseillé de s’inscrire sur le Google Group francophone « Mamans autour de DC ». Un forum qui héberge quelque 31 000 sujets de conversation. De quoi trouver son bonheur, commodément installé dans son canapé. « Quand ma belle-sœur est venue nous rendre visite, nous avions besoin d’une poussette pour mon neveu de 3 ans et nous voulions éviter d’en acheter une. Sur le groupe, nous avons trouvé une Suisse qui nous en a prêté deux gratuitement », déclare l’expatrié de 34 ans.
« Ils ne remplacent pas la rencontre humaine »
Les réseaux sociaux complètent les réseaux physiques. « Au Mali, tu ne peux pas sortir dans la rue “pour aller voir ce qui se passe ce soir”. Du coup, les réseaux sociaux nous aident à trouver les soirées qui sont organisées », explique Agathe. Mais « ils ne remplacent pas la rencontre humaine », estime Lauriane Brulebeaux. « Le groupe Facebook des Français au Pérou n’existe pas physiquement, les gens échangent des infos mais ne se rencontrent pas, alors que certaines associations d’expatriés, comme Lima Accueil, organisent des événements. C’est une communauté qui existe vraiment et qui ne peut pas être remplacée par les réseaux sociaux. » Lauriane Brulebeaux conserve en tête l’épisode de son accouchement, il y a presque un an. A ce moment-là, bien qu’en contact avec ses proches sur les réseaux sociaux, elle a senti un grand besoin de les avoir physiquement près d’elle.
Pour ce qui concerne les contacts commodités avec les proches restés au pays, le rôle des réseaux sociaux est à double tranchant. « Avant, le départ était “sans appel”, avec une coupure nette de communication avec ses proches car le téléphone était très coûteux et les courriers arrivaient après plusieurs jours », rappelle l’anthropologue Audrey Chapot. Seul le retour en France, même ponctuel, remettait un contact ferme. Selon l’enquête « Liens et relations avec la France des Français résidant à l’étranger », accomplie par Ipsos en 2015, 78 % des Français résidant à l’étranger rentrent en France au moins une fois par an.
Actuellement, entre deux « retours », ils demeurent connectés au pays d’origine, surtout par WhatsApp ou Messenger. « Mon père et ma belle-mère se sont inscrits sur Messenger quand nous sommes partis aux Etats-Unis. On s’appelle en visioconférence tous les dimanches et pour eux, c’est vraiment important de nous voir. Cela nous permet de maintenir un lien quotidien beaucoup plus facilement que par mail », déclare Michaël Briffaud. « Les réseaux sociaux permettent la simultanéité de la communication », note l’anthropologue Audrey Chapot.
Parler sans tabou
Agathe estime aussi de pouvoir garder une liberté d’expression sans tabou en communiquant aisément avec ses proches, même si depuis le Mali les conversations vidéo sont impossibles. « La vie d’expatrié n’est pas toujours facile. Du coup, c’est réconfortant de pouvoir échanger avec des gens qui ont la même culture que soi, sans risquer de dire quelque chose qui choque », déclare la jeune femme.
Par contre, la constance des échanges gâche quelque peu la qualité des relations. « Je me suis rendu compte que quelques personnes ne saisissaient pas de nouvelles parce qu’elles pensaient connaître ma vie grâce aux photos que je postais sur Facebook », ajoute Agathe, qui a définitivement décidé de fermer son compte. Audrey Chapot certifie que ce phénomène peut aller jusqu’à créer des pénuries au retour de l’expatrié. « Avant que les réseaux sociaux n’existent, le retour signifiait redécouverte mutuelle, de l’autre et du pays d’origine. Actuellement, sous prétexte que le lien est habituel, que le blog ou Facebook présentent des détails du quotidien, l’épisode de redécouverte semble inutile, alors que dans les faits, il est essentiel », expose l’anthropologue.
A tant vouloir conserver un lien avec leur pays d’origine, les Français placés à l’étranger risquent aussi de ne pas bénéficier pleinement de leur expatriation. « Un lien quasi quotidien avec la France (proches, médias, contact avec d’autres expatriés français) freine l’immersion totale, donc empêche ou ralentit l’intégration dans le pays d’accueil », ajoute Audrey Chapot.
Plus de 5 000 personnes attendues au Forum Expat 2019
Le Forum Expat se déroulera les 12 et 13 juin au Carreau du Temple, à Paris. Ce fait créé par Le Monde en 2013 réunit des acteurs économiques, universitaires et diplomatiques pour répondre aux enjeux de la mobilité internationale : comment arranger son départ et surtout son retour ? A quelle assistance sociale se vouer ? Comment bâtir son patrimoine ?
Cette 7e édition organisée autour de trois thématiques – mobilité professionnelle, gestion de patrimoine et vivre au quotidien – décryptera l’expatriation selon les motivations de départ : pour se former en Allemagne, pour travailler au Canada, pour investir à l’île Maurice.
Le Forum fera deux focus sur l’Europe, but favorisée pour plus de 50 % des expatriés français : l’un sur la République tchèque et l’autre sur l’impact du Brexit. Une dizaine de fins seront justement indiquées : le Portugal, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, la République tchèque, l’île Maurice, les Etats-Unis, le Canada et la Nouvelle-Zélande.
Le mercredi 12 juin de 10 heures à 21 heures et le jeudi 13 juin de 10 heures à 18 heures. Au Carreau du Temple, 4, rue Eugène-Spuller, 75003 Paris. Entrée gratuite, inscription sur www.leforumexpat.com