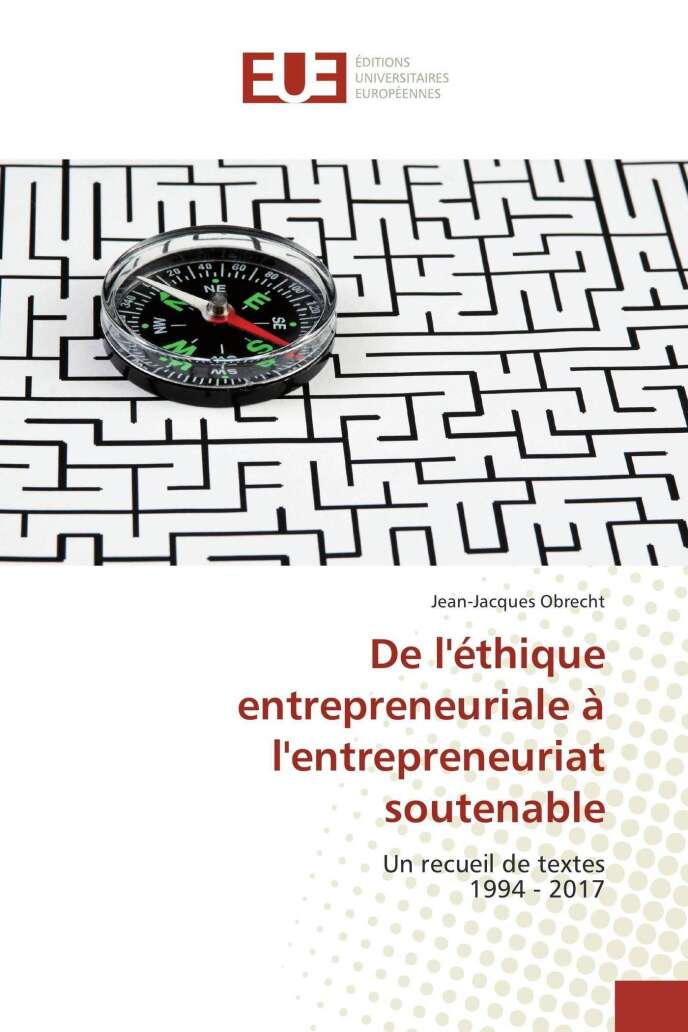Coronavirus : Amazon suscite des critiques de salariés aux Etats-Unis comme en France

Après la France, les Etats-Unis. Alors que les syndicats dénoncent, en France, les conditions de sécurité dans les entrepôts d’Amazon depuis le début du confinement, le leader de l’e-commerce fait face à une mobilisation croissante outre-Atlantique. Le licenciement de Chris Smalls, un employé coorganisateur d’un arrêt de travail dans un site de Staten Island, près de New York, concentre les protestations.
« Nous sommes scandalisés d’entendre que les dirigeants d’Amazon n’ont pas seulement refusé de répondre aux demandes de ses propres travailleurs, mais ont viré l’un des principaux lanceurs d’alerte, juste après sa courageuse action de lundi [30 mars] », écrivent, mercredi 1er avril dans une lettre ouverte, six grands syndicats américains, dont l’AFL-CIO, et plusieurs sénateurs et élus de l’Etat de New York.
Mardi 31 mars, le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, a déjà annoncé une enquête du responsable des droits de l’homme de la ville sur ce renvoi. La veille, la procureure de New York, Letitia James, a demandé une enquête sur cet acte « immoral et inhumain ». Elle doit être menée par le National Labor Relations Board, qui régit les conflits du travail.
De son côté, Amazon réfute tout lien entre le licenciement de M. Smalls et son activisme interne. Selon la direction, il a été mis en quarantaine préventive, parce qu’il a été en contact avec un malade du coronavirus. « Mais, malgré cette instruction de rester chez lui, payé, pendant quatorze jours, il est venu au travail, lundi 30 mars, mettant les équipes en danger », assure Amazon.
Un « rôle crucial » pour les confinés
Cette explication est jugée « ridicule » par M. Smalls, qui promet de continuer la mobilisation. Des employés de plusieurs sites d’Amazon ont eux aussi organisé des grèves ponctuelles : à Chicago, lundi, près de Detroit, mercredi, et dans le quartier du Queens, à New York, le 18 mars. Mardi, des salariés de la chaîne de supermarchés Whole Foods, filiale d’Amazon, ont eux aussi arrêté le travail. Eux aussi ont protesté contre des mesures de protection jugées insuffisantes et demandé l’extension du congé maladie rémunéré aux personnes qui présentent des symptômes, mais qui n’ont pas été testées. Auparavant, en Italie, les syndicats avaient lancé un mouvement de grève sur le site de Castel San Giovanni (au sud de Milan), durement touchée par le virus.
En réponse, Amazon estime que ces manifestations sont minoritaires et n’ont, aux Etats-Unis, rassemblé que quelques dizaines d’employés chacune – sur un total de 800 000 dans le monde. L’entreprise martèle avoir pris des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, qui assurent la sécurité de ses employés. L’entreprise de Jeff Bezos a aussi augmenté temporairement le salaire horaire de 2 euros. Et a annoncé, jeudi 2 avril, avoir embauché 80 000 personnes sur les 100 000 prévues pour poursuivre l’activité malgré l’épidémie.
Le géant de l’e-commerce se présente aussi comme une infrastructure jouant un « rôle crucial » pour les confinés. Amazon a d’ailleurs annoncé prioriser les ventes de « produits essentiels » sur sa plate-forme. Mais ce discours est contesté par les syndicats, selon lesquels tous types de produits restent disponibles. Et la mobilisation de salariés jugés précaires est soutenue aux Etats-Unis par des groupes d’employés protestataires au sein des géants du numérique comme les collectifs Google Walk Out for Real Change ou Amazon Employees for Climate Justice.
Concurrence déloyale
En France, un salarié de l’entrepôt de Brétigny-sur-Orge (Essonne), malade du Covid-19, a été placé en réanimation, mardi. Cette information, annoncée par la CGT mercredi, est confirmée par la direction. Trois autres salariés ont été officiellement diagnostiqués avec le coronavirus dans ce site et un autre à Saran (Loiret). « Mais il y a aussi des dizaines de cas suspectés », ajoute Alain Jeault, délégué central CGT. Ce dernier regrette que certains salariés malades ne soient pas testés.
L’absentéisme est très élevé en France, selon les syndicats, malgré le refus de la direction de payer les salariés qui se déclarent en droit de retrait. Il ne dépasse pas 20 % en incluant les congés pour garde d’enfants, assure la direction.
« On ne comprend pas qu’Amazon soit autorisé à poursuivre une activité aussi peu essentielle, faisant courir de tels risques aux salariés, a réagi, mercredi, Alma Dufour, chargée de campagne pour l’association Les Amis de la Terre, dans un communiqué, dénonçant une concurrence déloyale pour les petits commerces fermés.
« Une fois c’est blanc, une fois c’est noir »
« Le gouvernement ne doit pas attendre qu’il y ait un décès pour changer de ligne ! », ajoute l’ONG écologiste. Une référence aux propos de la ministre du travail, Muriel Pénicaud. « Amazon a changé une partie [des règles de sécurité], mais ça ne suffit pas, a déclaré la représentante du gouvernement, dimanche 29 mars, au Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI. Donc, on ne lâche pas jusqu’à ce que ce soit les bonnes mesures pour protéger les salariés. » Mais Mme Pénicaud avait auparavant jugé les mesures sanitaires prises par Amazon satisfaisantes. « Une fois c’est blanc, une fois c’est noir », relativise Julien Vincent, délégué central CFDT.
Jeudi, Amazon a annoncé le début d’une distribution de masques pour les employés, à partir de vendredi 3 avril, partout dans le monde. Une revendication de longue date des syndicats. La direction répond toujours que le port du masque ne fait pas partie des recommandations de l’Organisation mondiale de santé, mais explique que l’évolution des stocks permet désormais de répondre à cette demande de certains salariés. L’entreprise de Jeff Bezos va aussi commencer à mettre en place des vérifications de la température des employés à l’entrée des sites. Une autre demande des représentants du personnel.
« Les mesures prises par Amazon ne règlent malheureusement toujours pas le problème de la possible transmission du virus par un support physique, comme les produits ou les bacs que les collègues doivent manipuler lors de la confection des colis », juge M. Vincent, de la CFDT.
L’intersyndicale réclame toujours la mise en chômage partiel de l’essentiel des salariés d’Amazon. Et envisage encore de porter plainte au pénal pour mise en danger de la vie d’autrui, au nom l’obligation d’assurer la sécurité des salariés prévue par le code du travail. « Prétendre être exonéré de vos obligations au prétexte d’appliquer les préconisations gouvernementales en matière de Covid-19 est une faute lourde », écrit M. Vincent dans un courriel adressé mercredi à la direction et au ministère du travail.
Notre sélection d’articles sur le coronavirus