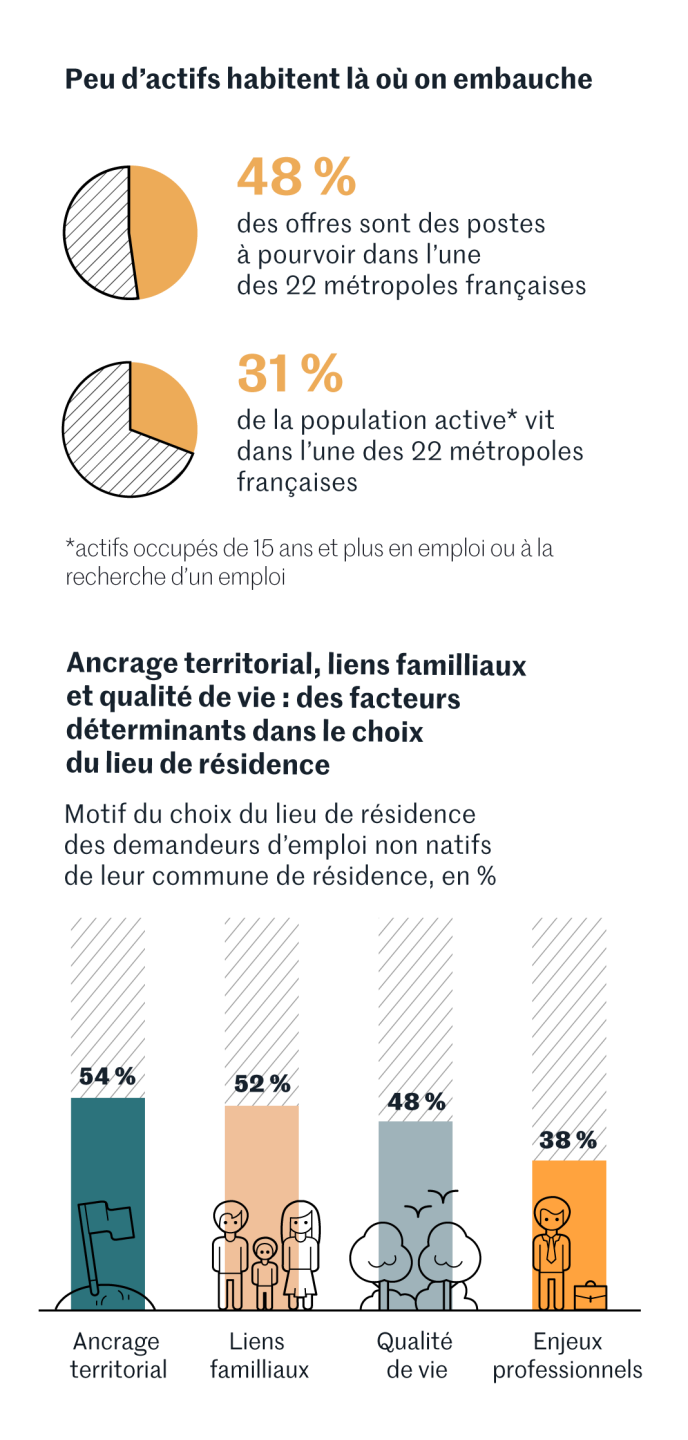« Il faut percer des politiques “béton et bitume” »

L’économiste montre pourquoi la concentration des ressources et la densification de l’activité sur un même territoire ne donnent pas forcément de gains de productivité et de prospérité.
La dynamique économique nationale et locale serait, ainsi, proportionnelle aux volumes de béton et de bitume coulés dans ces opérations. Cette conception, matérialiste, du développement économique a parfaitement été résumée par Jean-François Gravier dans l’ouvrage L’Aménagement du territoire et l’avenir des régions françaises, paru en 1964 [Flammarion]. On pouvait y lire que « trois éléments sont nécessaires et suffisants pour qu’une zone géographique puisse s’engager dans la voie du progrès. Ces trois éléments sont : l’eau, l’énergie et les transports ».
Beaucoup d’élus, notamment territoriaux, souvent influencés par de grands aménageurs, se sont livrés une sorte de « guerre de l’attractivité »
Depuis, nombre de recherches, en France comme à l’étranger, ont montré que la concentration des ressources et la densification de l’activité au sein d’un même territoire ne sont pas forcément génératrices de gains de productivité et de croissance. Il n’en demeure pas moins que beaucoup d’élus, notamment territoriaux, souvent influencés par de grands aménageurs, se sont livrés une sorte de « guerre de l’attractivité », à grand renfort de subventions publiques accordées aux investissements et à l’implantation d’entreprises, le tout accompagné d’aides conséquentes sur le foncier et d’exonérations sur les prélèvements.
En concentrant son action sur la proximité géographique entre les entreprises, d’une part, et sur la mobilité des travailleurs, de l’autre, l’action publique est ainsi restée focalisé sur des actions inscrites dans l’espace. Rapidement visibles, ces opérations avaient en outre l’immense avantage de pouvoir être associées à leurs initiateurs.
Projet patient et de long terme
Il est actuellement connu et admis que la dynamique économique dépend de bien d’autres facteurs que la proximité géographique et les moyens de transport mis en place. La coordination fondée sur les échanges de pratiques et d’expériences, la présence de réseaux de relations de différentes natures – économique, professionnelle, politique, sociale, etc. – et le sentiment de s’inscrire dans des projets menés au sein d’un même territoire sont apparus, depuis une vingtaine d’années environ, comme des vecteurs puissants et des moteurs efficaces du développement local.
Fondée un projet patient et de long terme avec des partenaires multiples et variés stimule des stratégies et comportements coopératifs sur un espace territoriale donné. Ces projets incitent les acteurs – privés et publics – à se coordonner, à harmoniser leurs moyens d’action et à définir des objectifs à moyen-long terme qui, au bout du compte, peuvent contribuer à la coévolution de l’entreprise et du territoire.
Les pouvoirs publics devraient de nos jours aider au même temps partenaires économiques et territoriaux à se nourrir de leurs apports mutuels par le biais d’un apprentissage collectif. Celui-ci serait bâti sur la coproduction de ressources nécessaire pour agir. Il leur faut s’affranchir du dogme de l’aménagement.
Ces nouveaux modes d’action qui aident à sortir du credo déterministe selon lequel ce qui existe actuellement conditionne l’avenir. L’inventaire des besoins et des défis, au premier rang desquels la transition écologique, doit permettre d’identifier les activités à promouvoir, celles à développer et les secteurs à réorienter. Cela ne va pas de soi. Pour y parvenir, deux questions doivent être traitées. Quelle voie de sortie pour les politiques qui ont, jusqu’à présent, donné la part belle aux bâtisseurs ou aux commanditaires de grands projets ? Comment et avec qui définir les cadres d’une action publique favorisant les synergies entre acteurs et la coconstruction des sociétés et du territoire ?
Nadine Levratto est économiste et directrice de recherche au CNRS en poste à l’université de Paris-Nanterre. Spécialiste de l’économie industrielle, ses recherches portent principalement sur l’analyse des trajectoires d’entreprises, les politiques publiques de soutien aux entreprises et les performances des territoires.
Cet article a été réalisé dans le cadre d’un partenariat avec Pôle emploi.