Brexit : « Des coalitions sauraient étonnamment voir le jour dans l’enseignement universitaire entre la Grande-Bretagne et l’UE »
Quel paradoxe si, définitivement, le Brexit repoussait les grandes institutions britanniques à se tourner davantage vers l’Europe, s’exclame Delphine Manceau, spécialiste en management.
On nous interroge souvent pour savoir si le Brexit constitue une opportunité pour les institutions d’enseignement supérieur françaises. D’abord, nous ne saurions nous réjouir d’un événement qui ferme les frontières alors que nous préparons les jeunes à un entourage généralisé. Mais plus encore, nous pensons qu’il aura un effet paradoxal d’ouverture européenne consolidée des institutions britanniques.
Les cent cinquante établissements d’enseignement supérieur britanniques, signataires d’une lettre ouverte destinée en janvier aux membres du Parlement européen pour avertir sur les suites académiques, culturelles et scientifiques du Brexit, sont anxieux. En effet, il semble actuellement clair que le Brexit saurait avoir des suites majeures sur l’attractivité du système éducatif britannique.
Les suites se font déjà percevoir, comme en témoigne un nouvel article du mensuel Times Higher Education accentuant le déclin de réputation des grandes institutions britanniques. Si 450 000 étudiants internationaux regagnent chaque année le Royaume-Uni, avec à la clé plus de 14 millions de livres sterling qui participent au produit intérieur brut (PIB) national, ce chiffre pourrait fermement amoindrir.
D’abord, à cause d’une potentielle promesse pour les ressortissants étrangers d’avoir un visa de travail aux termes de leurs études au Royaume-Uni.
Programmes de recherche arrangement
Mais aussi à cause d’un accroissement plaisante des frais de scolarité compensant une attractivité en déclin à l’international. Toutefois, ces transformations ne sont pas nouvelles. Les conditions d’accès aux visas étudiants se sont durcies depuis quelques années déjà, sous l’élan d’ailleurs de Teresa May quand elle était secrétaire d’Etat à l’intérieur.
Autre crainte : l’attractivité auprès des enseignants-chercheurs. La sortie de l’Union européenne dominerait restituer en cause les programmes de recherche financés par des fonds européens au sein des universités britanniques, et obscurcir l’obtention de visas pour les professeurs étrangers. Deux effets collatéraux qui inquiètent les meilleures institutions, comme la London Business School et l’University of Exeter Business School.
Le journal britannique The Independent montre d’ailleurs qu’en 2017, plus de 2 300 universitaires européens ont abandonné des universités britanniques (+19 % par rapport). Avec 230 départs (contre 171 en 2014-2015), l’université d’Oxford correspond la plus grosse perte.





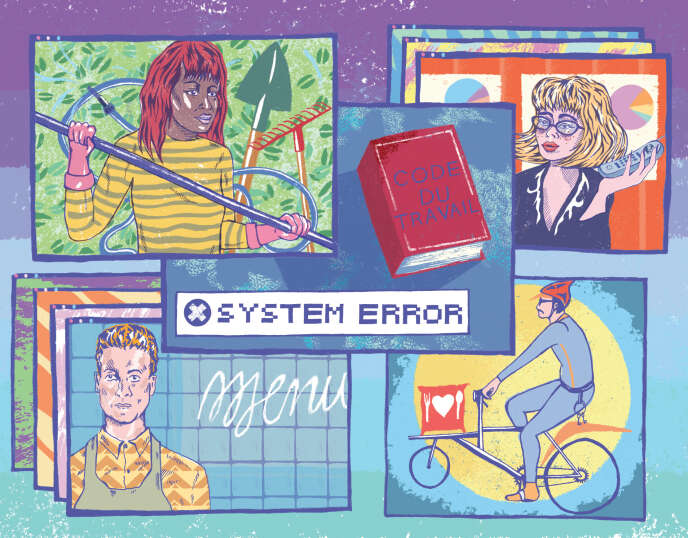



A 5 heures, mardi 9 avril, une partie des travailleurs de la rédaction digitale d’Europe 1 n’a pas éclairci ses ordinateurs, mais a restauré sur ses écrans sept feuilles blanches pour écrire « En grève ». L’issue de cesser le travail pendant 24 heures, mûrie durant le week-end, est appuyée par l’intersyndicale SNJ-CGT-CFTC.
#GreveE1fr : la rédaction numérique combat contre la #précarité à @Europe1 https://t.co/Y4l7YJevpy
— MartheRonteix (@Marthe Ronteix)
A l’origine de ce déplacement, le statut aléatoire d’une large partie de la narration numérique, un état de fait annulé de longue date par les équipes, qui sollicitent une acceptation des pigistes. Sur 30 journalistes, 14 sont utilisés sous ces contrats journaliers, ces journalistes travaillant « pour la grande majorité à temps plein depuis trois ans », regrette une gréviste, elle-même dans ce cas. Dans un sentiment, l’intersyndicale souligne qu’« ils remplissent les tableaux de service du 1er janvier au 31 décembre, sont à leur poste chaque jour de 5 heures à 23 heures, assurent une veille constante de l’actualité, enrichissent le traitement de l’info sur l’antenne par leurs analyses et leurs dossiers ».
Le réaménagement futur de la dissertation numérique inquiète pareillement, alors que la radio est déficitaire et soumise à un plan d’économies. Ce projet a été annoncé par la direction de la station, le 23 janvier, mais il n’a toujours pas été présenté. Cela fait craindre aux journalistes une « contraction » de leurs effectifs pour admettre à Europe 1, dont les audiences ne cessent de régresser depuis près de trois ans, de diminuer sa masse salariale.
Malgré les nombreuses explications demandées par la rédaction, le flou persiste. « Ce plan devait être présenté en détail fin février, mais on n’en sait constamment pas plus, déclare un pigiste. L’ambiance est pesante, on ne sait pas de quoi notre avenir sera fait. » Le contenu éditorial suscite les demandes. « Est-ce qu’on sera une simple vitrine de la radio ou un vrai site d’information », se questionne un journaliste. Dans une position, l’intersyndicale a demandé « à la direction d’apporter au plus vite la réponse que les [salariés indûment employés en contrats précaires] attendent, aussi bien sur la recyclage de leurs contrats que sur la clarification de la stratégie numérique de l’entreprise ». « C’est un combat que nous menons depuis des années », déclare Olivier Samain, délégué du Syndicat national des journalistes (SNJ) à Europe 1.
Fréquentée, la direction n’a pas convoité s’exprimer. En novembre 2018, le vice-PDG d’Europe 1, Laurent Guimier, avait développé vouloir engager la radio dans un nouveau modèle prenant en compte à la fois l’antenne traditionnelle, dite « linéaire », mais aussi les enceintes connectées et les podcasts avec l’ambition de être le « numéro un de la production audio pour le numérique ».
En 2017, le directeur d’Europe 1 de l’époque, Denis Olivennes, interpellé par les représentants syndicaux, avait lancé une vague de titularisations, portant d’abord sur 22 travailleurs, puis ensuite sur 30. Mais, accentue M. Samain, « il y a des endroits de l’entreprise, comme la rédaction numérique, où ce courant de CDIsation n’est pas passé ».