« La Team » : Deux ans d’idylle avec les Rastignac en Adidas
Le livre. Après vingt-sept ans passés tout en haut de la pyramide d’un grand groupe public à la culture très verticale, Bénédicte Tilloy a ressenti le besoin de changer. Pendant les trop longues réunions de travail, la membre du « comex » (comité exécutif) rêve d’aventures entrepreneuriales. « A force de lire et d’entendre raconter la légende des start-upeurs et eu la chance de rencontrer ceux d’entre eux qui avaient particulièrement bien réussi, je m’étais fait un petit film dans ma tête. Certes, cela tenait beaucoup du fantasme, mais cela me permettait de calmer ma frustration de ne pas voir certains projets avancer au rythme où je l’aurais voulu. »
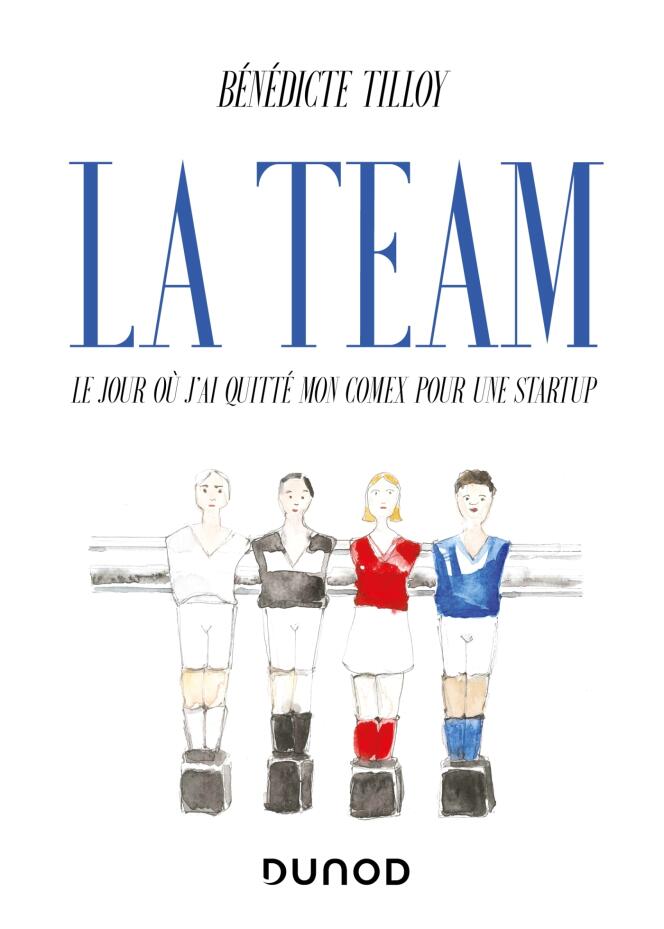
Ses élucubrations sont autant plus hardies que la DRH est loin de penser que l’occasion lui sera enfin donnée de se réaliser le jour où un remaniement d’état-major l’écarte provisoirement de ses fonctions : « Malgré les serments et les engagements que des opportunités nouvelles se présentent rapidement en interne, j’ai senti que me collerait bientôt à la peau l’étiquette de “vieille sage”, que l’on consulte pour des “missions de confiance” ». L’ancienne dirigeante de la SNCF troque alors ses escarpins contre des sneakers, et rejoint une start-up en pleine croissance, comme simple collaboratrice. Son ouvrage, La Team (Dunod) livre un récit drôle et nuancé de cette expérience.
Une fois tirée sa révérence, l’autrice se met à arpenter tous les hauts lieux de la « start-up nation ». « Comme une adolescente désœuvrée, j’ai traîné les “events” comme certains traînent les soirées ou les bars, sans intention précise que celle d’y faire des rencontres. »
Elle y croise un des cofondateurs de La Team, une jeune pousse en pleine expansion, qui lui propose de les rejoindre. « Le projet était tout sauf clair, mais la perche intéressante à saisir. Il s’agissait de partager le quotidien des premiers collaborateurs, de s’inspirer de l’esprit des lieux et de contribuer au développement business. »
« Pas douée pour faire renter la “caillasse” »
La quinquagénaire accepte, épouse les rythmes, les causes, les émerveillements et les galères de La Team. Elle observe parmi les clients de cette start-up des dirigeants « confrontés aux transformations de leur univers, et leurs collaborateurs, de toutes les fonctions de l’entreprise, grande ou petite, aux prises avec des silos parfois défendus bec et ongles par les mêmes qui s’en plaignent au quotidien. »
Si les prénoms et les domaines dans lesquels elle est intervenue ont été modifiés, les situations décrites dans son ouvrage restent très fidèles à la réalité. Les débuts de l’histoire sont à la hauteur de l’idylle imaginée. « J’ai adoré. Ni les sacrifices de rémunération ni la dégringolade de statut que j’ai consenti pour rejoindre l’équipe n’ont affecté mon enthousiasme. »
Il vous reste 27.63% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.








