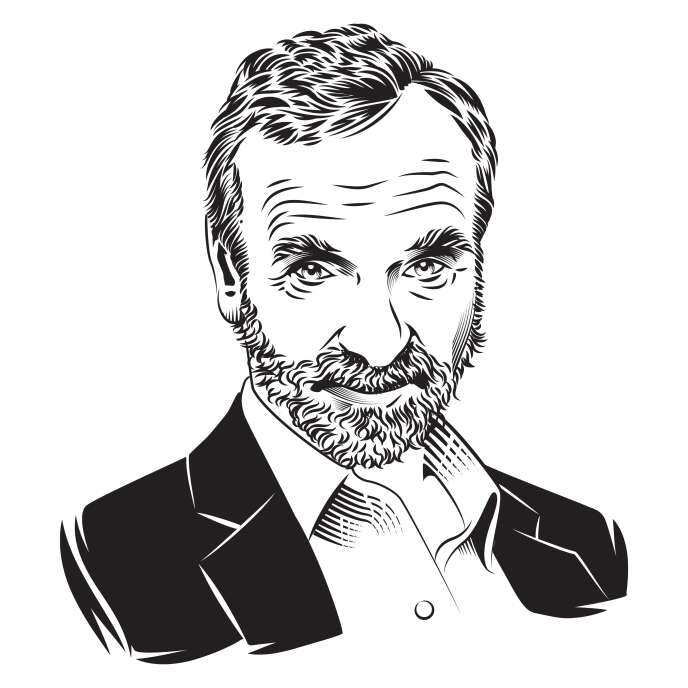« L’Europe que nous voulons »

Des ordonnances syndicales et patronales, dont la CFDT et le Medef, appellent simultanément les citoyens à se surnommer à l’occasion des élections européennes, le 26 mai, pour une Europe « indépendante, compétitive et solidaire ».
Parce que les élections européennes peignent un moment égalitariste clé pour l’avenir du projet européen et pour chacun des pays, nous, associés sociaux, nommons les citoyens à s’appeler et à voter pour supporter les valeurs fondamentales de l’Union européenne.
L’Europe que nous voulons indépendante, compétitive et solidaire doit engager des politiques ambitieuses qui ne se limitent pas à réparer les conséquences liées à la mondialisation, mais qui anticipent et conduisent les mutations technologiques et environnementales avec un budget à la hauteur des participations. Des politiques qui développent les droits sociaux, le dialogue social et la protection de l’environnement ; qui réunissent plus les régions à la mise en œuvre des investissements stratégiques (infrastructures, recherche et développement, compétences…) ; qui affirment un environnement économique loyal et stable, surtout ajusté aux TPE-PME (très petites entreprises, petites et moyennes entreprises).
Oui, l’Europe que nous ordonnons est un atout pour la France dans le monde. Elle se doit de combattre contre le dumping social, économique et environnemental afin de demeurer le continent offrant les systèmes sociaux les plus développés
L’Europe a besoin de politiques coordonnées pour bâtir une véritable stratégie économique et technologique, dans les domaines de l’énergie, des matières premières, de l’ouvrage, etc., et pour garantir son indépendance et protéger ses citoyens. Elle doit mener des politiques équitables, soucieuses des conditions de concurrence loyale sur le plan européen et international en matière de fiscalité, de droit du travail, ou de politique commerciale. L’Europe doit aussi conduire des politiques équilibrées, c’est-à-dire vigilantes quant à l’attachement des mesures sectorielles et à leurs suites, qui fassent la promotion des normes sociales et environnementales internationales (normes internationales du travail, Accord de Paris sur le climat, principes directeurs de l’OCDE, Objectifs du développement durable…).
Oui, l’Europe que nous voulons est un atout pour la France dans le monde. Elle se doit de lutter contre des adoptes déloyales et le dumping social, économique et environnemental afin de demeurer le continent offrant les systèmes sociaux les plus développés. Elle doit progresser sa productivité, sa croissance et l’emploi dans le but de raffermir son attractivité en tant que lieu d’investissement et d’embauche.