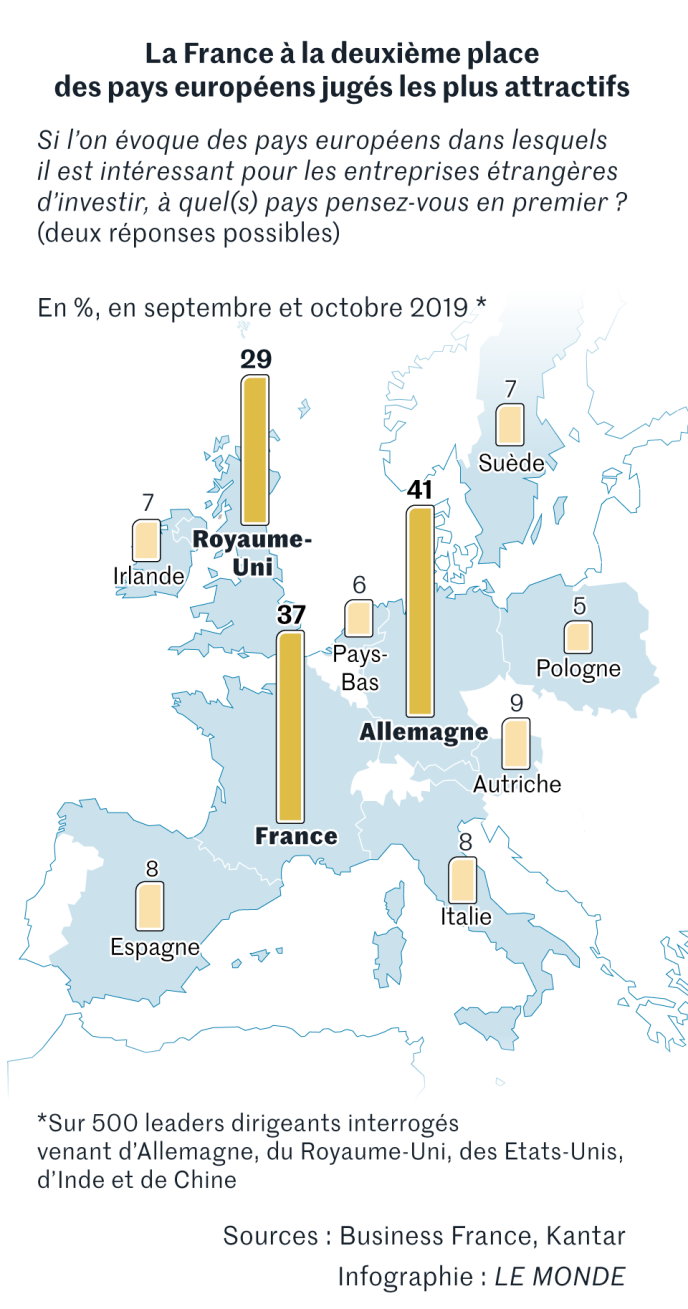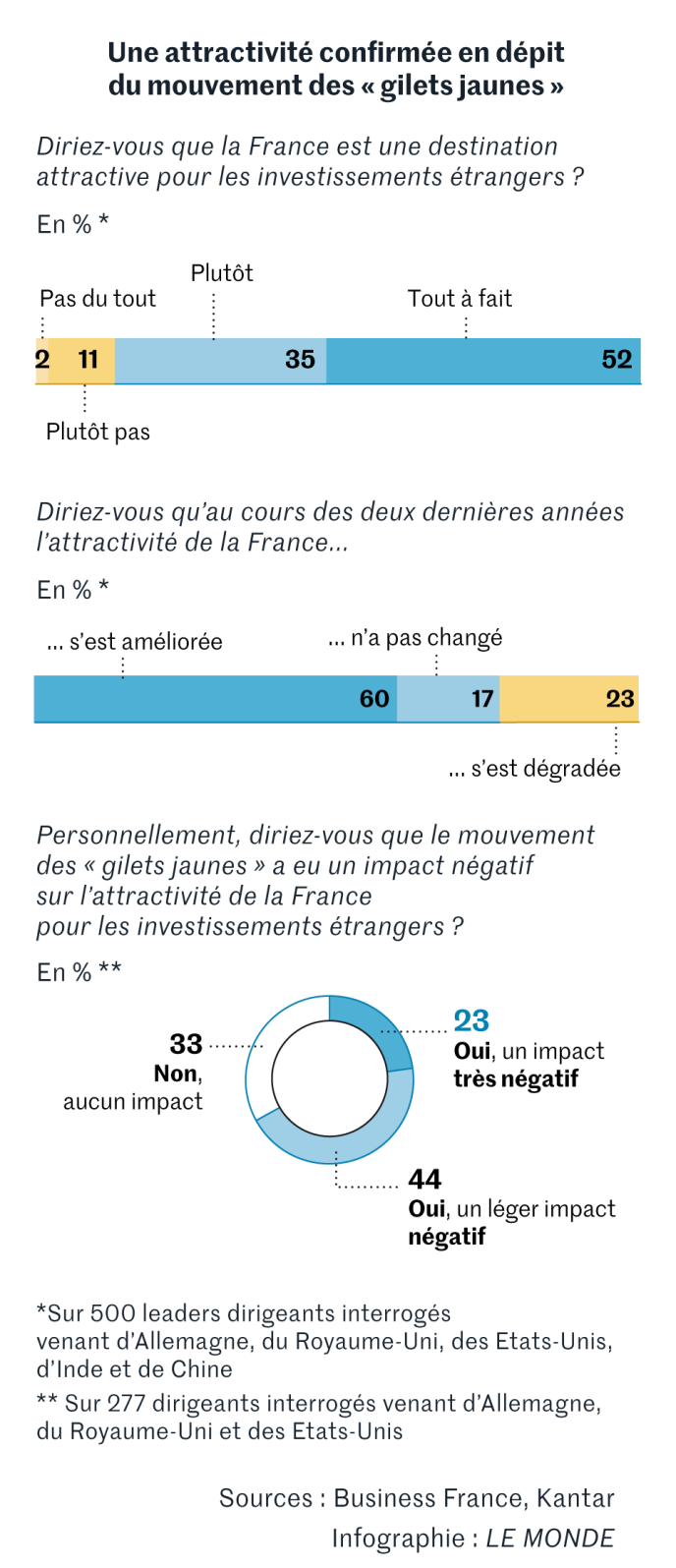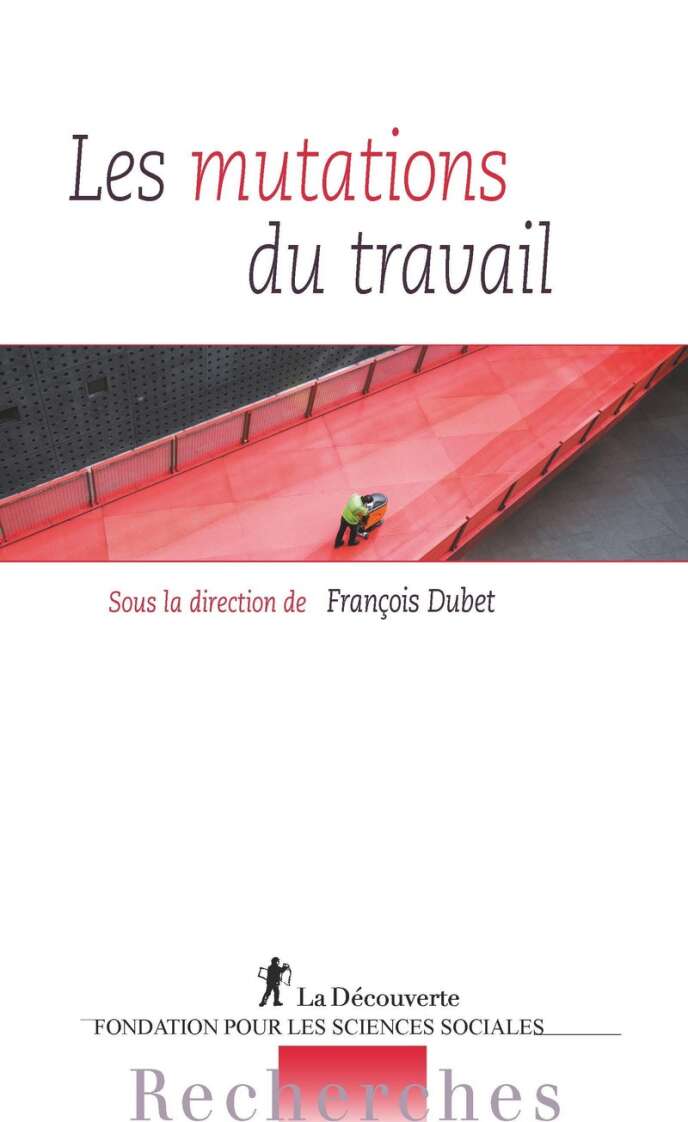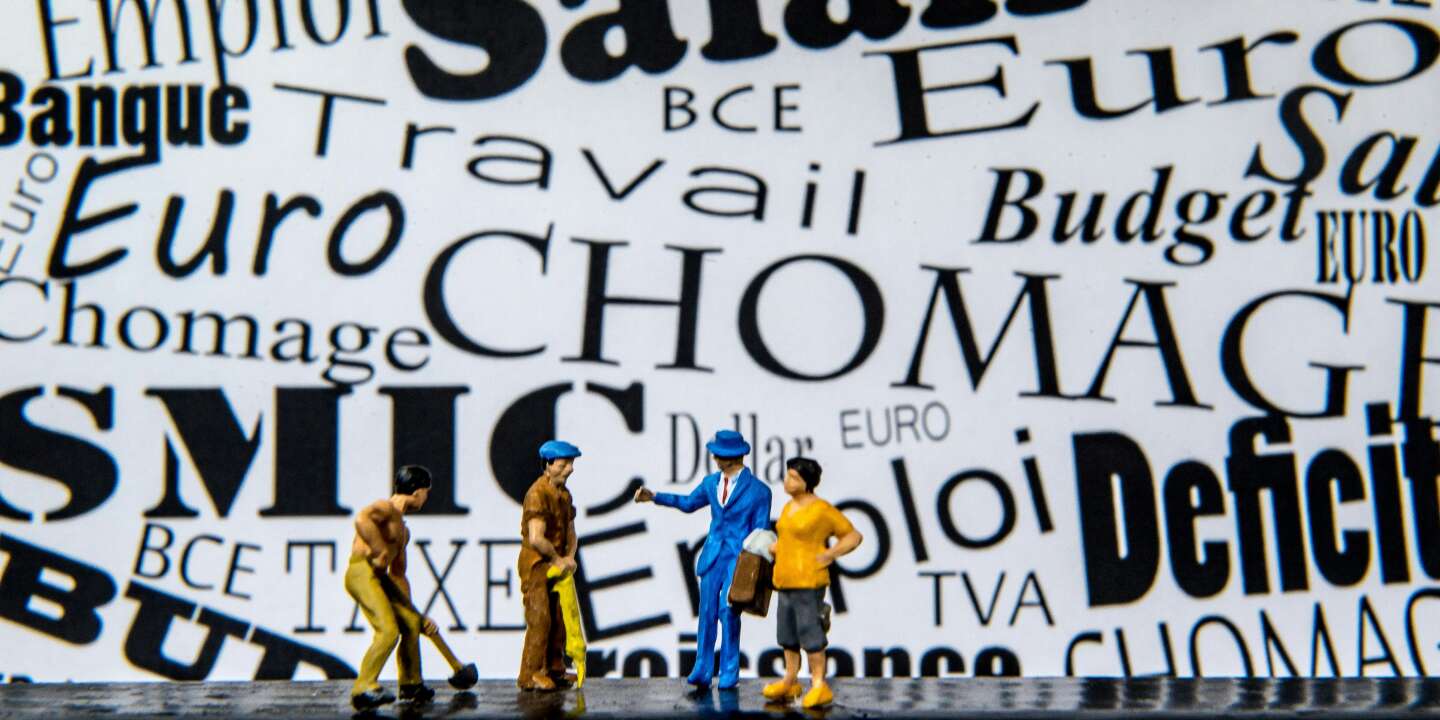« Le vieillissement et la mort en série des baby-boomeurs vont poser des questions vertigineuses »
Médecin spécialisée en cancérologie cutanée, qui a effectué toute sa carrière au CHU de Bordeaux, Michèle Delaunay a été députée PS de la Gironde de 2007 à 2012, puis ministre déléguée de François Hollande, chargée des personnes âgées et de l’autonomie, de 2012 à 2014. A 73 ans, elle vient de publier Le Fabuleux Destin des baby-boomers (Plon, 366 p., 20 €), un ouvrage très documenté et résolument positif dans lequel elle invite cette génération à abolir les barrières de l’âge et à faire la révolution de l’âge.

D’abord, qui sont les baby-boomeurs ?
C’est la génération correspondant à la période où la natalité a été la plus forte en France, avec entre 800 000 et 900 000 bébés chaque année. Tout le monde s’accorde pour situer son début en 1946, année où le nombre de naissances avait bondi de 200 000 par rapport à l’année précédente. C’est moins clair pour la fin. L’historien Jean-François Sirinelli la fixe en 1969 ; j’ai pour ma part retenu 1973, année après laquelle les naissances ont chuté de façon importante.
Ce qui est remarquable, c’est que 20 millions des 24 millions de personnes qui ont vu le jour dans cette tranche 1946-1973 sont encore en vie. Jamais une génération n’avait perdu aussi peu de ses enfants. Pour autant, les baby-boomeurs, qui ont donc aujourd’hui entre 46 ans et 73 ans, ne constituent pas une génération homogène. Il y a clairement eu deux vagues. La première, dont je fais partie, celle des « oiseaux du matin », nés avant 1955, a été élevée avec la marque de la seconde guerre mondiale, et dans une culture paysanne. La seconde est celle des « oiseaux de midi », qui ont connu dès leur enfance la publicité et la société de consommation. Les derniers d’entre eux ont aussi été davantage confrontés au rétrécissement du marché du travail. Le sociologue Serge Guérin a inventé un mot pour qualifier les boomeurs de la dernière heure : les « quincados », des quinquagénaires qui vivent comme des adolescents.
Alors que le débat sur la réforme des retraites est particulièrement houleux en France, vous vous prononcez dans votre livre pour un allongement du temps d’activité et qualifiez la retraite « à jour fixe » d’injustice…
Bien sûr, il faut tenir compte de la pénibilité de certains métiers, mais aujourd’hui, avec les progrès médicaux et l’augmentation de la longévité, la vieillesse avec invalidité est globalement décalée de vingt ans. Dans bien des cas, imposer une retraite à un âge fixe n’a plus de sens. Beaucoup de boomeurs se sentent en forme et souhaitent continuer à travailler. Pour ma part, si j’avais exercé un métier où l’on me mette dehors à 60 ou à 62 ans, j’aurais saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Le débat actuel porte sur l’âge légal et un âge pivot, mais, à l’inverse, si quelqu’un veut poursuivre son activité professionnelle au-delà de 65 ans, est-ce que sa retraite sera bonifiée ? Cette question n’est jamais posée.