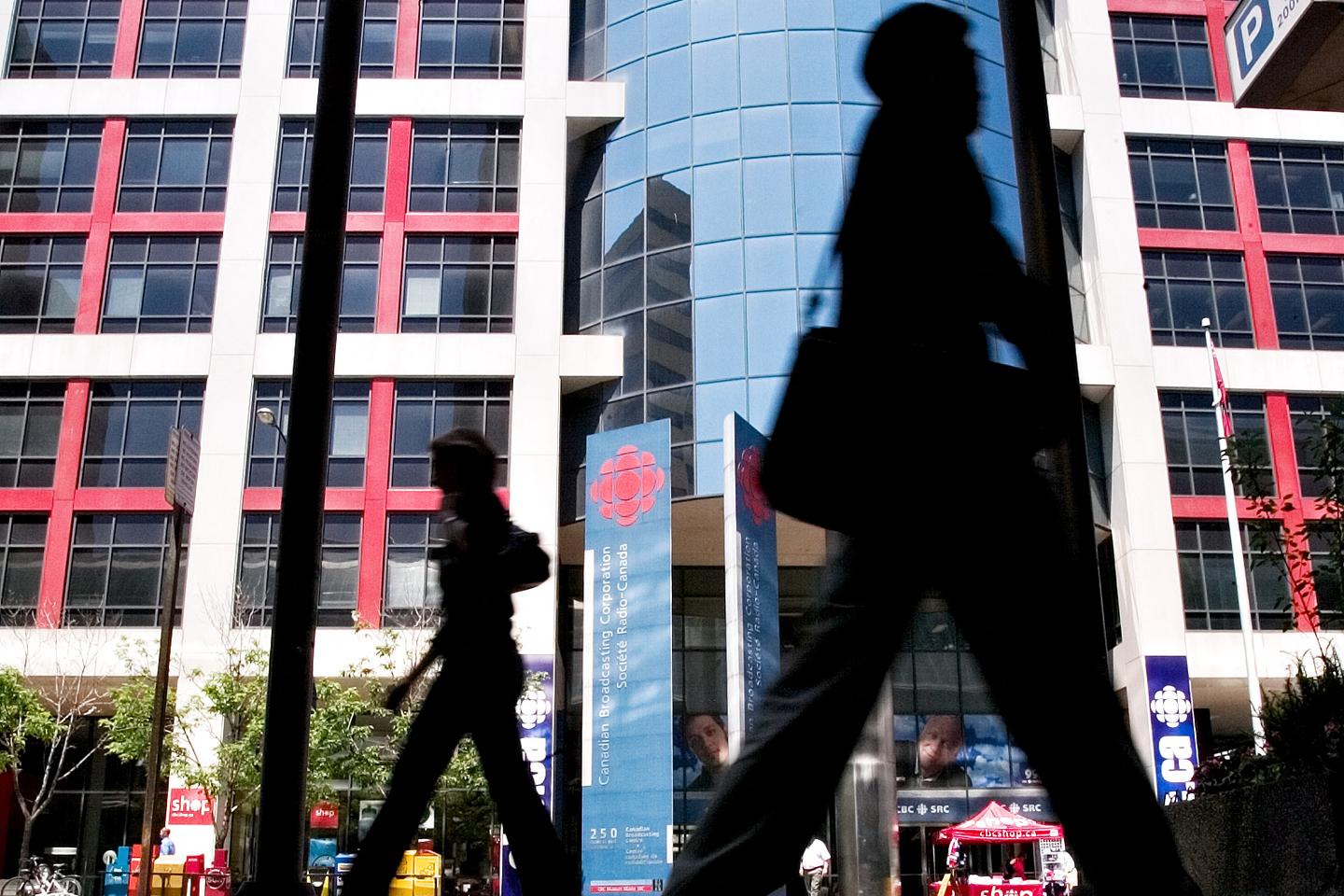Au Bangladesh, les ouvriers travaillent pour les marques occidentales contre un « salaire de pauvreté »

Debout, pieds nus, sur une table de travail tout en longueur, un ouvrier s’élance et déroule une grosse bobine de tissu bleu pour la déployer. L’étoffe flotte un instant dans les airs avant de retomber. Là, des carrés de taille identique seront découpés dans la fibre estampillée « made in China ». A l’étage supérieur de cette usine textile de Dacca, au Bangladesh, des vêtements de prêt-à-porter prennent forme aux sons mécaniques des machines à coudre. Des pantalons camouflage, des chemises en lin rouge et blanc, mais aussi de petits shorts en jean pour enfant s’entassent par dizaines. Les étiquettes des prix sont affichées en euros : 14,99 euros pour une chemise, 16,90 euros pour un chemisier. Ces vêtements fabriqués au Bangladesh pour environ un tiers du prix de vente garniront bientôt les rayons d’enseignes allemandes, espagnoles, italiennes ou encore néerlandaises.
Dans cette usine de l’entreprise APlus Group, située dans le quartier industriel de Mirpur, à Dacca, les ouvriers, dont 95 % sont des femmes, s’appliquent à la tâche. A la fin du mois d’octobre, pourtant, cette unité du groupe qui emploie 1 800 personnes est restée portes closes durant plusieurs jours. Des vitres ont été brisées et des véhicules endommagés, dégâts intervenus à la suite des violentes manifestations qui ont récemment secoué le secteur du textile. Des milliers de travailleurs étaient alors descendus dans les rues de Dacca et des banlieues industrielles, à Gazipur ou à Ashulia, pour réclamer la hausse du salaire minimum mensuel, établi jusque-là à 8 300 takas, soit environ 70 euros.
Les troubles, au cours desquels des dizaines d’usines ont été saccagées et quatre ouvriers ont été tués, ont brièvement paralysé ce secteur clé de l’économie bangladaise, qui fournit les grandes marques comme Zara, H&M, Primark ou Uniqlo.
Le pays n’avait pas connu un tel conflit social au cours de la dernière décennie. Les conditions désastreuses de travail des quatre millions de travailleurs bangladais du textile se sont encore dégradées depuis la pandémie de Covid-19. Frappés de plein fouet par une inflation galopante qui avoisine les 10 %, ils subissent également une dépréciation d’environ 30 % du taka par rapport au dollar, et il leur est devenu impossible de joindre les deux bouts.
« Auparavant, je mangeais de la viande, mais maintenant je me contente d’œufs et, quand je dois acheter des vêtements, je saute des repas pour pouvoir me les payer », confie Munir Hussain, une vingtaine d’années, chargé d’emballer des habits pour un salaire de 70 euros par mois dans une usine qui fournit notamment le français Kiabi. « Toutes mes dépenses sont fixes, le seul budget dans lequel je peux tailler lorsque j’ai des frais supplémentaires, c’est celui qui est consacré à la nourriture », explique le jeune homme, qui a participé aux manifestations pour l’augmentation des salaires.
Il vous reste 75% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.