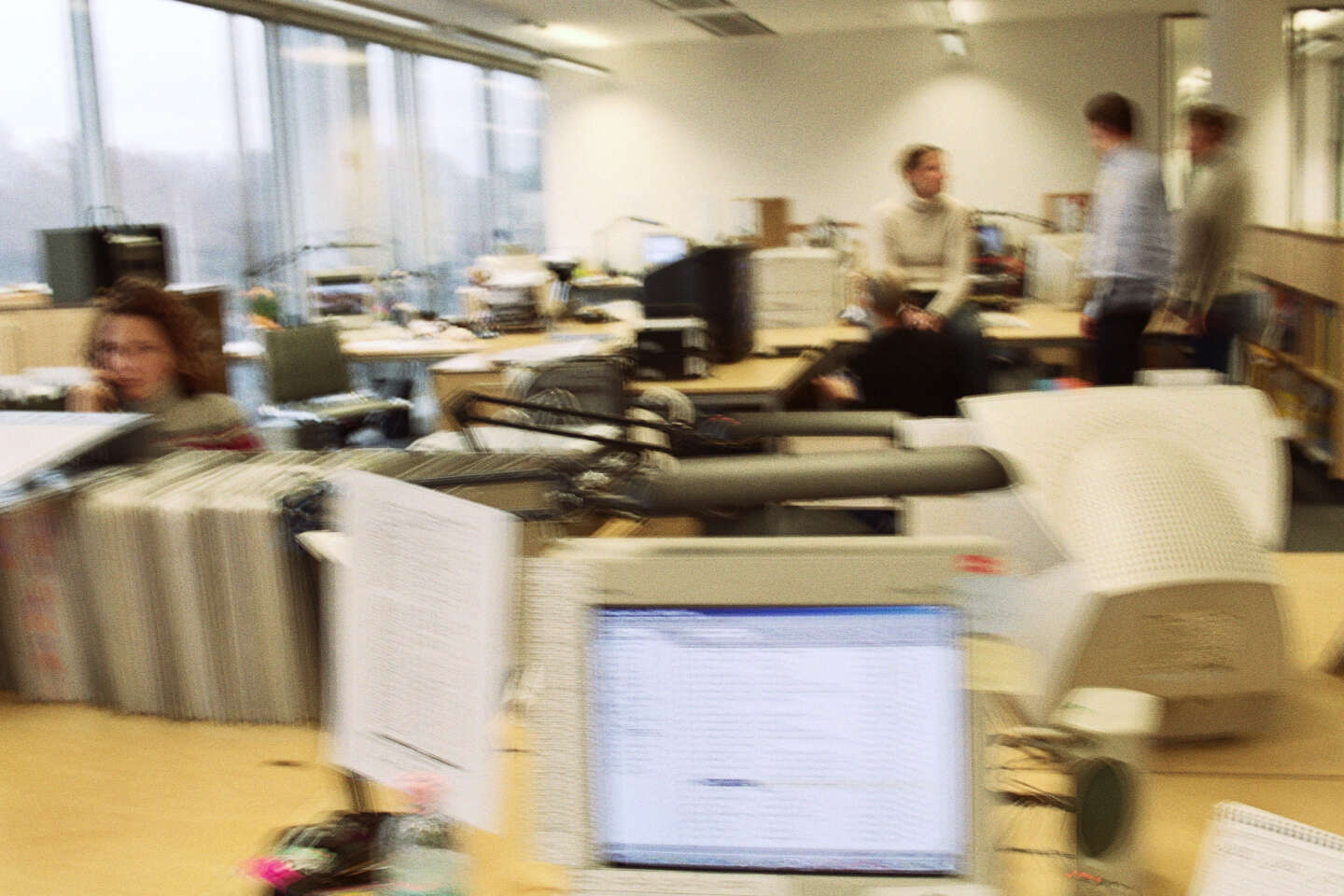Plafond d’indemnisation pour licenciement abusif : le Conseil de l’Europe conclut à la « violation » par la France de la Charte sociale européenne

Un nouveau revers pour le « barème Macron » ? Le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe (CEDS) a rendu publique, lundi 26 septembre, sa décision sur le bien-fondé du barème Macron. Comme le révélait Le Monde à la mi-juin, le Comité considère que le plafonnement des dommages et intérêts accordés par la justice au salarié en cas de licenciement injustifié constitue une « violation » de l’article 24 de la Charte sociale européenne, portant sur « le droit à la protection en cas de licenciement ».
Entré en vigueur par la voie des ordonnances de 2017, le barème Macron limite à vingt mois de salaire maximum les indemnités dues en cas de licenciement abusif (hors cas de harcèlement ou de discrimination).
Il supprime aussi le plancher de six mois minimum d’indemnités pour les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté. Ce dispositif continue à être régulièrement remis en question devant les tribunaux. Au niveau européen, la CGT et Force ouvrière (FO) avaient saisi le CEDS pour contester la validité de ce barème.
Le CEDS leur a donné raison. Dans sa décision, il indique que « les plafonds prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur ».
En outre, le CEDS considère que la « prévisibilité » résultant du barème « pourrait plutôt constituer une incitation pour l’employeur à licencier abusivement des salariés ». Pour asseoir sa décision, il se réfère à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui prévoit qu’une réparation « adéquate » doit être accordée au salarié abusivement licencié.
L’inconnue du Conseil d’Etat
Si cette décision pointe du doigt la France pour non-respect de ses engagements en tant que signataire de cette charte, elle n’invalide pas pour autant le barème Macron au regard du droit français, considère Me Déborah Attali. « Le comité n’a pas de pouvoir en réalité ; il n’a pas la capacité de changer la loi française ou de sanctionner les Etats qui ne respectent pas la charte européenne, constate cette avocate associée chez Eversheds Sutherland et chargée du département droit social du bureau de Paris. Tout ce que peut faire le comité, c’est constater l’existence d’une non-conformité. C’est ensuite aux juridictions nationales d’agir et de changer la loi, les textes… pour être conformes à la charte européenne. Mais si le gouvernement ne souhaite pas modifier la législation, le barème restera applicable. »
D’autant qu’il a déjà été validé par les plus hautes juridictions françaises, à savoir le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation, dans un arrêt de mai 2022. « Il y avait déjà des décisions semblables du CEDS pour la Finlande et l’Italie ; dans ces pays, la politique sur les barèmes n’a pas été modifiée », ajoute son collègue Me Nicolas Etcheparre, du même cabinet.
Il vous reste 25.46% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.