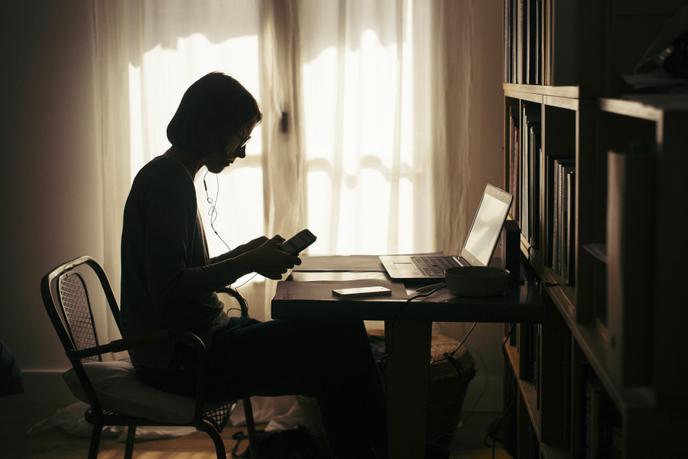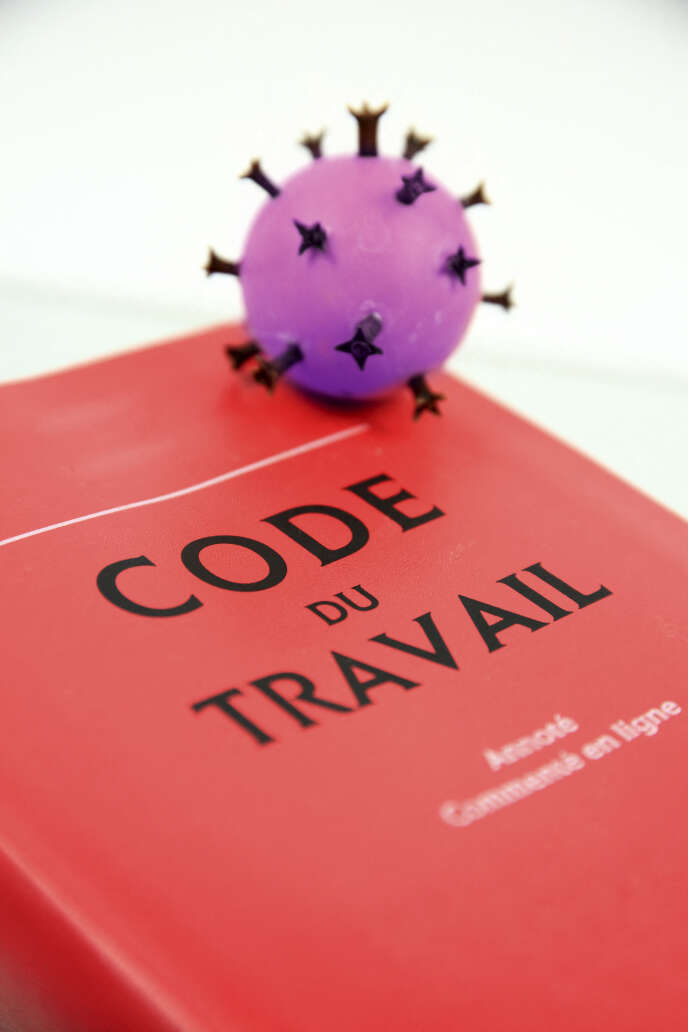S’il y avait le moindre doute sur l’ampleur de la crise économique en cours, la Banque centrale européenne (BCE) et une série d’indicateurs économiques y ont mis fin, jeudi 30 avril. Christine Lagarde, la présidente de l’institution monétaire, prévoit une récession « entre – 5 % et – 12 % » pour la zone euro, en 2020. « La contraction est d’une magnitude et d’une vitesse sans précédent », a-t-elle expliqué, lors d’une conférence de presse donnée par vidéo.
Au premier trimestre, le recul du produit intérieur brut (PIB) est effectivement historique, selon les données publiées jeudi : – 3,8 % dans la zone euro (le pire depuis la création de cette série statistique en 1995), dont – 5,8 % en France (le pire depuis la création de cette série statistique en 1949), – 5,2 % en Espagne, – 4,7 % en Italie… Ces chutes vertigineuses sont le résultat du confinement, qui n’a pourtant été imposé que graduellement courant mars. Le deuxième trimestre, avec un confinement presque complet de tous les pays sur l’ensemble du mois d’avril, sera bien pire : « les indicateurs pointent vers – 15 % d’un trimestre sur l’autre » pour la zone euro, a continué Mme Lagarde.
Dans le brouillard
Tous les signaux sont au rouge. « Au début, seuls certains secteurs étaient sévèrement affectés, a observé la présidente de la BCE. On parlait du tourisme, du transport, du divertissement… Et puis, graduellement, des secteurs entiers de l’économie ont été tout simplement fermés. Ca commence tout juste à se voir dans les statistiques, avec les premiers chiffres du premier trimestre. »
Pour la suite, les indicateurs de la consommation sont « en chute libre », le marché du travail s’est « profondément détérioré », le déclin est visible « dans le secteur manufacturier mais aussi dans le secteur des services »… En Allemagne, a souligné Christine Lagarde – qui s’exprimait devant une salle de presse vide – 718 000 entreprises ont recours au chômage partiel. En France, 425 000 sociétés, couvrant plus de dix millions d’employés, sont concernées. En Italie, six millions de salariés sont dans la même situation.
La présidente de la BCE a ajouté qu’elle est dans un brouillard complet sur la suite à attendre pour l’économie européenne. Combien de temps dureront les confinements ? L’épidémie due au coronavirus sera-t-elle contrôlée ? Les restaurants et les hôtels rouvriront-ils, et à quelle échéance ? Les consommateurs oseront-ils y retourner ? « Ca rend notre travail de prévision de l’économie extrêmement difficile », a-t-elle précisé.
L’incertitude est la même en ce qui concerne l’inflation, estimée par Eurostat à 0,4 % en avril en zone euro, contre 1,7 % un an plus tôt. Au premier abord, la région semble donc s’approcher de la déflation. Mais, derrière cette statistique, se cache une réalité très diverse. D’un côté, les prix de l’énergie s’effondrent, reflet d’un marché pétrolier qui a implosé ces dernières semaines. De l’autre, les prix alimentaires s’envolent (+ 3,6 %), en particulier pour les produits frais (« aliments non transformés »), qui flambent à + 7,7 %.
« Une pause »
Dans ces conditions catastrophiques, l’institution de Francfort n’a pas pris de grande mesure, ce jeudi, mais elle a affiché sa détermination à continuer à soutenir l’économie européenne. En mars, dans l’urgence, elle avait annoncé un « plan pandémie » consistant à acheter pour 750 milliards d’euros de dette des Etats jusqu’à la fin de l’année.
Dans ce cadre, elle dépense environ 5 milliards d’euros par jour. A ce rythme, l’enveloppe sera épuisée à l’automne. La BCE a donc tenu à rassurer les marchés, se disant « tout à fait prête à augmenter la taille [du plan pandémie] et à ajuster sa composition, autant et aussi longtemps que nécessaire ».
Par ailleurs, la BCE a effectué l’équivalent d’une nouvelle baisse de son taux d’intérêt. Désormais, les banques qui augmentent leurs prêts auprès des entreprises, et en particulier des PME, pourront se financer à – 1 %, contre – 0,75 % jusqu’à présent. En clair, la Banque centrale les subventionne, à condition qu’elles fassent tourner l’économie. Cette mesure doit permettre aux établissements bancaires européens d’économiser environ 3 milliards d’euros, selon les calculs de Frederik Ducrozet, spécialiste de la BCE à Pictet, une banque privée.
Avec cette conférence de presse, l’institution monétaire « a marqué une pause », fait savoir Marchel Alexandrovich, économiste à la banque Jefferies. C’était attendu, l’annonce du plan pandémie en mars ayant permis de calmer les marchés. Ceux-ci tablent maintenant sur de nouvelles mesures d’ampleur lors de la réunion du mois de juin, peut-être avec une augmentation du plan pandémie à 1 000 milliards d’euros, voire plus. D’ici là, l’ampleur des conséquences économiques sera peut-être un peu plus claire.
Cela laisse du temps aux Etats européens pour agir. Ces derniers demeurent en désaccord sur la possibilité de mutualiser une partie de leurs dettes, peut-être avec la création d’un fonds spécial en commun. « Une politique ambitieuse et coordonnée des Etats est essentielle », a rappelé Mme Lagarde, qui leur demande d’aller « plus loin ». Après l’intervention décisive de la BCE le mois dernier, la balle est désormais dans le camp des gouvernements européens.
Notre sélection d’articles sur le coronavirus