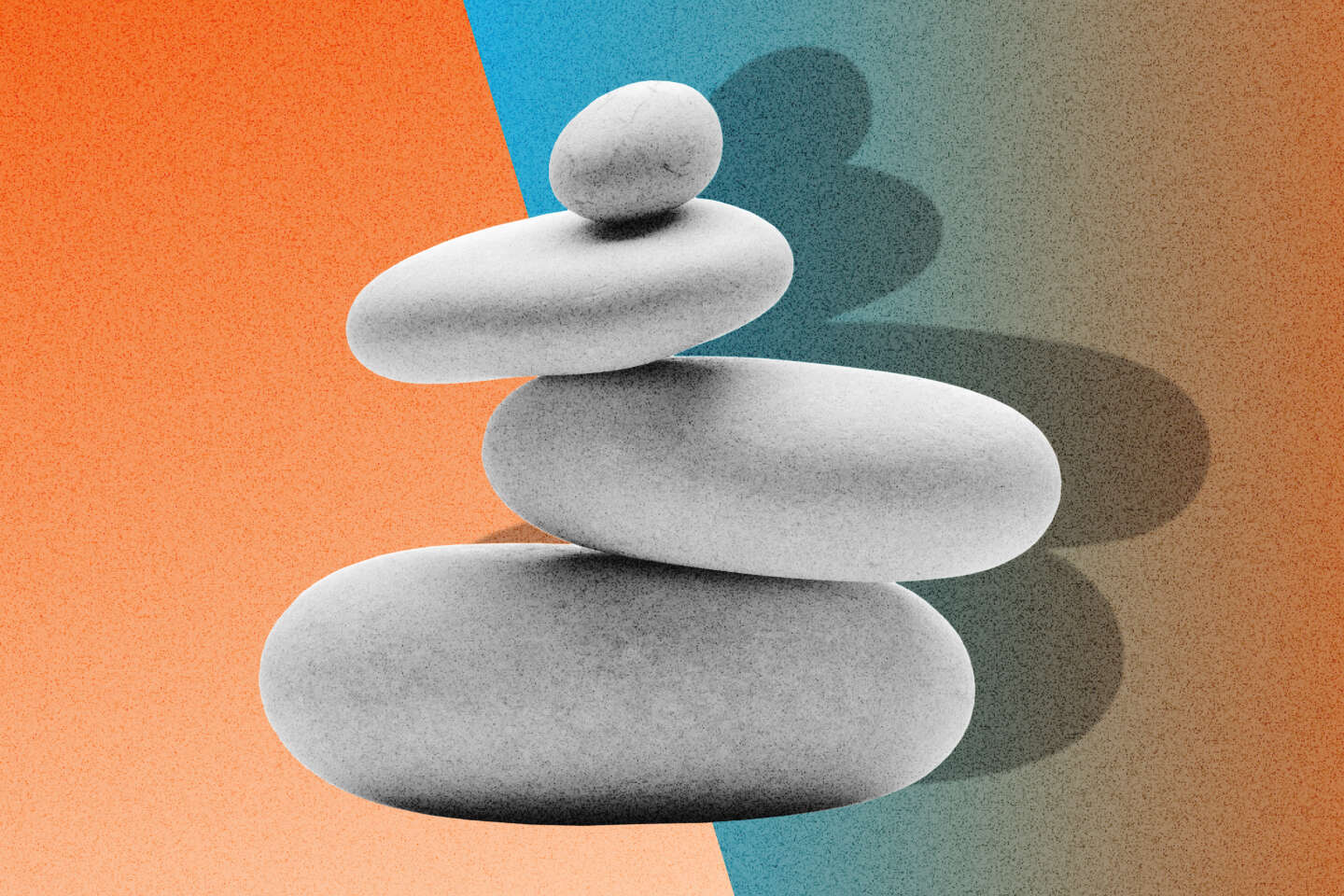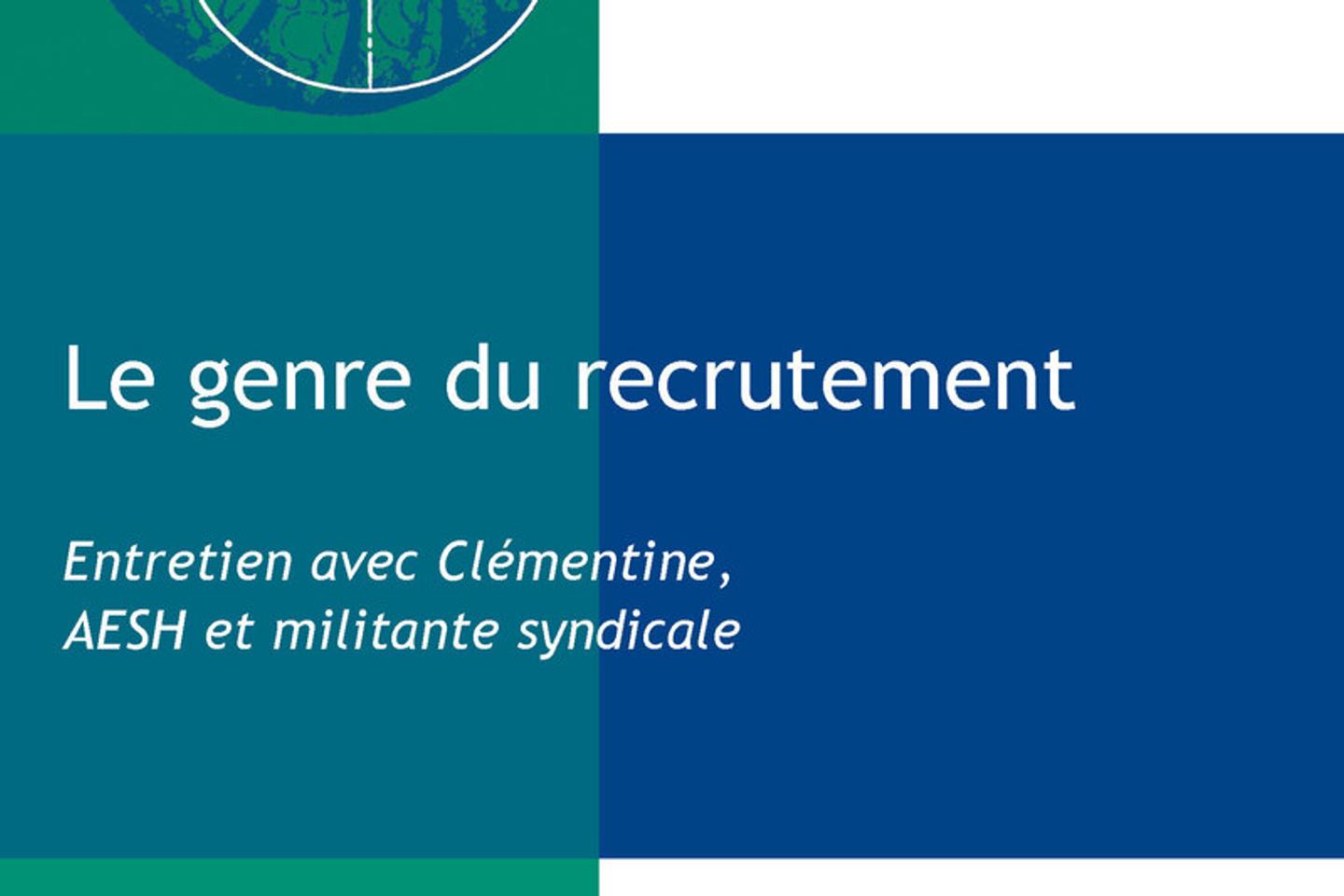Une captation du CPF par les entreprises ?
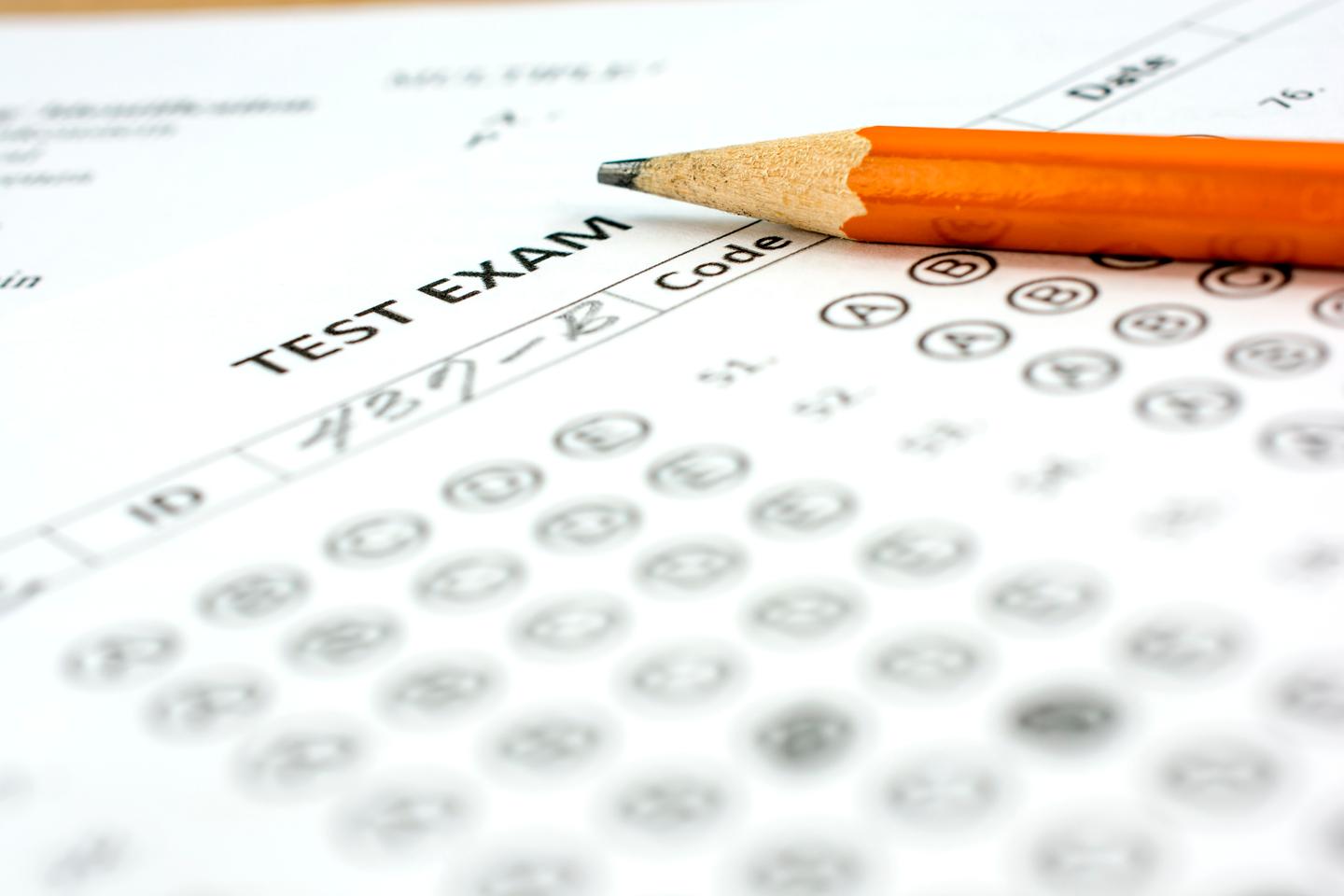
2 476 euros, c’est le coup de pouce donné en moyenne par les entreprises aux salariés pour compléter le budget disponible sur leur compte personnel de formation (CPF). Cette dotation représente la moitié du coût pédagogique de leur formation. Ainsi, 250 millions d’euros ont été versés par les entreprises depuis 2020 pour abonder les CPF.
C’est ce que révèlent les chiffres d’une note de « Questions politiques sociales » de la Caisse des dépôts sur « Les dotations des employeurs sur les comptes personnels de formation » publiée le 18 juin. Le groupe chargé de la gestion du dispositif voit dans ce premier bilan un « intérêt croissant des entreprises pour le dispositif et [le] fort levier qu’il représente pour la formation de leurs salariés ».
« Il existe un encouragement fort du gouvernement pour développer le CPF comme outil de la coconstruction des parcours professionnels, de la fidélisation, de la reconversion, a expliqué Axel Rahola, le directeur adjoint des politiques sociales de la Caisse des dépôts, pour présenter ce bilan. Mais cette pratique de cofinancement encouragé ne remet pas en cause l’esprit du dispositif. »
La question mérite toutefois d’être posée. Le CPF a été créé en 2014 pour redonner la main aux salariés sur leur formation professionnelle. Initialement attaché à l’individu et non à l’entreprise, il a depuis été réorienté vers les employeurs, qui commencent à l’utiliser comme une brique complémentaire à leur plan de formation, surtout dans les entreprises de plus de 250 salariés, et dans le cadre de politiques de dotation très individualisées : pour l’année 2023, en moyenne 3,3 salariés sur 10 000 en ont bénéficié.
Les seniors restent sous les radars
Depuis le 5 septembre 2024, l’employeur a même la possibilité de flécher sa dotation sur une certification donnée. Responsabilité bancaire (conseil en clientèle, conseil patrimonial), test d’anglais (Toeic), « les formations les plus suivies [de 2020 à 2023] par les bénéficiaires d’une dotation employeur portent sur les métiers bancaires », indique Elise Kayser, coautrice de l’étude avec Marième Diagne, qui précise que « si l’on ne peut pas établir de lien de causalité entre formation et parcours professionnel, l’analyse des bénéficiaires ayant fini leur formation en 2022 indique que 79 % d’entre eux travaillent toujours dans la même entreprise ».
Il vous reste 29.05% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.