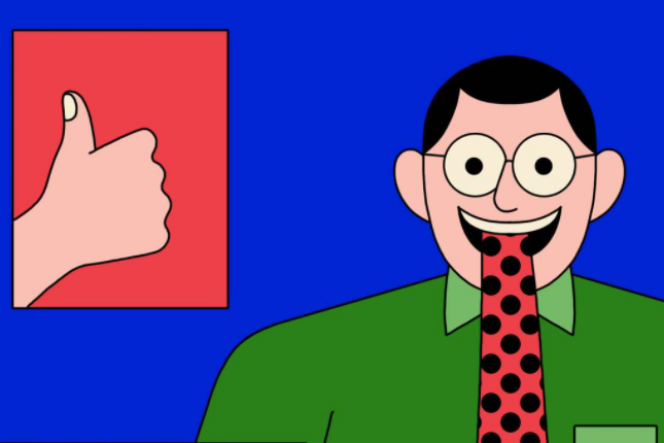« La réforme de l’assurance-chômage est injuste, absurde et indécente »

Tribune. Nous, associations et organisations syndicales de salariés, avions vigoureusement réagi contre la réforme de l’assurance-chômage, lorsqu’elle avait été annoncée en juin 2019 par le gouvernement. Du fait de la crise sanitaire, certains points de cette réforme avaient été opportunément mis en sommeil et les plus optimistes d’entre nous pouvaient les croire abandonnés. Le gouvernement vient pourtant d’annoncer sa mise en œuvre au 1er juillet 2021. Cette entrée en vigueur, alors même que la crise sanitaire est loin d’être terminée et que ses conséquences sociales, déjà lourdes, ne vont aller qu’en s’accentuant, est à la fois injuste, absurde et indécente.
Injuste, parce qu’elle va frapper des personnes déjà fragilisées, qui comptent parmi celles qui ont été les plus touchées par la crise sanitaire et sociale. Selon les chiffres de l’Unédic, dès le 1er juillet 2021, 1,15 million de personnes vont voir leurs droits baisser drastiquement, en moyenne de 17 %, et jusqu’à 40 % pour les 400 000 les plus précaires. Les plus touchés seront justement celles et ceux qui ont des contrats courts ou espacés.
A une date encore non précisée, d’autres mesures devraient durcir l’accès aux droits, notamment par un relèvement du seuil d’accès à l’indemnisation, en exigeant une période de six mois travaillés, contre quatre aujourd’hui. Là encore, les plus touchés seront les travailleurs précaires, en particulier les jeunes de moins de 26 ans.
Absurde, notamment parce qu’elle intervient au pire moment. Les analyses du conseil scientifique du Conseil national de lutte contre l’exclusion sont éloquentes : elles montrent, d’une part, que les personnes les plus pauvres − notamment les personnes au chômage − ont été les plus durement touchées par les conséquences sociales de la crise sanitaire ; d’autre part, que de multiples couches de la société ont basculé ou vont basculer dans la pauvreté, la crise agissant comme un « descenseur social » ; enfin, que la force de notre système de protection sociale a évité une catastrophe pire encore.
Et c’est à ce moment, alors que nous sommes encore au cœur de la troisième vague de l’épidémie, que le gouvernement va, par son action même, accentuer les effets de la crise et faire plonger dans la pauvreté des personnes qui auraient pu rester la tête hors de l’eau si l’on avait maintenu le dispositif d’assurance-chômage.
Processus de stigmatisation
Indécente, enfin. Avant même la crise sanitaire, le pouvoir d’achat des ménages les plus pauvres avait déjà diminué, du fait notamment du gel des allocations-logement, des prestations familiales et du RSA ; les inégalités sociales s’étaient sensiblement creusées. La crise a accentué ce phénomène, les ménages les plus aisés pouvant épargner, quand les 10 % les plus pauvres ont dû le plus souvent s’endetter.
Il vous reste 45.29% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.