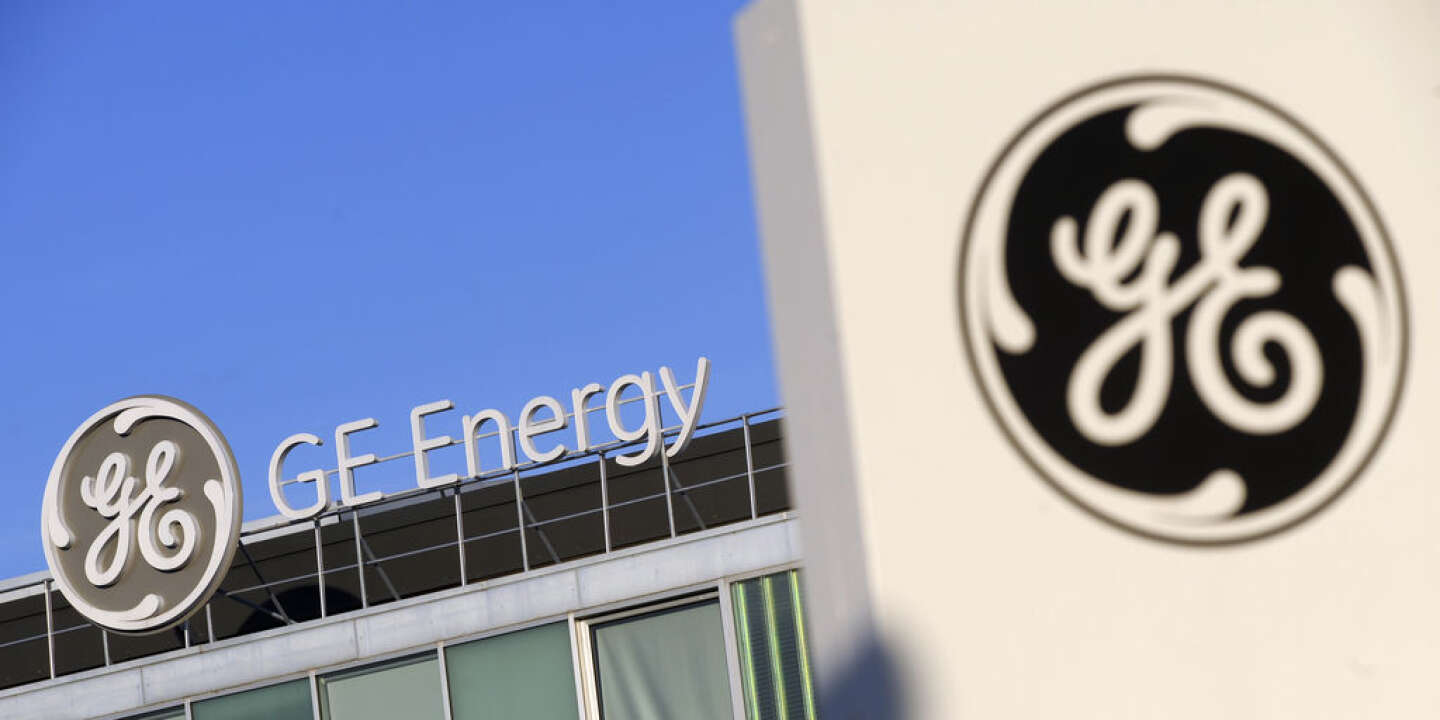Le plan d’économie et la diminution de personnel de Radio France

Diminution de la participation de l’Etat, augmentation des charges et développement du digital : la présidente Sibyle Veil doit trouver 60 millions d’euros d’économies d’ici 2022.
La tension est grimpée d’un cran lundi 3 juin à Radio France. La directrice du groupe de radio publique, Sibyle Veil, a présenté au conseil d’administration et aux organisations syndicales son plan « Radio France 2022 ». Si la actualisation des métiers vers le digital, la création de podcasts ou d’une offre jeune ont été abordées, c’est surtout le plan d’économies présenté par la présidente qui est au cœur des inquiétudes.
Actuellement, pas question d’annuler des antennes. Par contre, Radio France, qui a un budget de 650 millions d’euros, devra trouver 60 millions d’euros en trois ans. En effet, l’Etat envisage d’amputer ses ressources de 20 millions d’euros. En outre, le groupe qui chapeaute France Inter, Franceinfo ou France Culture, devra soutenir 20 millions d’euros d’augmentation mécanique des charges, et dégager 20 millions additionnels pour se développer dans le numérique. Des sommes qu’il faudra compenser.
Premier budget à subir de la réforme, la masse salariale, qui pèse 61 % des dépenses, et qu’il va falloir diminuer de 25 millions d’euros, soit 6 % du total. « Je suis assez en colère dans la mesure où ces efforts demandés viennent après d’autres coups de rabots déjà réalisés, s’insurge Jean-Paul Quennesson, délégué SUD de Radio France. 25 millions, c’est tout simplement irréaliste. Nous voulons une expertise. »
A peine le chiffre a-t-il été invoqué que la perspective d’un plan de départ, qui n’a pas encore été clairement évoqué, est déjà dans les esprits. Sur Twitter, le syndicat national des journalistes (SNJ) a compté que 25 millions représentaient 285 postes, alors que le groupe emploie 4 600 personnes. Pour le moment, la présidente n’a témoigné aucune réduction d’effectifs. Dans un premier temps, c’est l’organisation qui doit être revue, en l’occurrence le temps de travail, avec en perspective une révision du nombre de jours de congés, afin de faire descendre le nombre de contrats courts.
Faire évoluer les compétences en interne
Contradictoirement à France Télévisions, qui a renouvelé une partie des équipes en faisant entrer de nouveaux talents, Sibyle Veil préfère faire transformer les compétences en interne. L’accent va donc être mis sur les formations, qui vont tripler en trois ans.
En plus des économies salariales, Radio France désire faire entrer 20 millions d’euros supplémentaires dans ses caisses, dont 8 millions grâce à la publicité et 6 millions issus du mécénat. Le groupe veut également mettre à la disposition de tiers son savoir-faire et ses infrastructures de production. « Cette activité de studio va se faire au détriment de la création maison. C’est un piège extraordinaire », se révolte Jean-Paul Quennesson, aussi corniste au sein de l’orchestre national de France, une formation de Radio France.
En interne, on comprend mal pourquoi le gouvernement désire encore voir la radio économiser alors que les audiences sont admissibles – France Inter a même dépassé RTL au premier trimestre – et que, grâce aux efforts déjà engagés, Radio France devrait être à l’équilibre cette année. En prévoyant, Sibyle Veil veut aller vite, et envisage un accord de méthode, qui doit particulièrement fixer un calendrier clair, pour le mois de juin, et une contestation sur le chantier social entre septembre et décembre. Les employés lui en donneront-ils les moyens ? En 2015, une grève de vingt-huit jours – la plus longue de l’histoire de la radio – avait freiné les ardeurs de son prédécesseur Mathieu Gallet.