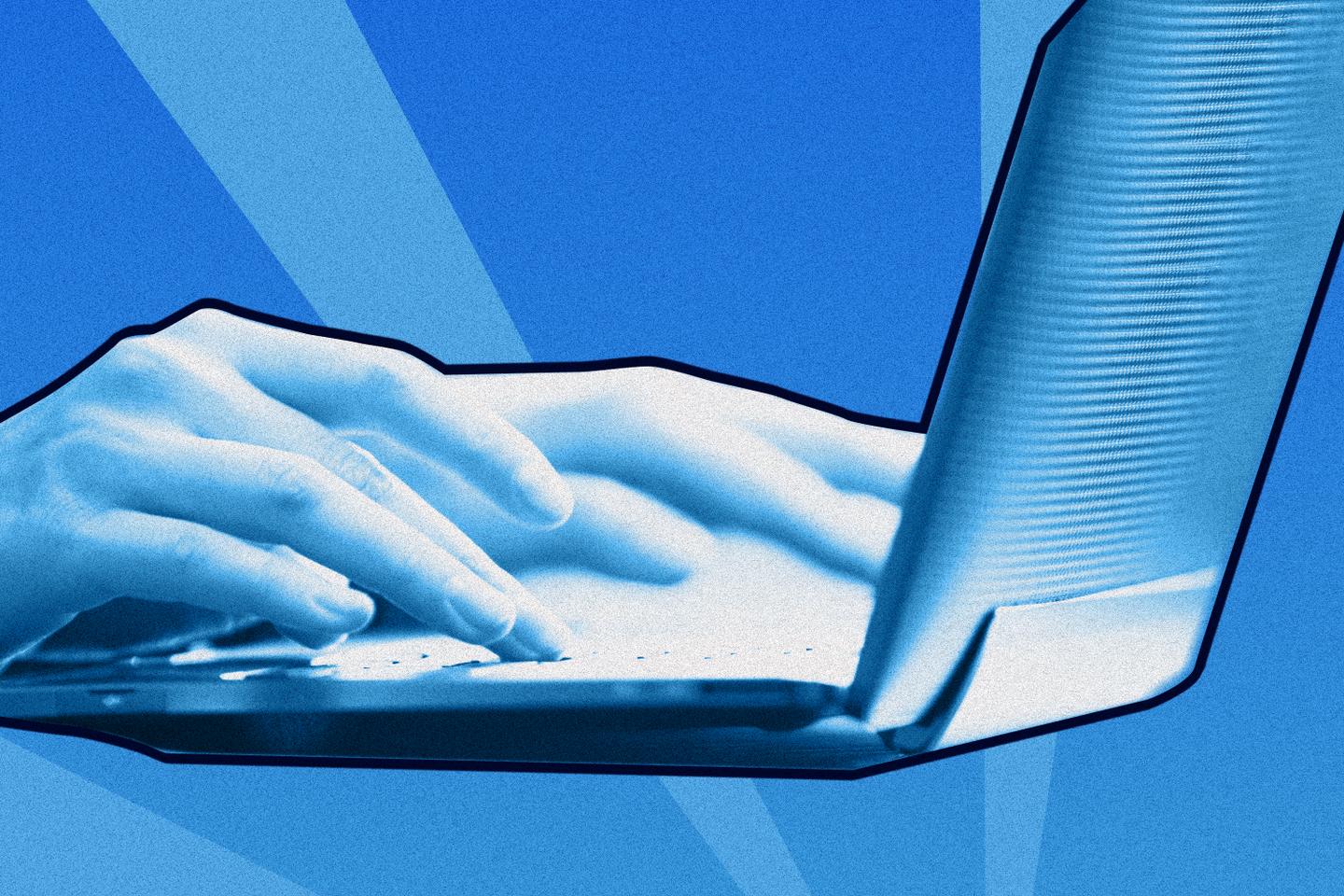Les RH cherchent à encadrer l’usage de l’IA par leurs salariés, entre surveillance et éducation

Au salon VivaTech, qui s’est tenu à Paris à la mi-juin, l’intelligence artificielle (IA) a mis des étoiles plein les yeux aux chercheurs, aux recruteurs et aux ingénieurs, enthousiasmés par les dernières innovations. A l’aide de l’IA générative, bien loin des Alpes, L’Oréal cultive des edelweiss et des plantes asiatiques menacées de disparition ; la RATP gère ses machines autolavantes ; Bouygues construit toujours plus vite grâce à l’analyse accélérée des données par l’IA.
Mais ce fut aussi l’occasion pour les entreprises de rappeler, tel un mantra, que l’accompagnement des salariés est essentiel, d’autant plus que la prise en main des outils est plus rapide que la formation des salariés. Seul un cadre sur quatre a déjà bénéficié d’une formation à l’IA, indique l’Association pour l’emploi des cadres.
S’agit-il de surveillance, de contrôle ou d’encadrement ? « On n’en est pas au flicage, parce que les entreprises n’ont pas encore conscience de tout ce que les salariés peuvent faire avec l’IA », remarque Mickaël Vandepitte, directeur produit RH de la PME Septeo. Mais le manque de culture IA et de maîtrise des outils est une nouvelle source de risques. « L’IA s’est démocratisée brutalement, avec une crainte légitime des entreprises de fuite d’informations, voire d’espionnage économique », remarque Benoît Serre, ancien vice-président de l’Association nationale des DRH.
« Les chargés de clientèle, constatant que ça leur facilite la vie, n’attendent pas d’être formés. On a eu au début des fuites de données de type “manuel d’utilisation”, reconnaît Nourdine Bihmane, DG de Konecta, une multinationale spécialisée dans l’expérience client. Elles ont été réglées par la mise en place de contrôles techniques et par de l’éducation au fonctionnement des outils. » Pour encadrer l’usage, les responsables des ressources humaines élaborent des règles, des chartes, des modes de contrôle et des politiques de sensibilisation consacrées à l’« éducation » des effectifs.
Il vous reste 71.85% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.