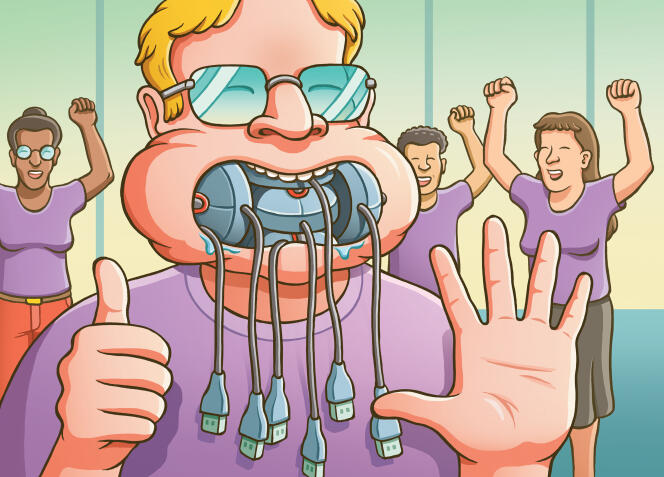Avant le 1er-Mai, Philippe Martinez appelle le gouvernement à préférer les hausses de salaires aux aides ponctuelles

Les salaires, l’emploi, les retraites. Dans un entretien court et dense avec Le Parisien, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, appelle au rapport de force avec le gouvernement sur ces trois sujets, à la veille de la traditionnelle mobilisation syndicale du 1er-Mai.
Pour lui, la priorité est d’augmenter tous les salaires, et notamment de porter le smic à 2 000 euros brut, bien au-delà des 1 645 euros prévus à partir de dimanche. M. Martinez déplore qu’en matière de pouvoir d’achat, le gouvernement insiste surtout sur le dispositif de la prime versée par l’employeur et les aides ponctuelles :
La prime Macron reste au bon vouloir du patronat. Et les retours que nous avons nous disent que personne n’a touché le maximum prévu. Et beaucoup de salariés n’ont rien touché. Il faut des choses plus contraignantes. Les primes mettent du beurre dans les épinards mais elles sont bien souvent dépensées tout de suite. Or l’année fait douze mois !
« Problème de qualité de l’emploi »
Quant aux aides ponctuelles, « tous ceux qui sont dans la galère ne crachent pas sur des chèques », concède-t-il, mais « le problème du pouvoir d’achat est pérenne : la meilleure aide, c’est d’augmenter les salaires ». A ses yeux, l’exécutif peut également « agir, en tant qu’Etat employeur, sur le point d’indice des fonctionnaires ». Après les débrayages chez Amazon, Dassault ou Thales, « il faut que ces grèves se généralisent dans tous les secteurs pour exiger des augmentations de salaires », selon Philippe Martinez.
Au sujet de l’emploi, « l’autosatisfaction du gouvernement n’est plus possible », dénonce le dirigeant syndical, qui alerte sur « un développement de la précarité et un problème de qualité de l’emploi ». Du fait du mode de calcul, « on considère que travailler une journée ou une semaine dans le mois, ça fait baisser les chiffres [du chômage]. Mais peut-on payer son loyer et manger correctement quand on travaille une semaine par mois ? », demande-t-il.
Concernant enfin l’une des mesures phares prévues par Emmanuel Macron, « nous n’irons pas parler de la retraite à 65 ans », déclare tout net Philippe Martinez.