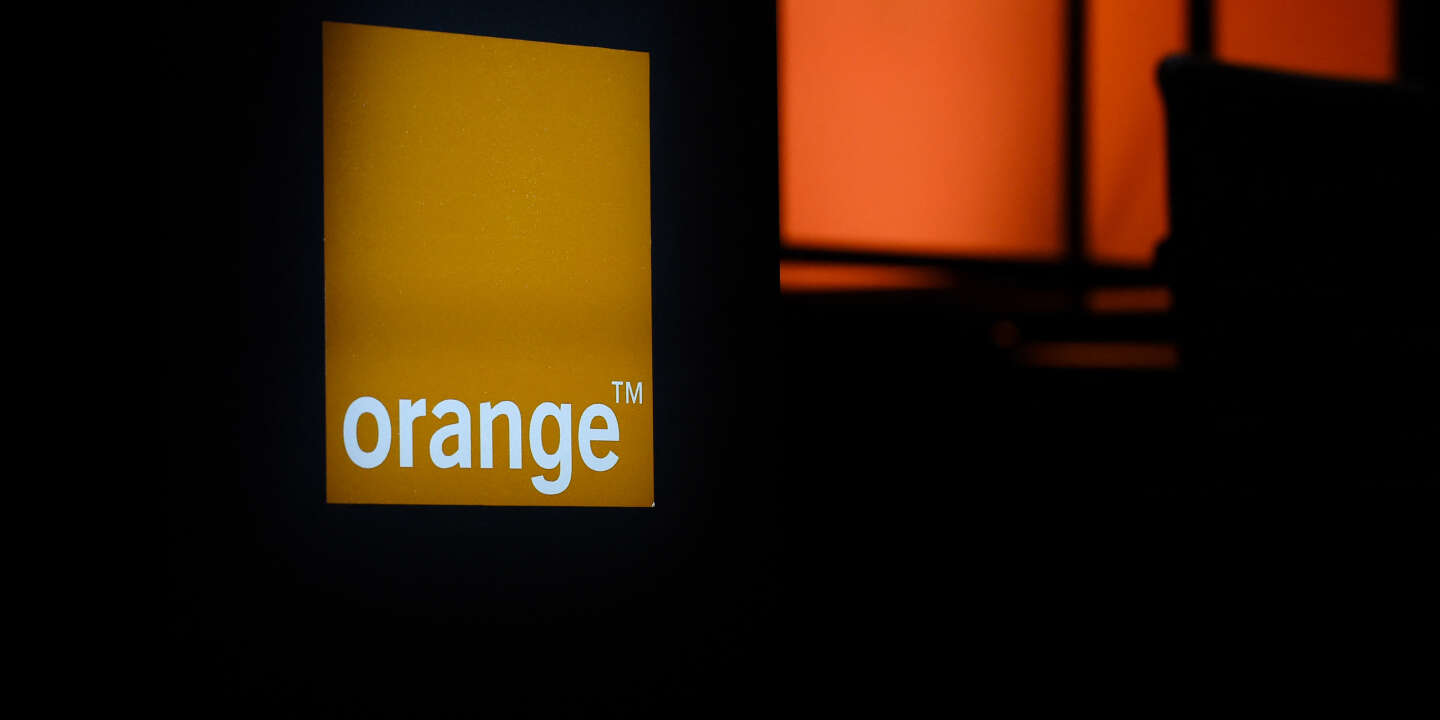« Les entreprises sont face à une occasion de redéfinir la manière dont elles partagent avec leurs salariés la valeur qu’ils contribuent à créer »

Tribune. Après de longs mois de pandémie, le contexte économique moribond a laissé place à une situation économique nouvelle : retour de l’inflation, hausse des cours de l’énergie, problèmes d’approvisionnement, voire pénuries. Parallèlement, sur le marché de l’emploi, la reprise économique est marquée par une baisse du chômage, mais avec une forte tension sur l’embauche, notamment celle des profils techniques et des cadres.
La réponse politique du gouvernement est claire : les entreprises sont appelées à augmenter les salaires pour préserver le pouvoir d’achat et renforcer l’attractivité des entreprises qui peinent à recruter. Les branches sont, quant à elles, attendues pour négocier en tenant compte d’une reprise de l’activité économique au niveau d’avant crise.
Dans ce contexte, tous les indicateurs concordent pour que les demandes des salariés soient exigeantes. Les négociations annuelles obligatoires 2022 promettent d’être tendues !
Contrairement aux idées reçues, les dispositifs variables peuvent s’appliquer à presque tous les postes, dès lors qu’il est possible de mesurer une performance ou de l’évaluer
En effet, la perspective d’une augmentation généralisée peut faire peur aux entreprises par son coût mécaniquement important, pour une efficacité difficile à mesurer, tant en matière de rétention des talents que de capacité à les attirer. Il est plus que jamais l’heure de s’intéresser à des dispositifs encore sous-utilisés par les entreprises.
A la différence du salaire fixe, qui rémunère la tenue de poste, les compétences et expériences acquises, la rémunération variable récompense une performance attendue par l’entreprise. Elle est donc par nature différenciante, car elle rétribue ceux qui ont contribué réellement à la performance.
Elle est efficace si l’on s’assure que les modalités de cette rémunération sont équitables. Cela suppose donc de trouver les bons indicateurs, de s’assurer qu’ils sont bien disponibles en temps voulu et fiables. Cela suppose aussi d’avoir fixé les objectifs en tenant compte du potentiel de chacun permettant ainsi de donner à toutes et à tous les mêmes chances de gagner la prime proposée.
Contrairement aux idées reçues, ces dispositifs variables peuvent s’appliquer à presque tous les postes, dès lors qu’il est possible de mesurer une performance ou de l’évaluer. Aujourd’hui, les entreprises du secteur de la logistique demandent, elles aussi, de déployer des plans de rémunération variable à destination de préparateurs de commandes et de caristes. L’objectif poursuivi est de motiver les salariés à donner le meilleur d’eux-mêmes. Cela permet de libérer des budgets conséquents sous réserve d’un objectif atteint. La rentabilité pour l’entreprise est ainsi améliorée et le coût de l’enveloppe en partie absorbé.
Il vous reste 36.54% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.