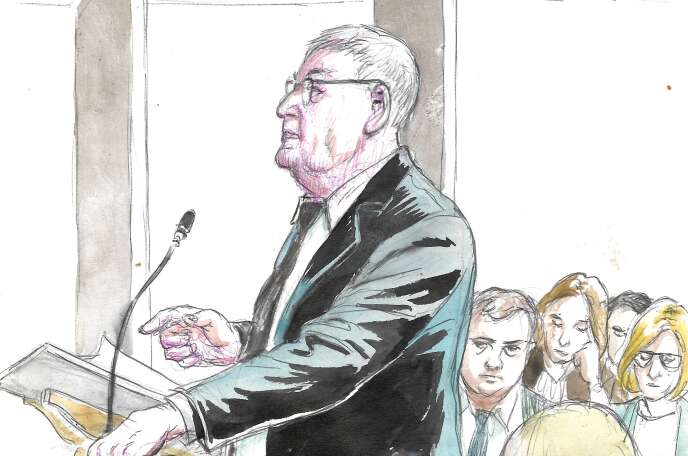1879 La Société de constructions mécaniques (SACM) s’installe à Belfort.
1928 La SACM s’allie avec Thomson-Houston et devient Alsthom.
Années 1970 Déclenchement des programmes nationaux nucléaires et TGV.
1998 Entrée en Bourse sous le nom d’Alstom.
1er janvier 2001 Première mention de l’article L151-3 dans le code monétaire et financier (CMF). Les investissements étrangers accomplis en France et liés à la sécurité publique et à la défense nationale réclament l’autorisation préalable du ministre de l’économie.
11 mars 2003 Patrick Kron devient PDG d’Alstom.
7 juillet 2004 L’Union européenne valide la renationalisation partielle négociée entre Patrick Kron et Nicolas Sarkozy, ministre de l’économie. L’Etat français recapitalise à hauteur de 720 millions d’euros. Bouygues rachètera l’association de l’Etat en 2006.
21 juin 2006 Nomination à la présidence de General Electric (GE) France de Clara Gaymard, ex-présidente de l’Agence française pour les investissements internationaux et épouse d’Hervé Gaymard, plusieurs fois ministre sous Jacques Chirac.
2010 Le Department of Justice américain (DoJ) commence une enquête anticorruption.
2012 Des rumeurs continues font état de la volonté de Bouygues de céder sa participation (29,4 %) dans Alstom. Au 31 décembre 2017, Bouygues détient 28% d’Alstom.
23 octobre 2012 L’Agence de participation de l’Etat, menée par David Azéma, commande au cabinet AT Kearney une étude considérant les avantages et les inconvénients d’un changement d’actionnaire pour Alstom.
14 avril 2013 Arrestation aux Etats-Unis de Frédéric Pierucci, haut dirigeant d’Alstom. Trois autres cadres supportent le même sort : David Rothschild, William Pomponi et Lawrence Hoskins. Les deux premiers plaident coupables pour faits de corruption.
9 février 2014 Patrick Kron dîne à Paris avec le PDG de GE, Jeff Immelt. Les discussions pour vendre la branche énergie d’Alstom sont initiées.
10-12 février 2014 Lors de la visite d’Etat de François Hollande aux Etats-Unis, Clara Gaymard rappelle avec le ministre de l’économie Arnaud Montebourg une possible vente de la branche énergie d’Alstom, sans lui préciser, semble-t-il, que les discussions ont débuté quelques jours plus tôt.
23 avril 2014 L’agence de presse Bloomberg dévoile que GE discute avec Alstom du rachat de sa branche énergie pour 12,05 milliards d’euros. Stupeur d’Arnaud Montebourg, qui dit ne pas avoir été mis au courant.
27 avril 2014 Joe Kaeser, le PDG de Siemens, présente de reprendre la branche énergie d’Alstom et, en réponse, de céder au français une grande part de sa division ferroviaire.
14 mai 2014 Arnaud Montebourg fait passer un décret « relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable » désignant l’article L151-3 du code monétaire et financier.
20 juin 2014 Ouvrage de trois coentreprises entre Alstom et GE : les réseaux et les énergies renouvelables sont à 50 % – 50 % +1, le nucléaire à 20 % – 80 %.
25 août 2014 Emmanuel Macron remplace à Arnaud Montebourg au ministère de l’économie.
28 octobre 2014 Les syndicats européens d’Alstom concèdent la cession de la branche énergie (15 pour, 7 contre et 12 neutres).
4 novembre 2014 Signature des accords d’alliance entre GE et Alstom.
19 décembre 2014 l’AG des possédants d’Alstom valide à 99,2 % la vente de la branche énergie à GE.
22 décembre 2014 Alstom, suspecté de corruption par la justice américaine, plaide fautif et doit payer une amende de 772 millions de dollars (637,5 millions d’euros à l’époque).
11 mars 2015 Estimé par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale au sujet de la cession à GE, Emmanuel Macron déclare que le gouvernement a été mis devant le fait terminé. Auditionné à son tour, Patrick Kron écarte tout lien entre la vente et l’enquête du DoJ.
8 septembre 2015 La Commission européenne donne son feu vert à la vente.
13 janvier 2016 GE annonce 6 500 cessions de postes en Europe dans le périmètre d’Alstom.
31 janvier 2016 Patrick Kron quitte Alstom, et Clara Gaymard GE.
Février 2016 Pour considérer sur la renégociation du contrat d’entretien de ses turbines, GE suspend pendant quelques jours la maintenance des centrales nucléaires EDF en France. Furieux, le PDG d’EDF Jean-Bernard Lévy envoie un courrier, le 3 mars, au patron de GE.
8 novembre 2016 Patrick Kron devient président du fonds français de capital-risque Truffle Capital. Le même jour, le conseil d’administration d’Alstom lui accorde une prime insolite de 4,45 millions d’euros qui n’inclut ni ses stock-options ni sa retraite chapeau.
22 septembre 2017 Alstom réaffirme des discussions avec Siemens en vue d’un approche de leurs activités ferroviaires. Les actionnaires d’Alstom approuvent la prise de contrôle par Siemens le 17 juillet 2018.
25 octobre 2017 Création d’une commission d’enquête parlementaire sur les conclusions de l’Etat en matière de politique industrielle, notamment le cas d’Alstom.
6 décembre 2017 GE annonce l’abandon de 12 000 emplois dans le monde.
14 juin 2018 John Flannery, le patron de GE, déclare qu’il ne tiendra pas sa promesse de créer 1 000 emplois en France d’ici à la fin 2018.
25 septembre 2018 Libération de Frédéric Pierucci.
2 octobre 2018 Alstom accomplit la cession à GE de toutes ses collaborations dans les trois coentreprises.
17 octobre 2018 Larry Culp, le nouveau patron de GE, confirme au ministre de l’économie Bruno Le Maire que GE paiera la pénalité de 50 millions d’euros en cas de non-création des 1 000 emplois. Le 30 octobre, il déclare une perte de 20 milliards d’euros et une restructuration de la division énergie.
31 octobre 2018 La Commission européenne expose ses inquiétudes quant à la fusion entre Alstom et Siemens. L’exécutif européen s’est donné jusqu’au 18 février 2019 pour saisir sa décision.
Pour tout savoir sur l’affaire Alstom