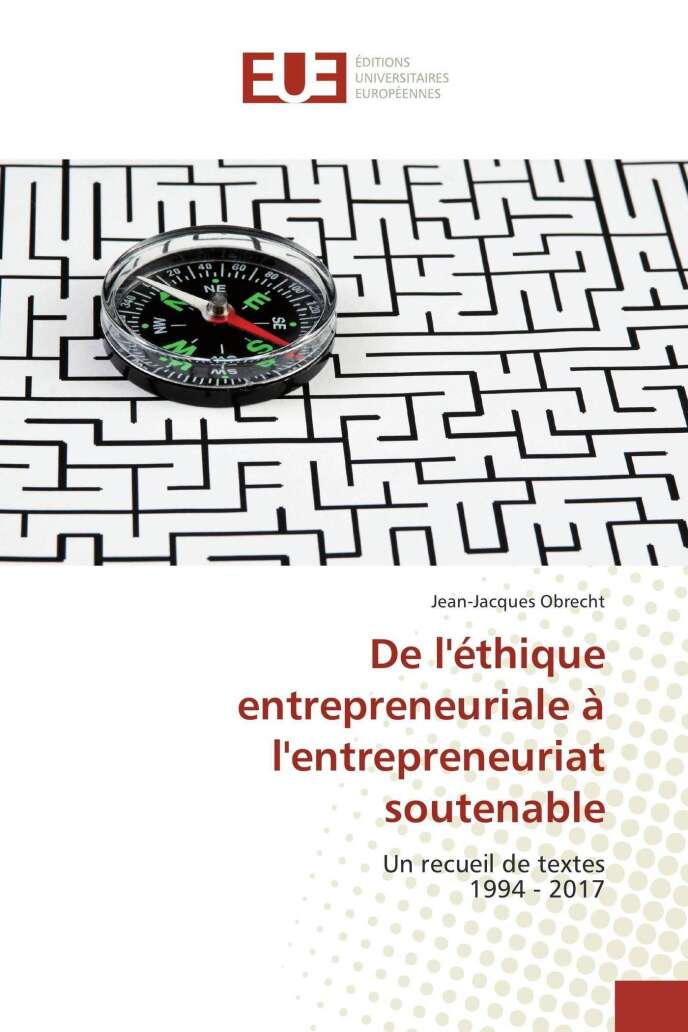Coronavirus : la « prime Macron » pourra atteindre 2 000 euros

La « prime Macron » pourra finalement atteindre 2 000 euros. Et les entreprises intéressées qui verseront cette prime défiscalisée pourront la moduler en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie, selon l’ordonnance adoptée, mercredi 1er avril, en Conseil des ministres. « Afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de Covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra également être retenu par l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur mettant en œuvre cette prime », souligne l’ordonnance.
L’entreprise pourra ainsi légalement distinguer ses salariés devant se rendre sur leur lieu de travail – comme les caissières dans la grande distribution ou les ouvriers sur un chantier – des autres en télétravail, ce qui était demandé par les fédérations patronales. « Il s’agit de récompenser les salariés au front qui tiennent leur poste de travail pendant cette période », a justifié la ministre du travail, Muriel Pénicaud, à l’issue du Conseil des ministres.
Le 24 mars, le ministre de l’économie avait décidé de faire sauter le verrou qui bloquait la distribution de la « prime Macron » dans les PME. Largement distribuée par les petites entreprises en 2019, après la crise des « gilets jaunes », la prime du pouvoir d’achat promettait de s’essouffler en 2020. Les conditions imposaient en effet aux entreprises de passer par un accord d’intéressement – peu courant dans les TPE –, pour donner une aide aux salariés. Cependant, dans les entreprises où un accord est négocié d’ici au 31 août, le niveau de la prime pourra être porté à 2 000 euros.
« Les plus petites entreprises n’y voient que de la provocation »
Dans le contexte actuel, le Syndicat des indépendants (SDI), qui avait réclamé en vain ce changement dès décembre 2019, reste perplexe. « Pour les entreprises d’au moins 20 salariés, cela peut avoir un sens, mais les plus petites n’y voient que de la provocation. Elles ne savent même pas comment elles vont pouvoir payer leurs salariés et leurs charges courantes d’ici lundi 6 avril, alors parler de prime… », s’exclame Marc Sanchez, le secrétaire général du SDI.
Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, confirme : « La première urgence pour les petites entreprises est d’assurer la trésorerie et le paiement des salaires. Enormément de TPE sont touchées, car la crise descend en cascade. Mais, pour les grands groupes organisés avec des indépendants, c’est tant mieux. Les premiers concernés sont ceux de la distribution. »