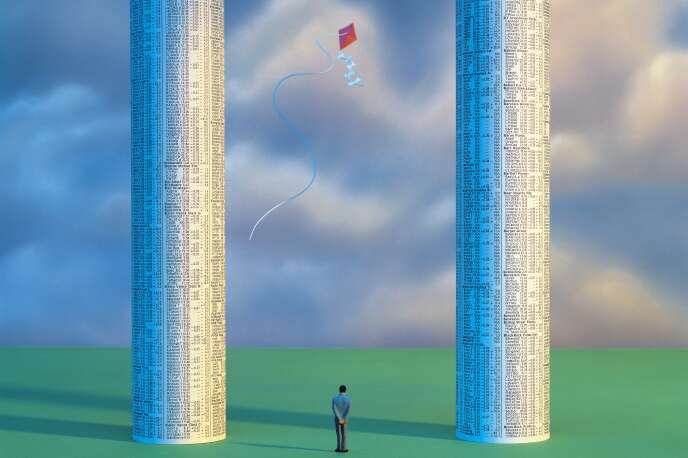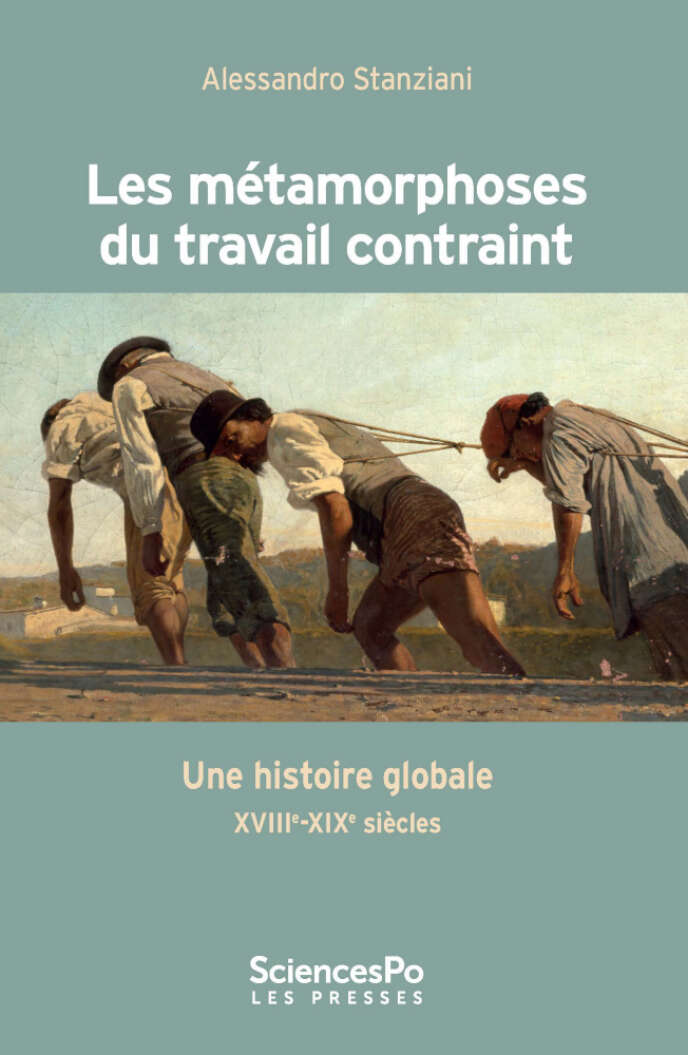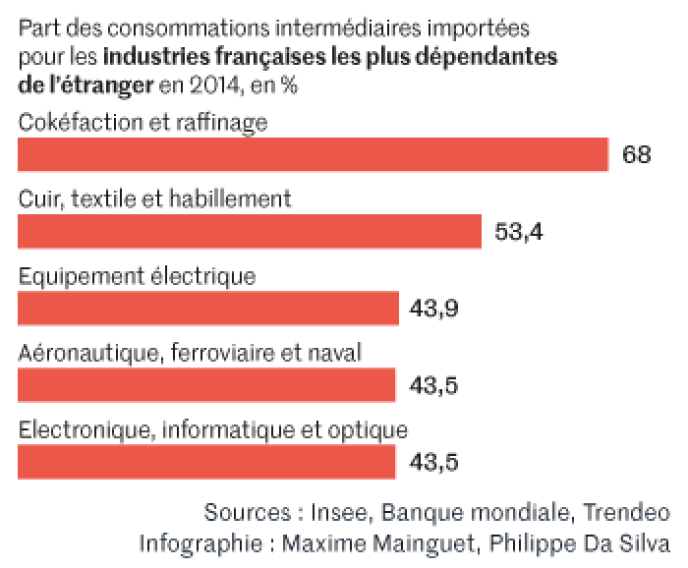Comment la crise due au Covid-19 risque de creuser les inégalités de genre

Un coup de massue. Lorsque l’annonce du deuxième confinement est tombée, mercredi 28 octobre, Assia n’a pu retenir ses larmes : « Enfermée dans 20 mètres carrés, encore une fois : je ne tiendrai pas. » En septembre, après cinq mois de chômage partiel, puis un mois de reprise en demi-teinte, son CDD d’hôtesse d’accueil au sein d’un groupe d’événementiel de la région parisienne n’a pas été renouvelé. « Au chômage, sans perspective, dans un secteur touché de plein fouet : comment vais-je m’en sortir ? »
Aurélie, elle aussi, a peur de s’effondrer. Ingénieure au sein d’un groupe informatique, elle a très mal vécu le premier confinement. « Gérer nos deux enfants de 7 mois et 4 ans entre les coups de fil, les courses, le ménage : même si mon conjoint en a fait plus, l’essentiel m’est tombé sur le dos, raconte-t-elle. Le plus dur est d’avoir eu le sentiment de courir derrière mes collègues masculins, libres de travailler plus. En six mois, j’ai vu l’écart se creuser. Même si, cette fois, l’école est maintenue, ça va recommencer. »
Parce qu’elles sont surreprésentées dans les emplois précaires et certains secteurs touchés par les restrictions (elle sont 57 % des serveurs, 83 % des coiffeurs…), parce que le télétravail menace l’équilibre entre vie professionnelle et familiale, les femmes risquent d’être plus largement affectées que les hommes par la crise économique liée au Covid-19, en Europe comme aux Etats-Unis. « C’est ce que l’on a constaté durant la première vague de la pandémie, en particulier pour les jeunes femmes, et cela pourrait s’aggraver ces prochains mois », redoute Massimiliano Mascherini, de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound). Dans un rapport paru en septembre, celle-ci tire le signal d’alarme : « L’impact dévastateur de la Covid-19 met en péril les progrès enregistrés en matière d’égalité des genres depuis dix ans en Europe. »
« Hausse des emplois précaires »
Et ce, alors que le salaire horaire moyen brut des femmes est toujours de 15 % inférieur à celui des hommes dans la zone euro, selon Eurostat. Ce qui signifie qu’en ce début du mois de novembre, elles cessent symboliquement d’être rémunérées pour leur travail par rapport à leurs collègues masculins. En France, où l’écart est de 15,8 %, elles travaillent pour rien à partir du 4 novembre, à 16 h 16, a calculé l’économiste Rebecca Amsellem, créatrice de la lettre d’information féministe « Les Glorieuses », qui a lancé une campagne sur le sujet. « Les Françaises perdent 39,2 jours ouvrés de travail rémunéré cette année. Cela stagne depuis cinq ans, et la pandémie risque d’aggraver la situation », explique-t-elle. Dans l’espoir de sensibiliser l’opinion, Bruxelles a également choisi de consacrer la journée du 4 novembre à l’égalité salariale.
Il vous reste 65.07% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.