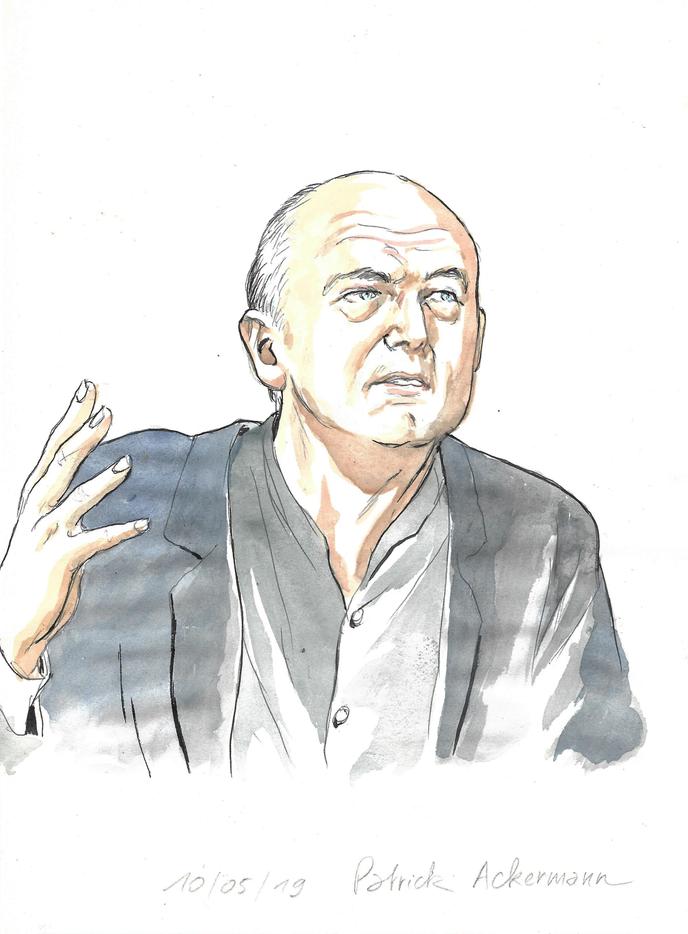L’ancienne base aérienne de Brétigny se réoriente pour recevoir des légumes et des stars

L’intention du changement de l’ancien aéroport militaire de l’Essonne en une ferme bio de 75 hectares et de grands studios de réalisation de films se concrétise.
Au bout de la piste d’atterrissage de l’ancienne base aérienne de Brétigny (Essonne), la construction des blocs agricoles est édifiée au début de l’été, notification à la création d’une vaste ferme bio de 75 hectares unissant maraîchage, élevage et céréales. Un peu plus au Nord, à côté de la tour de contrôle retranchée, la carlingue d’un Airbus A300 espère l’équipe de tournage d’un « biopic » de Céline Dion, sur ce site appelé à devenir l’un des primordiaux lieux du cinéma en Ile-de-France : il a déjà obtenu, ces derniers mois, le tournage du film sur Vidocq avec Vincent Cassel, L’Empereur de Paris (2018), et du J’Accuse, de Roman Polanski.
Des légumes et des stars : c’est l’un des cocktails qui accordent corps à la réinsertion économique de l’ex-base aérienne 217, un des projets d’agencement les plus originaux de la région. La communauté d’agglomération Cœur d’Essonne a racheté à l’Etat en 2015, pour 1 euro symbolique, les 300 hectares de prairies traversées par une piste de 3 kilomètres et peuplées de bâtiments hétéroclites. Elle est en passe de survenir son pari de préserver l’identité de ce site mythique de l’histoire des essais aériens, tout en y faisant éclore une « ville économique » diversifiée, porteuse de quelque 10 000 emplois pour ce territoire relégué aux marges du Grand Paris.
C’est un peu l’anti-EuropaCity, ce mégacomplexe de commerces et de loisirs dont la construction sur 80 hectares de terres agricoles du Val-d’Oise fait face devant une vive opposition. Ici, pas de parc d’attractions ni de galerie marchande dans les champs, mais la détermination de créer un écosystème économique local, qui n’oublie ni la transition écologique ni la solidarité. « Le mot d’ordre, c’est de pouvoir “vivre et travailler au pays”, éviter les deux heures de transport par jour que subissent de nombreux habitants de l’agglomération », conclu Olivier Léonhardt, sénateur (divers gauche) de l’Essonne, à l’origine de cette transformation. Après les années d’études et de préfiguration, plusieurs ingrédients majeurs de la recette se mettent en place.
2 500 euros nets par mois
L’agriculture, d’abord. « Nous faisons le pari de développer de la nature et de l’agriculture sur une terre d’urbanisation, malgré la pression foncière », prétends Arnaud Trécour, le directeur de la société publique locale (SPL) chargée de piloter l’agencement de la base. Baptisée « Ferme de l’envol », la future exploitation, portée par l’association Fermes d’avenir, est lancée par quatre premiers profitants, qui seront bientôt rejoints par d’autres.