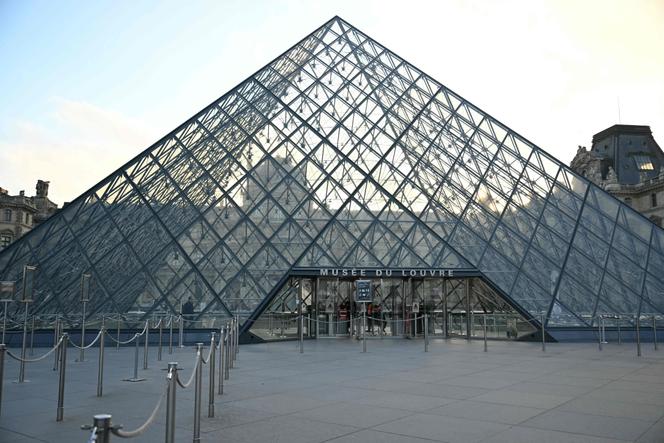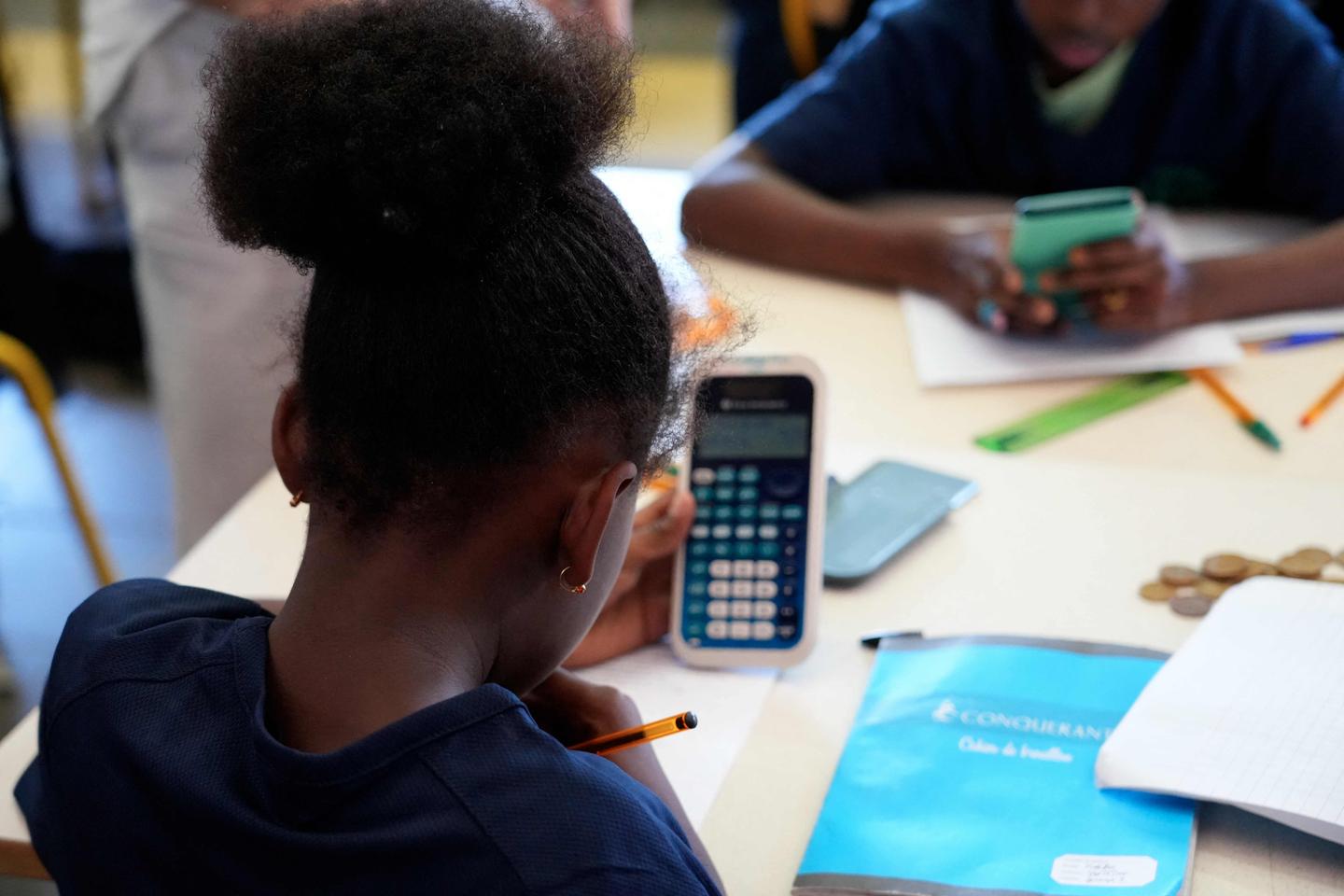« La question des arrêts de travail mérite d’être abordée dans un cadre de concertation nationale »

L’augmentation des arrêts de travail est devenue un sujet politique majeur. Elle alimente inquiétudes budgétaires et discours de suspicion à l’égard des médecins, accusés de prescrire trop facilement. Cette lecture est pourtant réductrice. Elle passe à côté de la réalité clinique et sociale qui se joue chaque jour dans les cabinets médicaux, en particulier en médecine générale.
Les demandes d’arrêt s’inscrivent rarement dans une logique de confort. Une aide-soignante de 45 ans consulte pour insomnies, douleurs diffuses, anxiété et crises de larmes. Elle travaille en sous-effectifs chroniques, enchaîne les heures supplémentaires et craint chaque jour de « craquer ». Médicalement, aucun diagnostic aigu ne s’impose. Humainement et professionnellement, la situation est instable. Refuser un arrêt, c’est ignorer un risque réel d’effondrement. L’accorder, c’est souvent compenser l’absence de prévention et de soutien au travail.
Autre situation fréquente : un cadre de 38 ans, jusque-là sans antécédents, arrive vidé, incapable de se concentrer, envahi par une angoisse qu’il ne comprend pas lui-même. Il n’est pas « malade » au sens classique, mais il n’est plus en capacité de travailler. L’arrêt devient alors une mesure de protection transitoire, faute d’alternative immédiate. Ce n’est pas un confort, c’est un signal d’alerte.
Il serait toutefois malhonnête d’ignorer le point de vue des employeurs, qui constatent également des situations vécues comme abusives. Un exemple revient régulièrement : un salarié opéré, dont le chirurgien juge la consolidation satisfaisante et la reprise possible, consulte ensuite un autre médecin, qui accorde trois semaines d’arrêt supplémentaires.
D’autres situations sont également rapportées : à la suite d’un désaccord professionnel, parfois d’un simple mot de travers, un salarié annonce son intention de se mettre en arrêt. L’arrêt de travail devient alors une réponse immédiate à un conflit que ni l’entreprise ni le dialogue social ne parviennent à réguler.
Il vous reste 67.17% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.