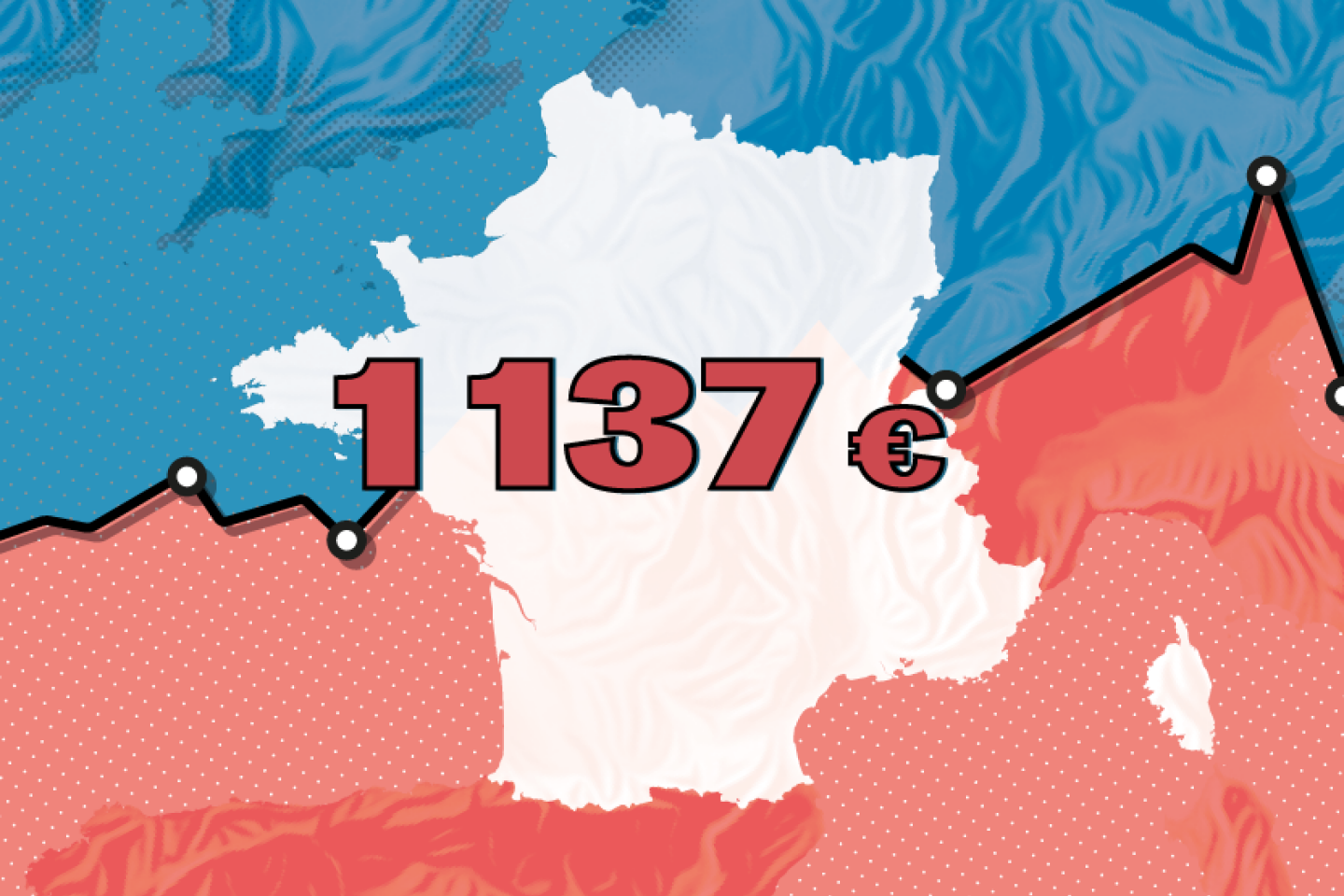Etranglé par 5 milliards d’euros de dette, Atos change de directeur général

La situation inquiète à six mois des Jeux olympiques. Atos, le partenaire technologique du Comité international olympique et, à ce titre, prestataire informatique de Paris 2024, doit rapidement trouver un accord avec ses banques s’il ne veut pas que ses 5 milliards d’euros de dette (2,3 milliards d’euros net, après prise en compte de la trésorerie) le conduisent à la faillite. Environ la moitié de ces 5 milliards doit être remboursée en 2025. Atos n’a pas cette somme. Il lui faut donc renégocier cette dette avec ses vingt-deux banques.
Engagées il y a plusieurs mois, les négociations patinent. Pour se faire aider, Jean-Pierre Mustier, le président d’Atos, a donc pris contact avec Hélène Bourbouloux, l’administratrice judiciaire qui a travaillé sur tous les dossiers financiers chauds, comme Casino et Orpea, a révélé Le Figaro, dimanche 14 janvier. Selon nos informations, Atos réfléchit à l’ouverture d’un mandat ad hoc, une procédure préventive destinée aux entreprises qui ne sont pas en cessation de paiements. Dans un communiqué publié lundi 15 janvier, le groupe a assuré « qu’il n’a pas déposé de demande de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation », ce qui ne l’empêche pas de le faire dans les prochaines heures.
Signe de l’urgence : Atos a annoncé, lundi, le départ précipité de son directeur général, Yves Bernaert, en poste depuis seulement quatre mois et dont le profil ne correspondait pas à la situation de l’entreprise. Il est remplacé par son directeur financier, Paul Saleh, ce qui confirme bien la volonté du groupe de se concentrer sur les discussions avec ses banques. Une réunion est prévue cette semaine.
Note dégradée
Il faut aller vite. Fin novembre 2023, l’agence de notation S&P a abaissé sa note (de « BB » à « BB − »), menaçant d’aller un cran plus bas dans les prochaines semaines. Son nouvel avis est attendu fin janvier. Une dégradation supplémentaire enverrait Atos dans la catégorie « hautement spéculative », ce qui pourrait provoquer la perte de plusieurs centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires. Certains clients bénéficient de clauses qui permettent de transférer leur contrat vers un autre sous-traitant si le fournisseur officiel est trop mal noté. Lundi, alors que des rumeurs commençaient à circuler sur la dégradation de ses résultats, Atos a assuré que « ses lignes d’activité atteindront leurs objectifs financiers 2023 pour l’année en termes de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle ». Mais à quoi ressemblera 2024 ?
Il vous reste 55% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.