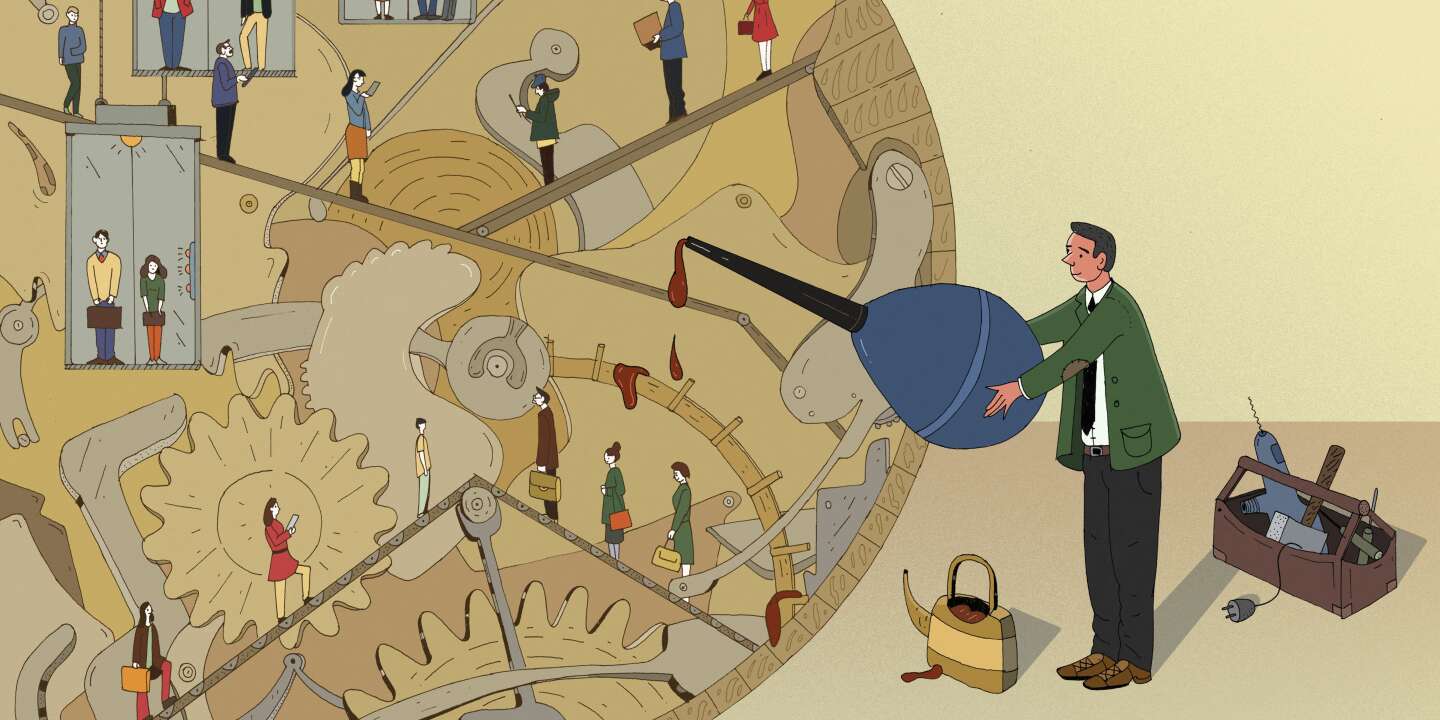Cecilia Garcia-Peñalosa : « La réintégration des femmes sur le marché du travail doit être un aspect fondamental des plans de relance »

Tribune. Au cours du XXe siècle, malgré leurs effets dévastateurs, les guerres et les récessions ont fait avancer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les pays à haut revenu : le départ des hommes au front a généré un manque de main-d’œuvre, poussant entreprises et gouvernements à faire appel au travail des femmes en dépit des normes sociales en vigueur à l’époque. Ainsi, des femmes éduquées pour devenir mères et épouses se sont retrouvées livreuses de charbon, conductrices de camion, ouvrières industrielles, et cryptanalystes.
Au retour des hommes, la plupart d’entre elles sont retournées au foyer. Mais ces expériences ont montré que le travail féminin pouvait être aussi valable que celui des hommes. Elles ont laissé envisager aux pères et époux qu’il était possible d’avoir une activité en dehors de la maison en restant « respectable », et, par-dessus tout, elles ont transformé à jamais les aspirations des femmes.
Si les guerres ont créé des occasions pour les femmes de travailler, les crises du XXe siècle ont engendré du besoin. Le concept de « travailleur supplémentaire », développé par le statisticien russe Wladimir Woytinsky (1885-1960), selon lequel la femme ne travaille que lorsque le ménage a besoin d’un revenu supplémentaire, explique l’augmentation de l’emploi des femmes mariées après la crise de 1929.
Jusqu’aux années 1920, les femmes qui travaillaient en dehors de la maison étaient jeunes et célibataires, et la norme sociale exigeait que, une fois mariées, elles quittent ces emplois pour se consacrer à leur famille. Le krach boursier de 1929 va questionner ces comportements.
Maintenir les revenus du foyer
L’effondrement du système financier secoue le secteur industriel, dont la production va chuter à tel point que le taux de chômage des hommes est multiplié par trois au moins selon les pays. Dans ce contexte, leurs épouses tentent de maintenir les revenus du foyer en cherchant un travail, et l’industrie va les accueillir à bras ouverts : une femme pouvait, à l’époque, être payée bien moins qu’un homme pour le même travail, ce qui a permis une réduction des coûts en temps de crise. Les femmes ont ainsi accédé à des métiers jusque-là inaccessibles pour elles.
Ce type de mécanisme, présent dans la plupart des récessions du XXe – car le chômage a toujours touché principalement les hommes, notamment les cols bleus –, a été particulièrement important lors de la « Grande Récession » : quand la crise mondiale frappe en 2008, la situation des femmes dans les pays à haut revenu est bien différente de celle de 1929. Elles sont aussi éduquées que les hommes et représentent autour de 45 % des emplois.
Il vous reste 60.79% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.