« Le “monde d’après” a sa division des travailleurs – les indispensables et les autres, en miroir, “superflus” »
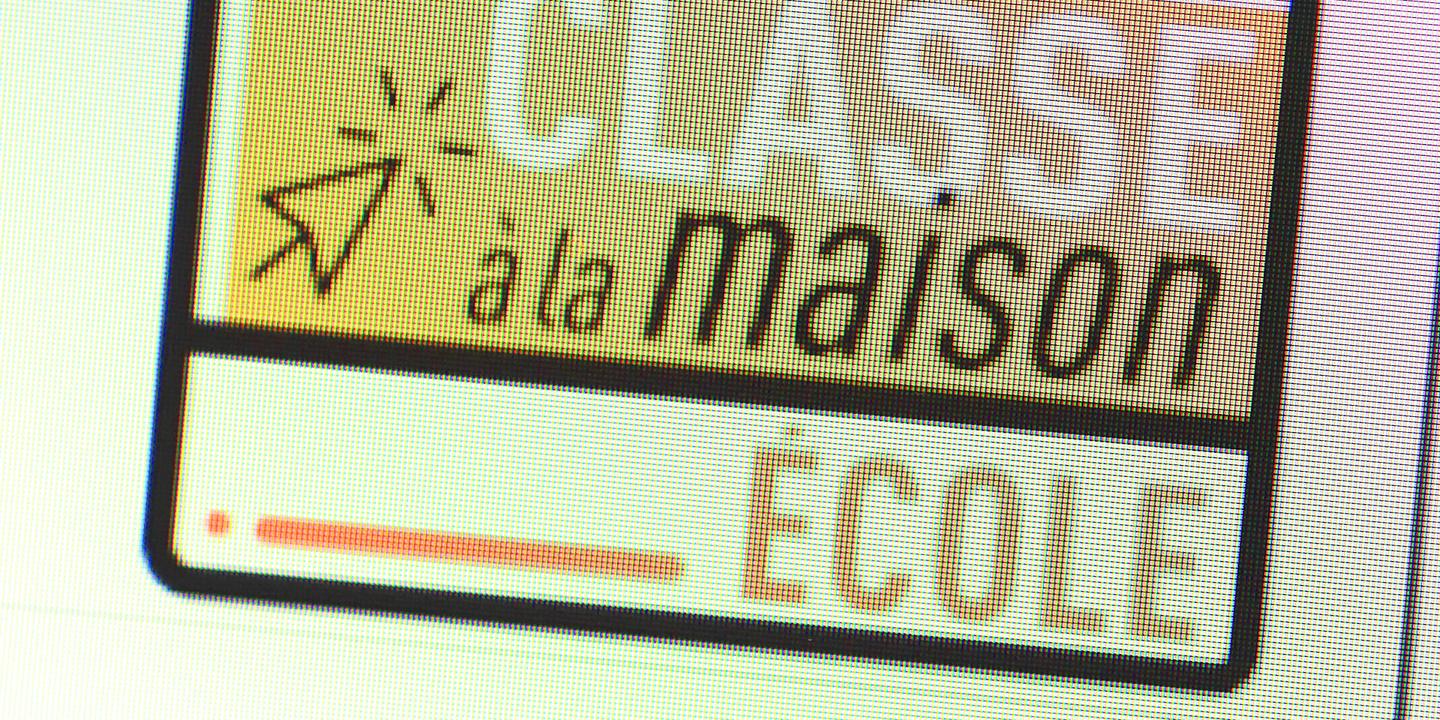
Tribune. Avec le déconfinement et l’appel à la reprise de la plupart des activités économiques, l’enjeu de la garde des jeunes enfants va grandissant. L’absence de solution oblige un des parents – le plus souvent la femme dans les couples mixtes – à se maintenir en chômage partiel avec une perte sensible de revenu. La peur d’être parmi les premiers licenciés s’ajoute pour ceux qui travaillent dans les activités les plus ébranlées par la crise. Les mères de familles monoparentales sont particulièrement exposées.
La frustration va donc aller croissante dans les familles qui ne pourront toujours pas scolariser leurs enfants. Les modalités de réouverture physique des écoles de la maternelle jusqu’au collège étant malthusiennes, le gouvernement a établi des priorités de publics d’enfants – handicapés notamment –, mais aussi maintenu et élargi un critère basé sur la qualité d’un des parents : figurer sur la « liste des professionnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité́ de la vie de la nation ».
Le « monde d’avant » avait sa division des travailleurs – premiers de cordée versus ceux qui ne sont rien –, le « monde d’après » a la sienne – les indispensables et les autres, en miroir, « superflus ». Cette division est peut-être encore plus violente puisqu’elle comporte des droits différents. Pourtant chantre de l’égalité des chances, le ministre de l’éducation l’a dramatiquement illustré : « Il y a plus de risques à rester chez soi que d’aller à l’école. » Pourquoi les enfants des « superflus » méritent-ils d’être exposés à plus de risques ?
Une logique de profession plus que de fonction
Pour être acceptable par la société, une violence doit être légitime. Or la constitution des listes d’« indispensables à la continuité de la nation » souffre d’emblée de deux faiblesses. Elle est décidée localement et discrétionnairement, et repose sur une logique de profession plus que de fonction. Les sciences sociales nous apprennent les biais potentiels inhérents à un tel édifice. Prenons pour illustration la liste du 12 mai établie par la préfecture de Seine-et-Marne.
Un premier biais est l’aléa moral : les autorités en charge de la constitution de la liste s’avantageraient au détriment de l’intérêt collectif. En Seine-et-Marne, les enfants des personnels – sans distinction – de la préfecture sont ainsi prioritaires pour un accueil en continu, même si l’autre parent est, par exemple, en télétravail. A l’inverse, les agents des tribunaux recevant les contestations des décisions de l’exécutif ne figurent pas sur la liste. Tous les personnels des agences régionales de santé (ARS) et du ministère de la santé sont indispensables, mais pas un chercheur travaillant sur un traitement ou un vaccin du Covid-19.
Il vous reste 32.04% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.