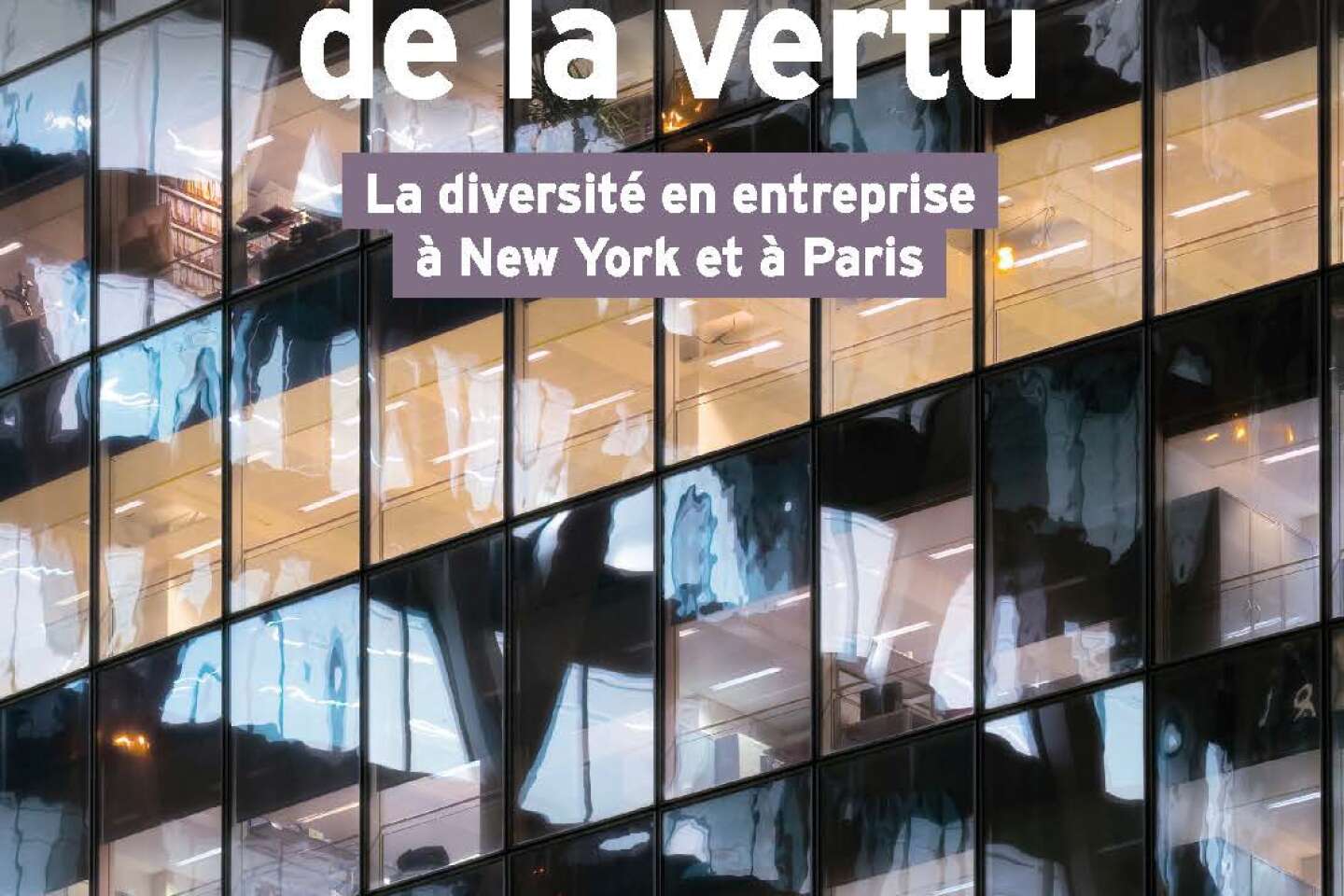Lycée professionnel : les enjeux d’une indispensable évolution

L’éducation doit-elle déboucher sur un métier ou bien consiste-t-elle simplement à former des futurs citoyens ? Si la France n’a jamais véritablement réussi à dépasser cet éternel débat, c’est sans doute parce que la seule réponse valable est que le premier objectif est aussi important que le second. Or, les lycées professionnels n’atteignent ni l’un ni l’autre en aboutissant à un immense gâchis pour une part non négligeable de la jeunesse. Dès lors, faire de la réforme de ces lycées professionnels une « cause nationale », comme l’a annoncé, jeudi 4 mai, Emmanuel Macron, n’a rien de grandiloquent : c’est un devoir et une nécessité.
La filière cumule les difficultés en concentrant les élèves les plus fragiles socialement et scolairement. Une fois qu’ils sont diplômés, seule une petite moitié trouve un emploi au bout d’un an. Ce bilan n’est pas tolérable. Il est le fruit de plusieurs décennies de réformes mal calibrées, de budgets bancals et d’un système incapable de se remettre en cause malgré le manque de résultats.
Souvent choisi par défaut, le lycée professionnel a fini par devenir pour beaucoup d’élèves une « voie de garage » ne permettant, dans l’indifférence générale, ni poursuite d’études ni insertion professionnelle. A la clé, une population peu diplômée, oubliée, se sentant déclassée et devenue l’un des principaux terrains de chasse électoraux du Rassemblement national.
Un « pacte » avec les enseignants
La réforme propose une série de changements autour de deux piliers. L’un concerne l’amélioration de l’employabilité. Il s’agit de faire coïncider les formations avec le potentiel du bassin d’emploi local. Le projet vise à être transparent sur les débouchés des formations et envisage de fermer celles qui ont les taux d’insertion les plus bas. L’idée tient du bon sens. Reste à expliquer comment seront accompagnés les enseignants concernés. Afin de mieux valoriser les parcours des élèves et de réduire l’écart d’attractivité avec les centres de formation des apprentis, il est enfin prévu de rémunérer les stages en entreprise. Ceux-ci seront plus nombreux en terminale.
Ces efforts en faveur de l’insertion professionnelle sont les bienvenus, mais ils ne doivent pas se faire au détriment du second pilier de la réforme, c’est-à-dire l’amélioration des savoirs fondamentaux. C’est là que tout se complique, car l’équilibre dépendra des modalités d’application. Il s’agit de nouer un « pacte » avec les enseignants. Ces derniers pourront toucher jusqu’à 7 500 euros brut par an en échange de « missions » comme le soutien aux élèves en difficulté.
Objectif : « zéro décrocheur », promet le président. Mais, derrière le slogan, peu de précisions. Si la partie insertion est balisée et appelée à s’appliquer uniformément, celle qui concerne la consolidation de l’enseignement général variera selon l’engagement des enseignants. De la proportion de ceux qui sont prêts à accepter le « pacte » dépendra pour une part l’efficacité de la réforme. D’un côté, le risque est de créer un système à deux vitesses entre les lycées qui joueront le jeu et ceux qui refuseront. De l’autre, c’est l’occasion de placer les enseignants face à leurs responsabilités et de jouer sur l’effet d’entraînement.
Grâce à une enveloppe de 1 milliard d’euros par an, M. Macron souhaite « continuer de créer plus de liens entre le monde éducatif et le monde de l’entreprise, en assumant que le lycée professionnel est une troisième voie ». Mais celle-ci ne pourra s’affirmer que si la filière sait mener sur le même plan employabilité et culture générale. A ce stade, difficile de savoir si cet équilibre indispensable sera respecté.