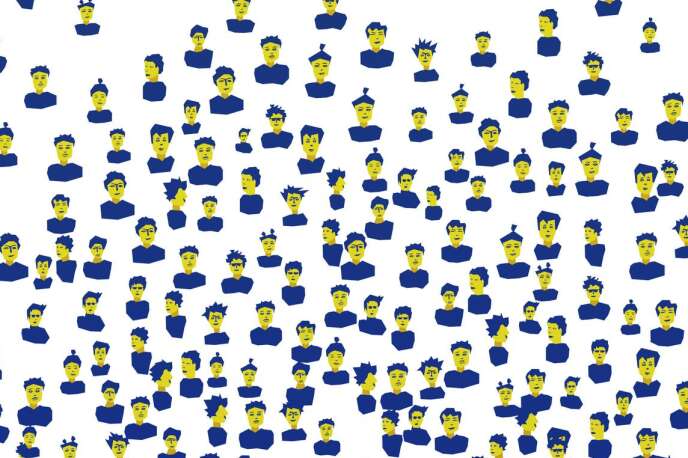Quoi d’habituel entre une Ethiopienne travaillant dans l’une des usines textiles de son pays, rémunérée 23 euros par mois à coudre des vêtements pour les grandes marques occidentales, et le porteur à vélo qui sillonne Paris, Londres ou New York pour quelques euros, au péril de sa vie ? Entre la jeune Malgache qui chemine vingt heures par jour chez un propriétaire aisé, avec à peine de quoi pourvoir à ses besoins, et l’ouvrier du bâtiment grec qui fait des chantiers au noir pour « arranger » son patron ? Aux yeux de l’Organisation internationale du travail (OIT), aucun d’eux n’utilise ce qu’il est convenu d’appeler un « travail décent ». Un travail irréprochable, correctement payé, qui s’exerce dans de bonnes conditions de sécurité et qui procure un minimum de protection sociale pour le travailleur et sa famille. Un travail qui laisse la possibilité d’entrevoir un avenir meilleur.
Déduction pour laquelle l’OIT et l’Agence française de développement (AFD) arrangent le 24 mai, à Paris, la conférence « Emplois décents et lien social : un enjeu démocratique mondial »
A l’échelle universelle, outre la lutte contre le chômage, l’enjeu est actuellement de défendre l’éventualité pour chacun d’accéder à un travail décent, un concept élaboré il y a une quinzaine d’années par l’OIT, dans le sillage de la crise économique et financière de 2008. « En 2015, au cours de l’assemblée générale, les Nations unies ont inscrit le travail décent comme un facteur de développement et non comme une résultante », déclare Cyril Cosme, directeur de l’OIT pour la France.
80 % des sociétés sont informelles
Et l’enjeu est de taille. Selon les chiffres de l’OIT, 50 % de la main-d’œuvre mondiale (2,5 milliards de personnes) exerce des activités de production dans le secteur officiel. Une expertise déjà étendu, qui monte à neuf personnes sur dix dans les pays à revenu faible, contre deux sur dix dans les pays développés. « 80 % des entreprises du monde sont informelles, ce qui recouvre l’économie non déclarée ou non couverte par la loi comme le travail domestique. Il se peut aussi que la loi existe mais ne protège pas, car elle n’est pas appliquée, spécifie Philippe Marcadent, coordinateur des travaux sur le travail informel à l’OIT. On est donc, au bout du compte, sur la très grande majorité des travailleurs : au fond, c’est plutôt l’emploi formel qui fait exception. »
Les secteurs les plus affectés par le travail informel sont aussi ceux qui font amplement vivre les pays en développement : l’agriculture et la pêche, premier secteur inventif d’emplois dans le monde, qui relève de conditions très précaires ; l’exploitation des ressources naturelles telles que le cacao et le tabac, le textile, l’habillement… Des secteurs où bien fréquemment le travail ne protège pas de la pauvreté et de l’insécurité : en 2015, selon les chiffres des Nations unies, 2,2 milliards de personnes vivaient avec moins de 2 dollars par jour, dont 780 millions employaient pourtant un emploi ; en 2018, toutes les quinze secondes, une personne mourait, quelque part dans le monde, d’un accident ou d’une maladie liés au travail ; plus de 45 % des travailleurs domestiques dans le monde n’ont aucun jour de congé (OIT 2013) ; neuf laborieux sur dix en Afrique subsaharienne n’ont aucune protection sociale (AFD 2018)…
Ce serait malgré cela une erreur de croire que la question ne touche que les pays les plus pauvres. La notion de législation ne suffit pas pour qu’un emploi puisse être qualifié de « décent ». « En Grèce, par exemple, environ 35 % du travail n’est pas déclaré, mais il s’exerce souvent dans des entreprises qui, elles, sont déclarées », précise Philippe Marcadent. Par ailleurs, les pays les plus riches protègent ou entretiennent à leur manière le fléau à travers leurs chaînes d’approvisionnement, qu’il se réalise de textile, de minerai, de cacao ou d’autres matières premières.
« Accroître les protections »
C’est légitimement la diversité des conditions et des formes de travail qui rend complexe la question du travail décent. Si le travail au noir, en Europe par exemple, peut être contrôlé et sanctionné par des structures adéquates, telles que les services d’inspection du travail, « en Afrique, pour les travailleurs des rues, cela ne servirait strictement à rien, souligne Philippe Marcadent. La ligne fondamentale est d’accroître les protections ; si certaines personnes ne vont jamais entrer dans un travail formel, on peut néanmoins essayer d’obtenir des conditions de travail meilleures, la base étant une protection sociale pour tous ».
Agir en faveur de l’emploi décent implique donc d’appréhender les situations de manière différente selon les pays, les situations personnelles et les parcours des individus, les secteurs concernés… L’OIT mène en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD) et d’autres institutions de nombreuses actions sur le terrain, à la fois pour assister l’accès d’un maximum de personnes à l’emploi salarié ou à l’autoemploi, pour conduire les personnes en renforçant l’employabilité à travers la formation ou la qualification. Dernièrement, dans un camp de réfugiés syriens installé en Jordanie, l’OIT, en lien avec l’Union européenne, a organisé un « marché de l’emploi » entre les entreprises locales et les hommes et les femmes du camp, pour leur permettre de trouver un travail rémunéré et améliorer leurs conditions de vie. Autre exemple, totalement différent : un projet mené à Madagascar. Il s’agissait de découvrir les situations de servitude des enfants, pour les inciter à faire évoluer leur condition. Définitivement, 200 enfants sont entrés en formation et 2 500 ont abandonné leur « emploi ». Peu, au regard du nombre d’enfants intéressés par le travail forcé dans le pays, évalué à 2 millions, mais qui peut protéger une prise de conscience collective.
Ce dossier est accompli dans le cadre d’une collaboration avec l’AFD.
« Emplois décents et lien social »
La conférence « Emplois décents et lien social : un enjeu démocratique mondial », structurée par l’Agence française de développement (AFD) et l’Organisation internationale du travail (OIT), se développera le 24 mai, à Vivacity, 155, rue de Bercy, Paris (12e).
9 h Discours d’ouverture. Rémy Rioux, DG de l’AFD ; Moussa Oumarou, DGA du Bureau international du travail (BIT).
9 h 30 « Points de vue sur l’avenir du travail », avec Anousheh Karvar, déléguée du gouvernement français au conseil d’administration de l’OIT.
10 h 30 « Emplois décents et mondialisation. Comment promouvoir des chaînes d’approvisionnement responsables ? », avec Vic van Vuuren, directeur du département des entreprises du BIT.
11 h 45 « L’égalité professionnelle : comment favoriser l’accès des femmes aux opportunités économiques ? », avec Shauna Olney, chef du service genre du BIT.
14 h « Les facettes de l’informalité : quels leviers pour protéger les travailleurs et développer l’emploi ? », avec François Roubaud, directeur de recherche, Institut de recherche pour le développement.
15h45 « Le climat et la transition juste : comment protéger le travail ? », avec Gaël Giraud, chef économiste de l’AFD.
17h Clôture. Laurence Breton-Moyet, directrice exécutive de la stratégie, des partenariats et de la communication (AFD), et Cyril Cosme, directeur du bureau de l’OIT.