Peu commun, et soumis à des codes anglo-saxons, l’univers des MBA est pénible d’abord pour les non-initiés. Comment se délimiter dans ce maquis de formations, actuellement proposées dans la plupart des écoles de commerce, ainsi que dans quelques écoles d’ingénieurs ? Ces cursus d’un an minimum s’envoient à des jeunes cadres avec quelques années d’expérience professionnelle, et qui veulent se poser sur l’effet « accélérateur de carrière » de ce diplôme pour progresser dans la hiérarchie, et accéder à des postes au sein de directions générales.
A l’Insead, par exemple, l’âge moyen des adhérents est de 29 ans, avec six ans d’expérience professionnelle. On trouve dans les MBA des diplômés d’écoles d’ingénieurs, de jeunes cadres issus de formations juridiques, en marketing ou en finance. Mais aussi des pharmaciens, des diplômés en sciences humaines… Détaché : procurer des bases dans tous les domaines du business, apprendre le « leadership », la stratégie. Au programme : des études de cas, des mises en situations, des exercices en équipes, de l’anglais à haute dose, des cours sur le business plan ou l’implication sociale des entreprises…
Mais aussi, selon les MBA, des leçons plus pointus : Neoma présente dans son MBA des cours sur l’IA, le big data, les marchés émergents… Skema envoie ses adhérents aux Etats-Unis ou au Brésil. Kedge propose une spécialisation en management des vins et spiritueux. Mais au-delà, le MBA est surtout une occasion, dans une carrière, de se consulter sur ses pratiques, de mieux se connaître, et de se créer un nouveau réseau.
Faire évaluer son projet
Mais ce placement lourd en temps et en argent réclame, en amont, d’être au clair avec ses objectifs. Thomas Jeanjean, directeur général adjoint de l’Essec, conseille « de demander un entretien avec les responsables des programmes pour évaluer son projet ». Les contacts avec les écoles lors de salons, le recueil d’avis auprès de cadres dirigeants sur la démarche et sur le choix du MBA sont des étapes inévitables avant d’arrêter son choix. « Il est indispensable de mener son enquête avant de signer un chèque », conseille le directeur de la communication à HEC Paris Philippe Oster. « Il faut surtout contacter des anciens élèves, qui ont fait le pari de s’arrêter, de s’endetter, de trouver un compromis avec leur vie familiale pour un MBA », développe Philippe Oster.
Il y a en France 300 programmes MBA – cette désignation n’est pas dégagée à l’approbation et aux contrôles du ministère de l’enseignement supérieur, contrairement, par exemple, au diplôme de master. Ils rassemblent des réalités très diverses. Les classements internationaux des MBA, comme celui du Financial Times, accordent une idée des formations les plus reconnues à l’international.
On y compte quelques écoles françaises – HEC, EM Lyon, Grenoble EM, l’Essec et l’Insead −, même si leurs rivales américaines se divisent la part du lion. Cette organisation, qui combine une multitude de critères, confère beaucoup de poids à la progression salariale, pondérée selon les secteurs. Autrement dit, sur le fameux « retour sur investissement » du participant. « Pour que l’investissement soit rentable, il faut espérer avoir remboursé ses frais dans les trois ans maximum après la homologation du diplôme, articule Philippe Oster, à HEC. Si tout va bien, on peut constater une évolution salariale significative six mois après la reprise du travail. »
Divulguer les approches
Pour faire son choix, propager les approches est une bonne stratégie. Pour l’administrateur de Rennes School of Business Thomas Froehlicher, « les classements se complètent : par exemple, celui du Financial Times englobe la question de la parité hommes-femmes tandis que le magazine Forbes se concentre essentiellement sur le retour sur investissement. »
D’autres expériences, comme les labels, permettent de se faire une idée. Première étape, pour les écoles françaises : l’appartenance à la Conférence des grandes écoles (CGE) – les écoles qui en sont membres remettent des diplômes visés par l’Etat. Les trois grandes accréditations internationales (le label américain AACSB, le label européen Equis, le label britannique AMBA réservé au MBA) sont plus difficiles. Les écoles qui les parviennent, au terme d’un lourd audit et de multiples rapports, répondent à des critères de qualité en termes de formation, recherche, de suivi des étudiants.
Rares sont les écoles nommées de la « triple couronne » : elles ne sont qu’une quinzaine en France. A l’Essec, Thomas Jeanjean met également en avant le label d’état EEPSIG (Etablissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général), qui distingue aussi le caractère non lucratif et la gestion désintéressée, ainsi que sa promesse à célébrer les missions de service public. Quinze écoles de commerce ont réussi ce label en France.
GMAT, Toeic ou Toefl : un passage obligé
Autres domaines à apprécier : la puissance du réseau des anciens, les liens confirmés avec les entreprises, le profil des participants et des enseignants, le degré d’internationalisation des promotions, la publication d’enquête sur l’insertion et les salaires des diplômés… Une recherche qui prend du temps. Une fois la formation aperçue, encore faut-il s’y faire admettre : à titre d’exemple, le MBA d’HEC recrute 17 % des candidats.
D’autres sont bien moins sélectifs. Le GMAT, test qui fait appel à des capacités en logique et en calcul, est l’un des passages obligé des actions de sélection. De même que les tests reconnaissant un niveau en anglais (Toeic ou Toefl), les lettres de motivation et d’appui. Une fois le feu vert obtenu, reste à faire le tour des banques pour décrocher un prêt.
Une façon de diminuer le coût total consiste à opter pour un Executive MBA (à temps partiel), qui agrée de garder son emploi et de suivre les cours le week-end, en fin de journée, ou sur certaines périodes balisées. Un défi personnel plus important et un procédé moins « immersif » que la formule à temps plein, mais qui permet de garder une rétribution. Un atout non insignifiante.





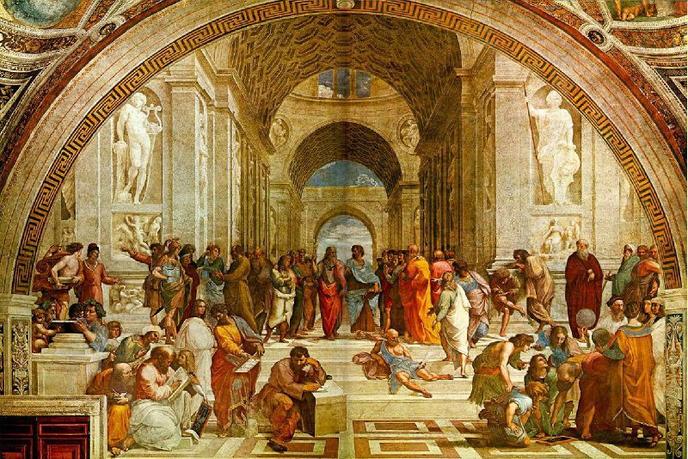




A l’Insead, par exemple, l’âge moyen des adhérents est de 29 ans, avec six ans d’expérience professionnelle. On trouve dans les MBA des diplômés d’écoles d’ingénieurs, de jeunes cadres issus de formations juridiques, en marketing ou en finance. Mais aussi des pharmaciens, des diplômés en sciences humaines… Détaché : procurer des bases dans tous les domaines du business, apprendre le « leadership », la stratégie. Au programme : des études de cas, des mises en situations, des exercices en équipes, de l’anglais à haute dose, des cours sur le business plan ou l’implication sociale des entreprises…
Mais aussi, selon les MBA, des leçons plus pointus : Neoma présente dans son MBA des cours sur l’IA, le big data, les marchés émergents… Skema envoie ses adhérents aux Etats-Unis ou au Brésil. Kedge propose une spécialisation en management des vins et spiritueux. Mais au-delà, le MBA est surtout une occasion, dans une carrière, de se consulter sur ses pratiques, de mieux se connaître, et de se créer un nouveau réseau.
Faire évaluer son projet
Mais ce placement lourd en temps et en argent réclame, en amont, d’être au clair avec ses objectifs. Thomas Jeanjean, directeur général adjoint de l’Essec, conseille « de demander un entretien avec les responsables des programmes pour évaluer son projet ». Les contacts avec les écoles lors de salons, le recueil d’avis auprès de cadres dirigeants sur la démarche et sur le choix du MBA sont des étapes inévitables avant d’arrêter son choix. « Il est indispensable de mener son enquête avant de signer un chèque », conseille le directeur de la communication à HEC Paris Philippe Oster. « Il faut surtout contacter des anciens élèves, qui ont fait le pari de s’arrêter, de s’endetter, de trouver un compromis avec leur vie familiale pour un MBA », développe Philippe Oster.
Il y a en France 300 programmes MBA – cette désignation n’est pas dégagée à l’approbation et aux contrôles du ministère de l’enseignement supérieur, contrairement, par exemple, au diplôme de master. Ils rassemblent des réalités très diverses. Les classements internationaux des MBA, comme celui du Financial Times, accordent une idée des formations les plus reconnues à l’international.
On y compte quelques écoles françaises – HEC, EM Lyon, Grenoble EM, l’Essec et l’Insead −, même si leurs rivales américaines se divisent la part du lion. Cette organisation, qui combine une multitude de critères, confère beaucoup de poids à la progression salariale, pondérée selon les secteurs. Autrement dit, sur le fameux « retour sur investissement » du participant. « Pour que l’investissement soit rentable, il faut espérer avoir remboursé ses frais dans les trois ans maximum après la homologation du diplôme, articule Philippe Oster, à HEC. Si tout va bien, on peut constater une évolution salariale significative six mois après la reprise du travail. »
Divulguer les approches
Pour faire son choix, propager les approches est une bonne stratégie. Pour l’administrateur de Rennes School of Business Thomas Froehlicher, « les classements se complètent : par exemple, celui du Financial Times englobe la question de la parité hommes-femmes tandis que le magazine Forbes se concentre essentiellement sur le retour sur investissement. »
D’autres expériences, comme les labels, permettent de se faire une idée. Première étape, pour les écoles françaises : l’appartenance à la Conférence des grandes écoles (CGE) – les écoles qui en sont membres remettent des diplômes visés par l’Etat. Les trois grandes accréditations internationales (le label américain AACSB, le label européen Equis, le label britannique AMBA réservé au MBA) sont plus difficiles. Les écoles qui les parviennent, au terme d’un lourd audit et de multiples rapports, répondent à des critères de qualité en termes de formation, recherche, de suivi des étudiants.
Rares sont les écoles nommées de la « triple couronne » : elles ne sont qu’une quinzaine en France. A l’Essec, Thomas Jeanjean met également en avant le label d’état EEPSIG (Etablissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général), qui distingue aussi le caractère non lucratif et la gestion désintéressée, ainsi que sa promesse à célébrer les missions de service public. Quinze écoles de commerce ont réussi ce label en France.
GMAT, Toeic ou Toefl : un passage obligé
Autres domaines à apprécier : la puissance du réseau des anciens, les liens confirmés avec les entreprises, le profil des participants et des enseignants, le degré d’internationalisation des promotions, la publication d’enquête sur l’insertion et les salaires des diplômés… Une recherche qui prend du temps. Une fois la formation aperçue, encore faut-il s’y faire admettre : à titre d’exemple, le MBA d’HEC recrute 17 % des candidats.
D’autres sont bien moins sélectifs. Le GMAT, test qui fait appel à des capacités en logique et en calcul, est l’un des passages obligé des actions de sélection. De même que les tests reconnaissant un niveau en anglais (Toeic ou Toefl), les lettres de motivation et d’appui. Une fois le feu vert obtenu, reste à faire le tour des banques pour décrocher un prêt.
Une façon de diminuer le coût total consiste à opter pour un Executive MBA (à temps partiel), qui agrée de garder son emploi et de suivre les cours le week-end, en fin de journée, ou sur certaines périodes balisées. Un défi personnel plus important et un procédé moins « immersif » que la formule à temps plein, mais qui permet de garder une rétribution. Un atout non insignifiante.