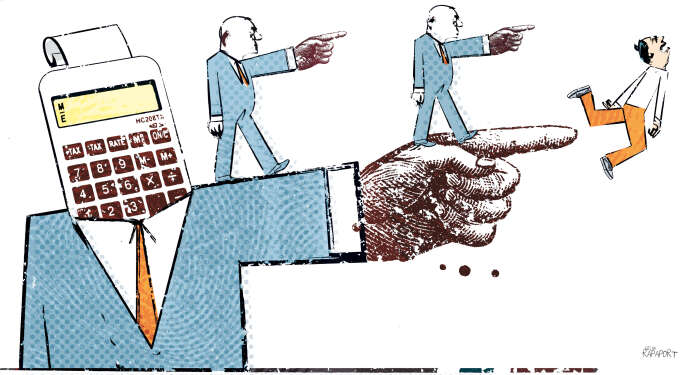Medef : Roux de Bézieux est parvenu « à naviguer entre plusieurs récifs conjoncturels »

Michel Offerlé, professeur émérite à l’ENS, revient sur la première année de Geoffroy Roux de Bézieux à la tête de l’organisation patronale.
Article réservé aux abonnés
Michel Offerlé, professeur émérite à l’Ecole normale supérieure (ENS), et auteur de Les patrons des patrons. Histoire du Medef (Odile Jacob, 2013), analyse la première année de mandat du président de l’organisation patronale.
Même si Geoffroy Roux de Bézieux a finalement renoncé à convier Marion Maréchal à l’université d’été du Medef, faut-il y voir un tournant dans les rapports du patronat à l’extrême droite ?
Michel Offerlé : Marine Le Pen avait été invitée en 2017 à présenter avec d’autres candidats à la présidentielle son programme au Medef. Pierre Gattaz avait quelques jours plus tard qualifié ses positions économiques « d’ineptes ». Depuis les années 1980, il y a un cordon sanitaire entre le patronat et l’extrême droite.
L’idée de convier Mme Maréchal à un débat sur le populisme – à quel titre d’ailleurs ? – vient-elle d’un stagiaire zélé ou indique-t-elle une nouvelle forme de communication pour l’université d’été du Medef : accueillir des débats houleux ? Car on remarquera qu’aucun chercheur parmi les spécialistes de l’extrême droite n’avait été invité.
Comment analysez-vous la première année de M. Roux de Bézieux à la tête du Medef ?
Et de son équipe ! Car la présidence est un peu moins personnalisée que par le passé. Ils sont parvenus à naviguer entre plusieurs récifs conjoncturels : un président de la République qui fait une partie de leur politique mais sans leur donner voix publiquement au chapitre – d’où un satisfecit retenu, insistant sur la nécessité d’aller encore plus loin, notamment du côté des prélèvements obligatoires et de l’âge de la retraite – ; un mouvement social des « gilets jaunes » qui ignore la plupart des patrons et dont les chefs d’entreprise s’en sortent par une prime d’Etat et des primes facultatives ; enfin, un slalom, dont on ne sait s’il sera réussi, entre les intérêts contradictoires de ses composantes pour l’application du bonus-malus [sur les contrats courts] et le choix des niches fiscales.
Mais le programme du Medef issu des cogitations patronales organisées durant le grand débat a débouché sur 43 propositions qui ne forment pas vraiment un corps de doctrine original et n’ont guère été reprises dans le débat public.
Est-ce plus facile pour le patron des patrons d’être face à un gouvernement décrit comme pro-business ?
Roux de Bézieux est entré dans le rôle de président, avec son style propre qui tient à sa trajectoire entrepreneuriale passée – il est issu des nouveaux services, plus parisien, plus inséré dans des cercles de sociabilité plus élitistes – et à son positionnement dans l’organisation. Il décline beaucoup moins une posture victimaire qui a été une des thématiques du mandat de Pierre Gattaz.