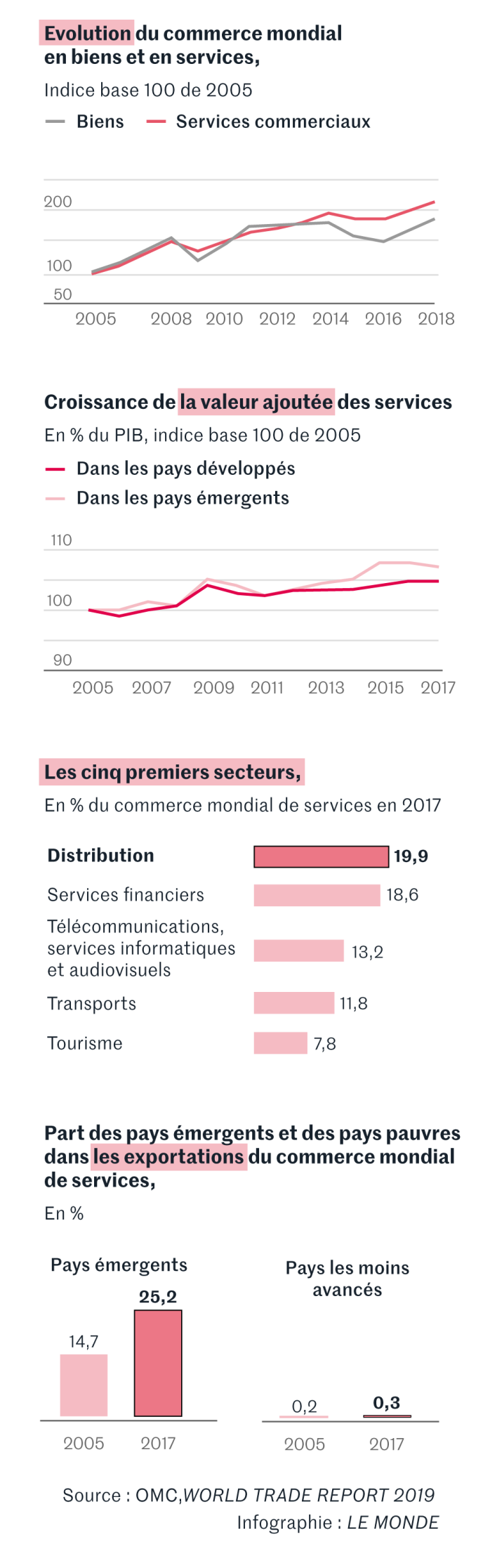Les chiffres chocs d’une enquête européenne sur les violences sexistes au travail
Un sondage réalisé dans cinq pays de l’Union et publié samedi révèle que 60 % des femmes ont subi des atteintes au cours de leur carrière.
Article réservé aux abonnés

Six Européennes sur dix ont été un jour confrontées, au cours de leur carrière professionnelle, à des violences sexistes ou sexuelles. C’est l’un des chiffres chocs de l’enquête sur le sexisme au travail réalisée par l’IFOP pour la Fondation Jean-Jaurès et la Fondation européenne d’études progressistes, publiée samedi 12 octobre.
Ce travail a pour ambition de combler un manque : les dernières données sur le sujet remontent à 2014 pour la France (une enquête du Défenseur des droits) et elles datent de 2012 pour l’Europe (issues de l’Agence européenne des droits fondamentaux).
Cinq mille femmes, qui ont été interrogées en avril dans cinq pays de l’Union européenne (UE) – Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni –, témoignent de cette réalité contemporaine, malheureusement bien enracinée. Pour éviter que certains faits passent sous les radars, toute une série d’agissements, répétés ou non, allant du regard concupiscent jusqu’au rapport sexuel contraint, ont été passés à la loupe.
A chaque fois, les femmes ont été interrogées sur leur expérience au long de la vie et au cours de l’année écoulée. Sur cette période plus restreinte, 21 % des femmes en moyenne (18 % en France) se disent victimes d’au moins une manifestation de sexisme ou de harcèlement sexuel. Leurs réponses, qui s’inscrivent dans des contextes culturels différents, avec des seuils de tolérance qui peuvent varier, restent cependant éloquentes.
« La violence est une réalité quasi quotidienne pour une grande partie des femmes au travail », résume Juliette Clavière, directrice de l’Observatoire de l’égalité femme-homme de la Fondation Jean-Jaurès.
Sifflements et gestes grossiers
C’est en Espagne et en Allemagne que les femmes se déclarent plus volontiers victimes d’atteintes sexuelles ou sexistes au travail au cours de leur vie, respectivement 66 % et 68 % d’entre elles – contre 55 % des Françaises.
Gare toutefois aux interprétations hâtives, met en garde François Kraus, directeur du pôle « Genre, sexualité et santé sexuelle » de l’IFOP. La réponse aux questions dépend aussi du seuil de tolérance des femmes interrogées. Dans ces deux pays, des politiques publiques volontaristes sur le sexisme et des polémiques nationales récentes (vague d’agressions en Allemagne, affaire de la « meute » en Espagne) ont probablement eu un effet sur les consciences, estime-t-il.