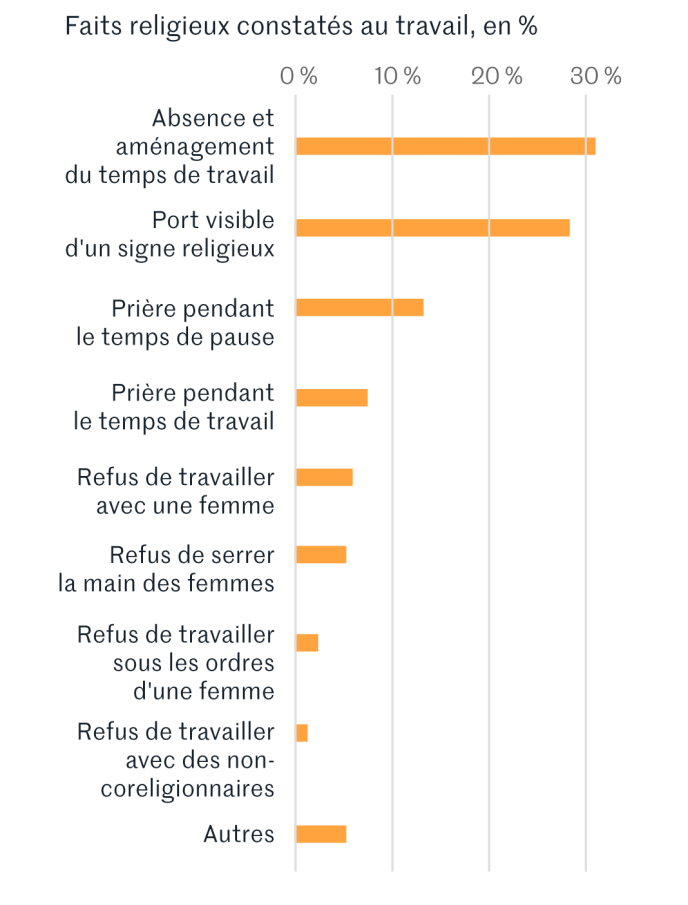Selon le collectif féministe Les Glorieuses, les Françaises travaillent bénévolement à partir de ce mardi et jusqu’à la fin de l’année. Pour rattraper la différence de salaires entre hommes et femmes, ces dernières « pourraient s’arrêter de travailler le 5 novembre à 16 h 47 », avance le collectif, qui s’inspire d’une initiative islandaise.
-
Pourquoi cette date et cette heure ?
Le collectif explique s’être appuyé sur un chiffre fourni par Eurostat, l’organisme de statistiques de l’Union européenne, qui établit que « les Françaises gagnent 15,4 % de moins que les hommes ».
Sur la base de journées de sept heures et avec cinq semaines de congés, le collectif a ensuite appliqué ce rapport au nombre de jours ouvrés en 2019 (251 jours, en excluant les week-ends et les jours fériés). On arrive alors à un total de 38,65 jours ouvrés « non payés » pour les femmes. En retranchant ce total aux jours ouvrés à partir du 31 décembre, le collectif a abouti à la date du 5 novembre à 16 h 47.
-
Plusieurs mesures des inégalités salariales
Sauf que la donnée de départ – 15,4 % d’écart salarial – est elle-même sujette à débat. Pour l’Institut national de la statistique et des études économique (Insee), dont les chiffres les plus récents ne prennent en compte que le secteur privé, cet écart est de 18,5 %. Pour l’OCDE, il est de 9,9 %. Il est difficile d’avoir une réponse unique, puisque, en fonction des organismes ou des institutions, les méthodes pour calculer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes diffèrent sensiblement (salaire brut ou non, équivalent temps plein ou contrats, moyenne ou médiane, etc.).
Ce qui semble sûr, c’est qu’en comparant les salaires à postes et âges équivalents, « il demeure 9 % d’écarts de salaire injustifiés entre les femmes et les hommes », souligne le ministère du travail. L’Observatoire des inégalités qualifie cet écart de « discrimination pure ». Il souligne en outre le choix politique qui a été opéré en décidant de présenter les inégalités du point de vue masculin ; combien les femmes touchent de moins que les hommes et non combien les hommes touchent de plus que les femmes.
Reprenant le chiffre de l’Insee, l’Observatoire calcule : « Lorsque les hommes touchent 100, les femmes reçoivent 81,5. Elles perçoivent ainsi 100 – 81,5 = 18,5 de moins. (…) Si l’on rapporte l’écart de 18,5 aux 81,5 des femmes, cela fait 18,5 divisés par 81,5 = 23 %. Les hommes touchent donc 23 % de plus que les femmes. Si on arrive à un résultat différent, c’est parce que les pourcentages ne sont pas réversibles, car ils ne s’appliquent pas à la même base de départ. (…) Aucune des deux méthodes n’est plus “juste” ou meilleure. Mais il est frappant de constater que celle qui aboutit au chiffre le plus faible s’est imposée dans le débat public. »
-
Un écart qui ne se résorbe pas
La date choisie, quelle qu’elle soit, est avant tout symbolique pour montrer les inégalités significatives dans les salaires entre les femmes et les hommes. Or « depuis cinq ans, les pouvoirs publics font bouger les lignes de l’égalité salariale, mais ces efforts ne suffisent pas. Nous avons certes observé une évolution à hauteur de 0,5 point, sauf qu’à ce rythme-là, ce ne sera qu’en 2168 que les femmes seront aussi bien rémunérées que les hommes », soulignent Les Glorieuses.
« ) } }, « legend »: { « enabled »: « », « reversed »: « », « layout »: « horizontal », « verticalAlign »: « top », « align »: « left », « margin »: 40, « y »: -30, « x »: 0, « itemStyle »: { « fontSize »: 13, « font-family »: « ‘Marr Sans’,Helvetica,arial », « fontWeight »: « normal », « color »: « #2A303B » }, « itemMarginBottom »: 10 }, « series »: [ { « stack »: « null », « name »: « France », « lineWidth »: 2, « color »: « #D2AD5C », « type »: « », « yAxis »: « 0 », « visible »: true, « dataLabels »: { « enabled »: false }, « step »: « », « data »: [ [ 15.4, « », « pt0 », true, false ], [ 17.3, « », « pt1 », false, false ], [ 16.9, « », « pt2 », false, false ], [ 15.2, « », « pt3 », false, false ], [ 15.6, « », « pt4 », false, false ], [ 15.7, « », « pt5 », false, false ], [ 15.6, « », « pt6 », false, false ], [ 15.5, « », « pt7 », false, false ], [ 15.5, « », « pt8 », false, false ], [ 15.3, « », « pt9 », false, false ], [ 15.3, « », « pt10 », false, false ], [ 15.4, « », « pt11 », true, false ] ], « keys »: [ « y », « color », « id », « marker.enabled », « dataLabels.enabled » ] } ], « accessibility »: { « enabled »: true }, « exporting »: { « enabled »: false }, « credits »: { « enabled »: false }
} );
});
Plusieurs facteurs expliquent que cet écart demeure : les secteurs dans lesquels les femmes constituent la majorité des travailleurs continuent d’afficher des niveaux de salaires inférieurs à ceux constatés dans les secteurs à dominante masculine ; les femmes restent sous-représentées aux postes à responsabilité et de direction, et elles travaillent toujours moins longtemps et plus souvent à temps partiel afin de pouvoir concilier responsabilités familiales et activité rémunérée. Ce constat n’est pas vrai qu’en France : plus diplômées que les hommes, les Européennes sont moins bien payées.
-
A-t-on le droit de quitter le travail mardi à 16 h 47 ?
Le collectif Les Glorieuses n’appelle ni à faire grève ni à quitter le travail. « Ni un syndicat, ni une organisation politique, nous n’appelons pas les femmes à arrêter de travailler, nous demandons en revanche des actions concrètes et rapides pour endiguer les inégalités salariales en une génération… » Il appelle par exemple les pouvoirs publics à mettre en place davantage d’actions concrètes, notamment un congé paternité équivalent au congé maternité post-accouchement « afin de cesser de discriminer les femmes en obligeant les pères à s’absenter à leur tour ».
Mais que se passe-t-il si, à titre individuel, des femmes souhaitaient protester contre les inégalités salariales en cessant le travail mardi 5 novembre à 16 h 47 ? Des précautions sont à prendre, car quitter son poste sans prévenir pourrait être considéré comme une « absence injustifiée », voire un « abandon de poste ». Il s’agit donc de prévenir l’employeur en amont et de lui signifier la raison de cette absence. Ce geste s’apparente alors au droit de grève, qui est garanti par la Constitution. Attention, dans la fonction publique, pour faire grève, il faut avoir déposé un préavis au moins cinq jours avant le début du mouvement.