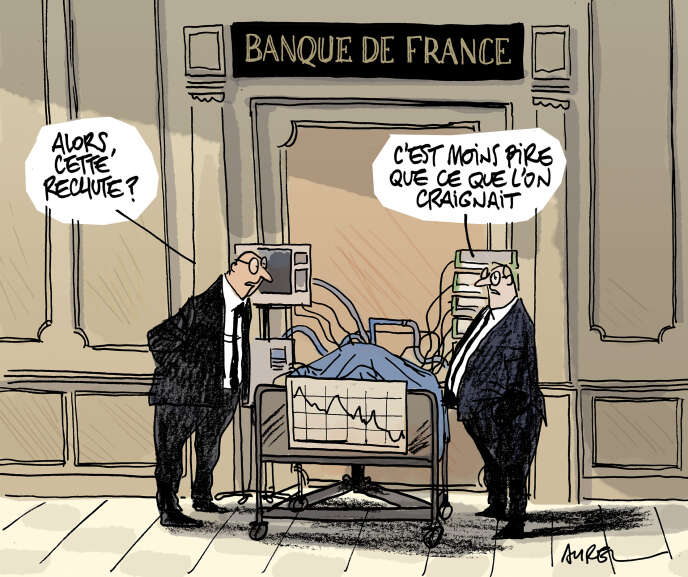La MAIF parie sur « le goût des autres » pour améliorer ses performances

Devenue « société à mission » en juillet, la MAIF a tenu son premier comité de mission mercredi 4 novembre sous la présidence de Nicole Notat. Choix hautement symbolique que celui de la coautrice du rapport Senard, à l’origine de la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises).
Avec ce texte du 22 mai 2019, les entreprises ont obtenu les moyens d’engager publiquement les actionnaires sur leurs choix sociaux et environnementaux. « Au-delà de la MAIF, on constate énormément de contentieux d’entreprise prises en défaut sur ces sujets jusqu’à l’autre bout du monde. Il y a désormais un écosystème très attentif aux pratiques de l’entreprise. Il ne peut plus y avoir de frontière étanche entre l’intérêt économique et celui des parties prenantes Les facteurs RSE [responsabilité sociétale des entreprises] deviennent ainsi consubstantiels à la performance de l’entreprise », explique Nicole Notat.
La loi Pacte prévoit que la « raison d’être » de l’entreprise soit inscrite dans les statuts et votée en assemblée générale par les actionnaires. Ce qui fut fait pour la MAIF en ces termes : « une attention sincère portée à l’autre et au monde ». On imagine mal une entreprise affirmer le contraire. Une simple définition de belles intentions ne suffit pas pour autant à transformer une entreprise et encore moins à contraindre des actionnaires de respecter des engagements sociétaux qui pourraient contrarier à court terme des intérêts économiques, quand bien même la raison d’être leur serait opposable lors de l’assemblée générale annuelle.
Entreprise responsable
C’est pourquoi un comité de mission est prévu par la loi Pacte pour contrôler la mise en œuvre de la « raison d’être » à tous les échelons de l’entreprise, afin qu’elle ne se résume pas à de la pure rhétorique, autrement dit au greenwashing qui discrédita la RSE.
D’ici la fin de l’année, la MAIF doit avoir traduit ses objectifs très théoriques de « société solidaire » et d’« épanouissement de ses acteurs » dans une feuille de route beaucoup plus concrète qui sera validée par le comité de mission en janvier 2021. « Le rôle du comité est triple, indique le directeur général de la MAIF, Pascal Demurger, cadrer la feuille de route annuelle avec des objectifs précis et chiffrés, vérifier les résultats et élaborer un rapport de mission qui sera publié, puis servir d’aiguillon pour aller plus loin dans les engagements de chacun des métiers ».
Il vous reste 47.22% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.