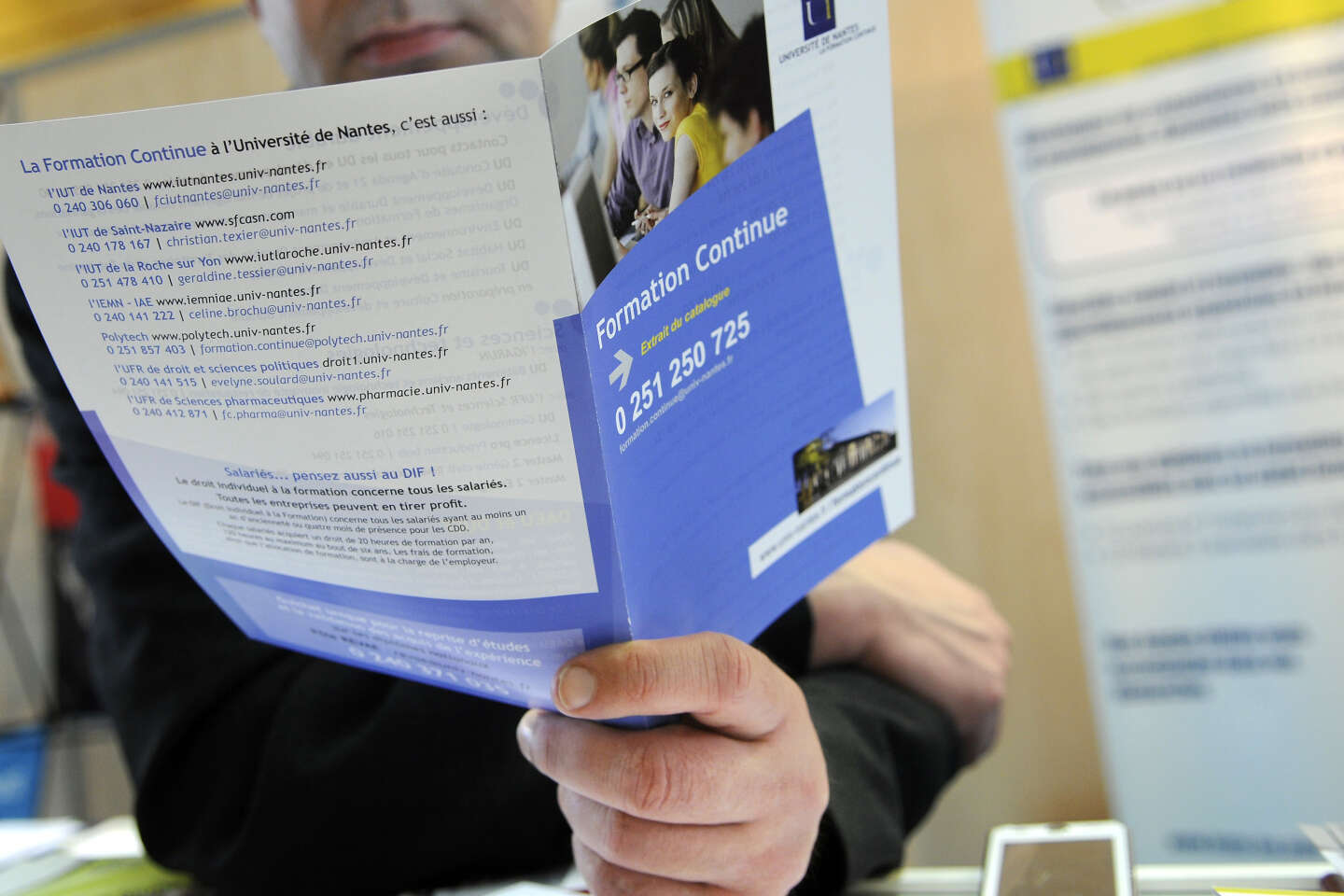Paul Boulanger, spécialiste du biomimétisme : « Les entreprises ont tout intérêt à s’inspirer du vivant »

Paul Boulanger, spécialiste du biomimétisme et fondateur du cabinet de conseil Pikaia, invitent les employeurs à s’inspirer du vivant, un monde aussi incertain et complexe que celui de l’entreprise, un monde qui est dans une démarche d’adaptation permanente.
Pourquoi peut-on à vos yeux, établir un lien entre le monde du vivant et les stratégies des entreprises ?
C’est tout l’enjeu du biomimétisme. Cette méthode consiste à s’inspirer du vivant pour trouver des solutions à des enjeux – techniques ou stratégiques – rencontrés par les humains. S’approcher du vivant est un levier qui peut permettre aux dirigeants de relever deux défis auxquels ils vont être de plus en plus confrontés.
Le premier est de mieux comprendre les impacts de leurs activités sur la biosphère, leurs interdépendances également. Cela me semble indispensable à l’heure du changement climatique, afin d’agir en responsabilité. Second défi : les entreprises évoluent dans un environnement de plus en plus complexe, incertain, qui rend la décision difficile. Face à cela, pourquoi ne pas s’inspirer des modes de fonctionnement que des systèmes complexes – le vivant – ont inventé depuis 3,8 milliards d’années ?
Face à ce monde incertain, vous appelez justement à appliquer quelques « principes de base », notamment dans notre rapport à l’énergie…
Pour se déployer, une stratégie de biomimétisme doit intégrer une visée de développement durable. C’est un élément incontournable qui passe notamment par un rapport attentif à nos dépenses d’énergie. Le vivant sait que cette énergie est tout à la fois rare et essentielle. Lorsque cela est possible, il peut mettre en place des innovations pour l’économiser. L’entreprise doit elle aussi appliquer le principe de pondération et faire des compromis entre les besoins du moment en énergie, les disponibilités, les moyens de stockage, les capacités d’action… Elle doit éviter le gaspillage, notamment de l’énergie humaine. Celui-ci intervient tout particulièrement lorsque les intérêts des salariés ne sont pas alignés avec ceux de l’entreprise ou qu’une vision court-termiste domine au sein des organisations.
Vous abordez également la question de l’apprentissage. Que peut nous enseigner le monde du vivant à ce sujet ?
C’est un sujet qui est particulièrement bien documenté par les sciences humaines et sociales. Ceci étant, je pense que le biomimétisme peut également nous être utile. Il y a des modes d’apprentissage intéressants dans le monde animal ou végétal qu’on pourrait développer chez les humains.
Il vous reste 53.49% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.