Innover au plus près des salariés et avec leur participation
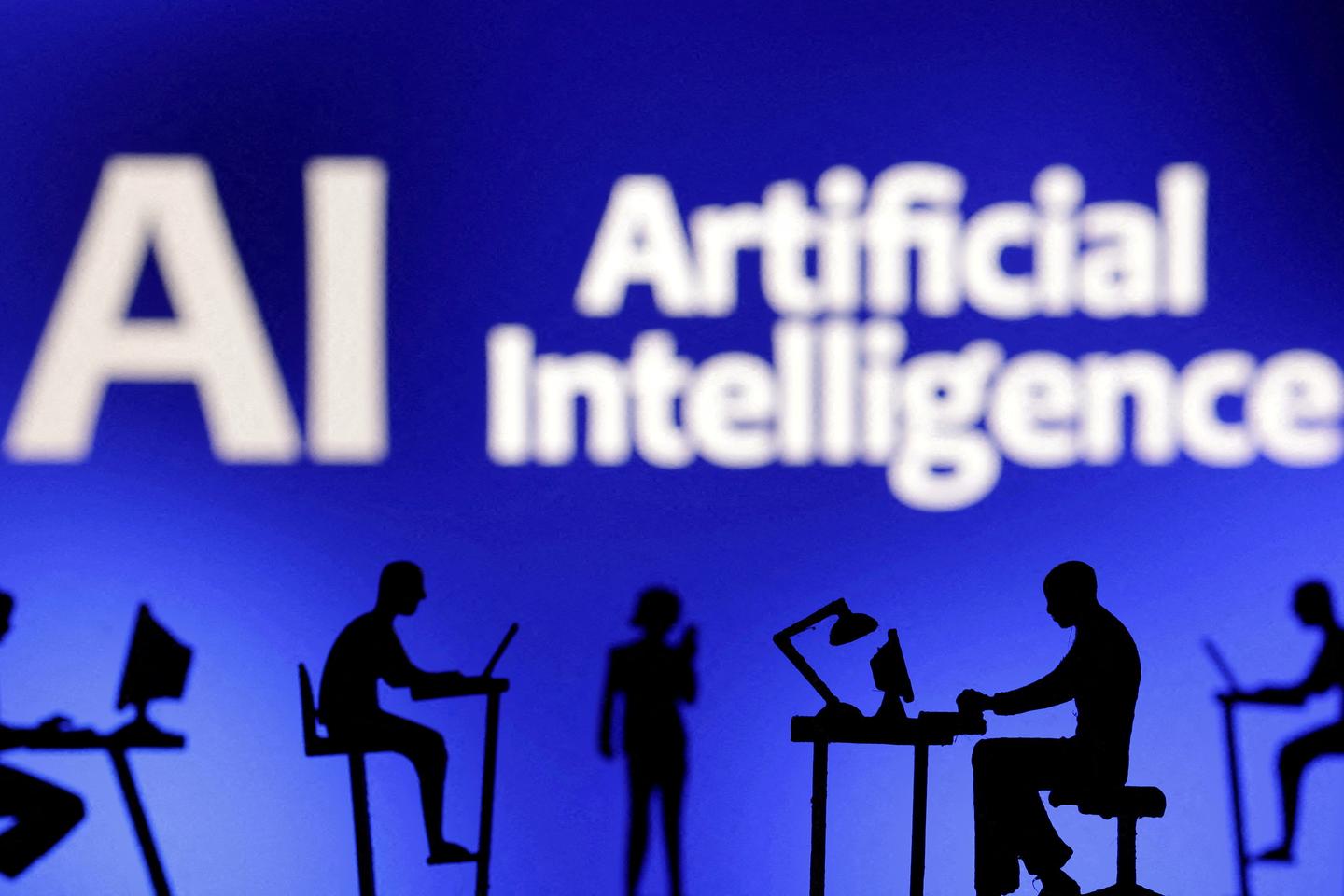
Qu’est devenue l’innovation dans les entreprises ? Les start-up y participent-elles toujours ? Une dizaine de responsables des ressources humaines se sont retrouvés le 15 octobre à Paris pour répondre à ces questions, dans le cadre des Rencontres RH, le rendez-vous mensuel de l’actualité des ressources humaines organisé par Le Monde en partenariat avec ManpowerGroup Talent Solutions et Malakoff Humanis.
Après un rappel des différentes missions de l’innovation au sein de la fonction RH par Jean-Marie Peretti, professeur titulaire de la chaire Essec Changement et de la chaire Innovation managériale et excellence opérationnelle, de l’Essec Business School, les invités ont constaté, à travers leurs échanges, un retour de l’innovation au plus près du terrain avec un effet d’entraînement pour l’ensemble de l’entreprise. Ces dernières années, « les incubateurs de start-up sont moins mis en avant par les grands groupes et les pratiques deviennent de plus en plus collaboratives », résume Jean-Marie Peretti.
Pour le professeur en sciences de gestion, la fonction RH est extrêmement innovante sur quatre piliers : dans sa partie administrative pour intégrer l’intelligence artificielle ; en termes de mesures, car pour progresser on doit mesurer ; dans son rôle stratégique pour décarboner ; et enfin dans sa mission de conduite du changement. Et « l’on constate que plus la fonction RH est innovante, plus les salariés sont engagés dans l’entreprise », précise Jean-Marie Peretti.
Simplifier l’accès à l’information
Les responsables RH présents ont expliqué comment la conviction que « les bonnes idées viennent du terrain » a guidé leurs innovations récentes pour répondre à des objectifs différents, par exemple pour organiser le développement de carrière des salariés du cabinet d’audit et de conseil Forvis Mazars.
Le mutualiste Malakoff Humanis devait répondre aux problèmes particuliers des salariés : « Le post-Covid avait amené beaucoup de nouvelles problématiques », décrit la directrice prospective RH Valérie Mussard. L’entreprise a préféré simplifier l’accès à l’information plutôt que de créer de nouveaux produits : « On a créé des parcours digitaux avec un accès par “élément de vie”, comme “je suis en télétravail” ou “je viens d’entrer en congé thérapeutique” pour répondre aux questions particulières, avec le niveau de détail choisi par le salarié. »
Pour améliorer l’efficacité opérationnelle, ManpowerGroup Talent Solutions mise sur le fait qu’avec l’intelligence artificielle (IA) la technologie est devenue très accessible à tous sans passer par les services informatiques, mais dans le respect des normes de sécurité. « L’idée est d’intégrer l’esprit start-up sur le terrain avec les salariés plutôt que de faire appel aux start-up », explique Sandrine Saraiva, directrice innovation digitale du cabinet de conseil en recrutement. L’entreprise y ajoute une once d’obligation de résultat ou tout du moins de contrôle : « Ce que chaque collaborateur a produit comme innovation dans l’année est devenu une des questions de l’entretien annuel », précise Sandrine Saraiva.
Il vous reste 38.49% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.







L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.