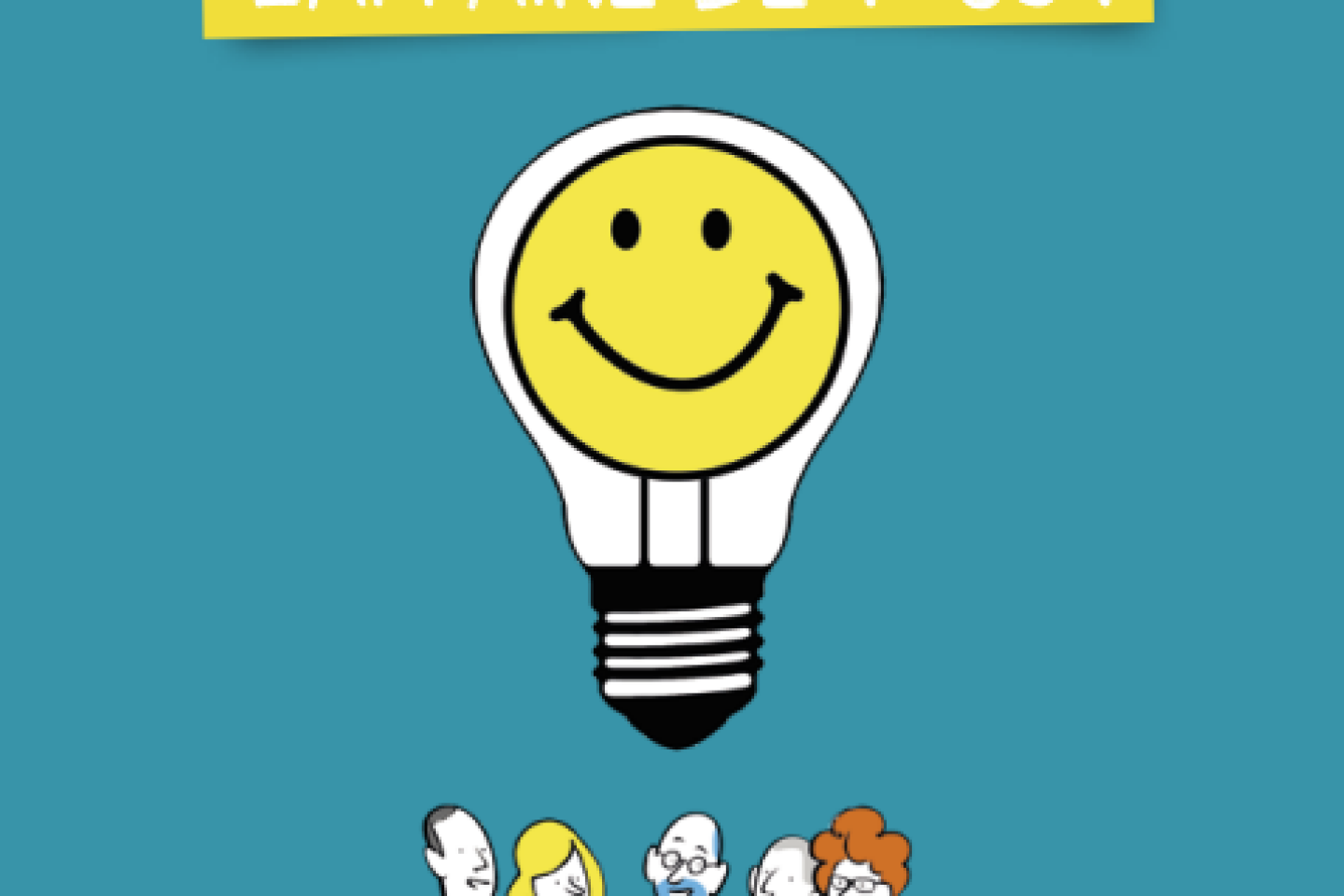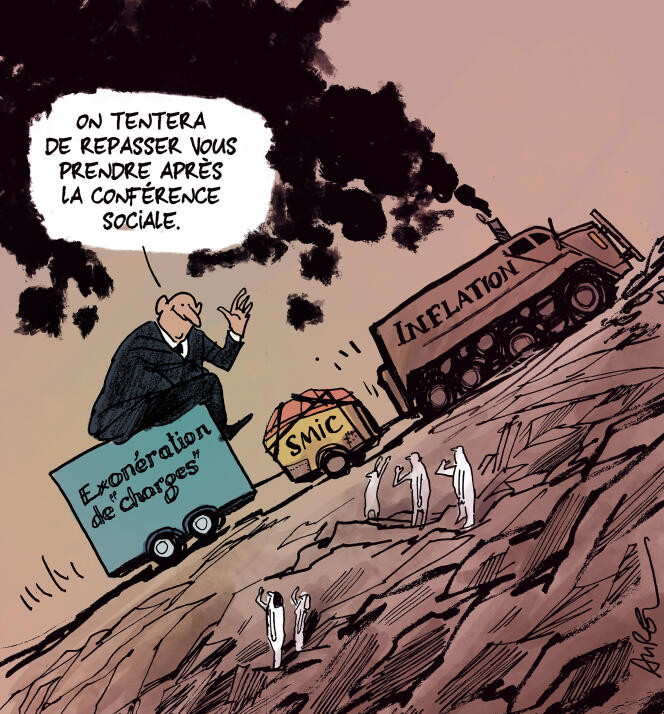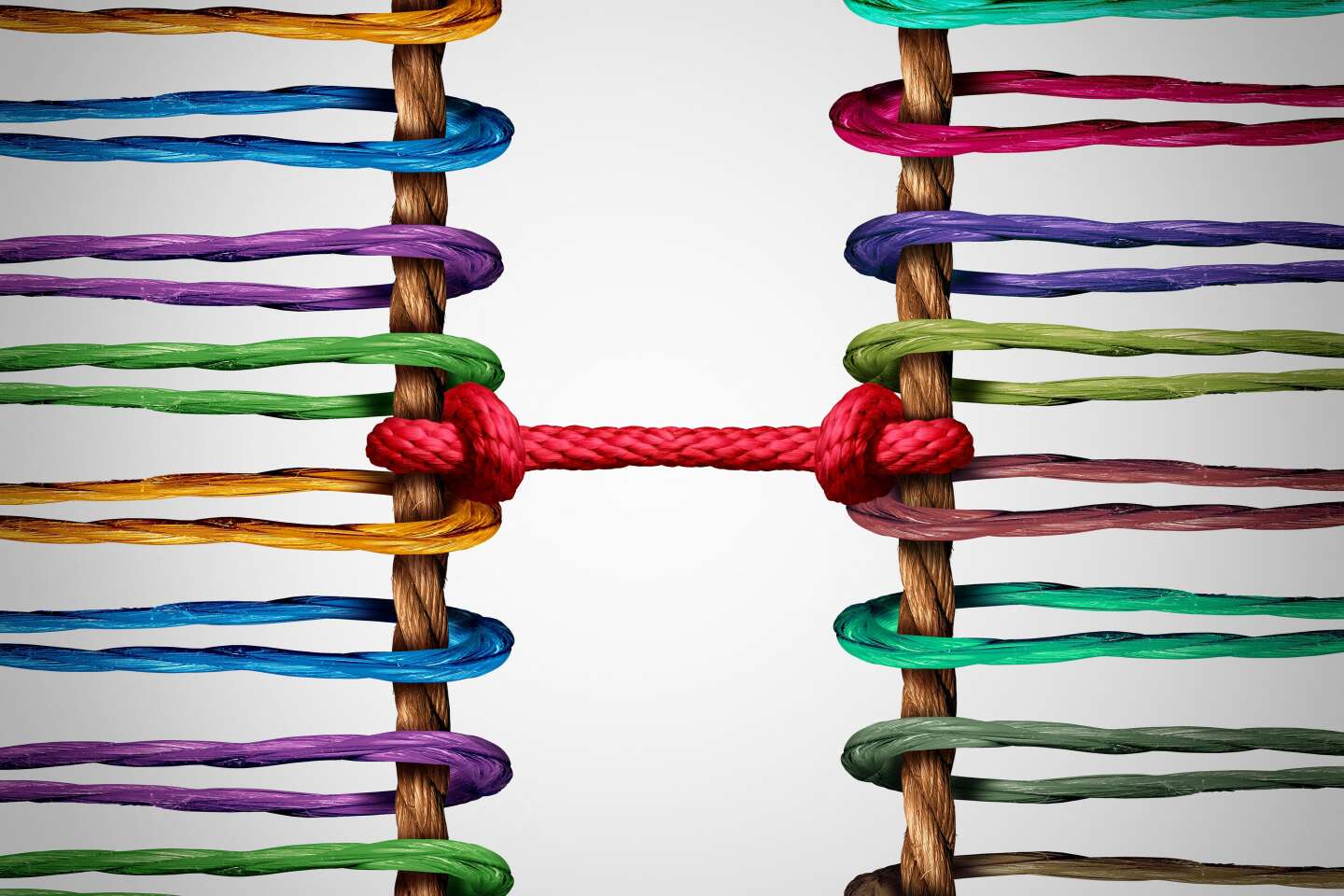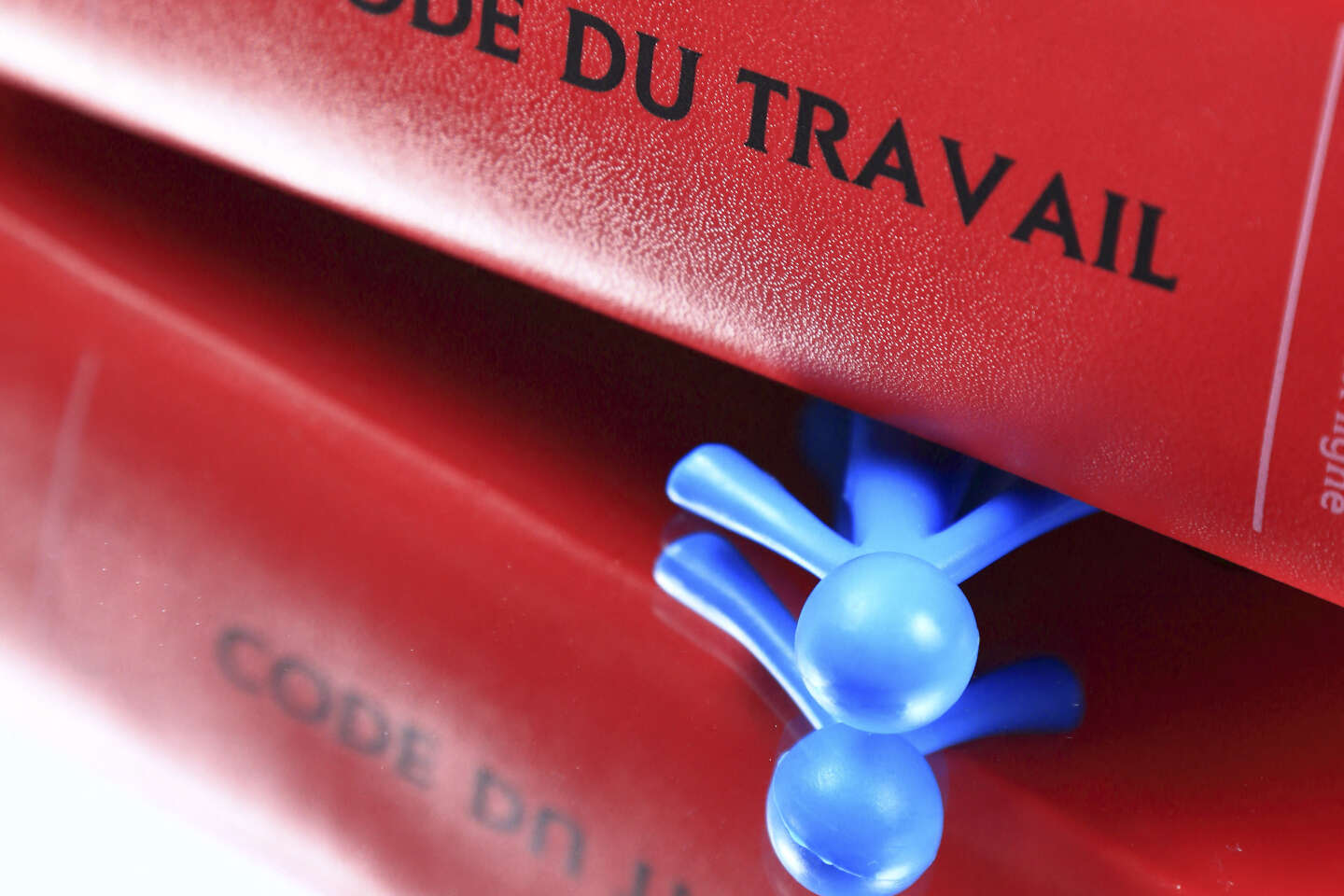Olivier De Schutter, rapporteur de l’ONU sur les droits humains : « Il faut mieux rémunérer le travail qui a la plus grande valeur pour la société »

L’Europe affronte une crise du pouvoir d’achat aux proportions inédites. En 2022, l’inflation était de 9,6 % en moyenne dans les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et de 9,2 % dans l’Union européenne (UE), selon Eurostat. Or, les salaires n’ont augmenté dans le même temps que de 4,4 % dans l’UE, ce qui signifie une baisse des salaires réels de l’ordre de 2,4 % en Europe ; en Italie, les salaires réels se situent aujourd’hui à un niveau de 12 % au-dessous de ce qu’ils étaient en 2008. Le phénomène est mondial : l’Organisation internationale du travail (OIT) rapporte que, pour la première fois dans ce siècle, les salaires réels ont chuté (de 0,9 %) en 2022. En outre, les inégalités vont augmenter, car les plus précarisés consacrent une part plus importante de leurs revenus à des biens et des services essentiels tels que l’énergie, l’alimentation et la mobilité, dont les prix ont augmenté plus vite encore que les autres composantes des budgets des ménages.
L’affaiblissement des syndicats, la mondialisation et la menace de délocalisations, le développement du travail précaire (y compris du travail sur des plates-formes) : tout cela contribue à expliquer que, partout, la part du travail en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) diminue depuis les années 1980. Elle est passée, par exemple, de 66,1 % à 61,7 % entre 1990 et 2009 dans les pays de l’OCDE.
Or, en parallèle, émerge le sentiment que les salaires ne reflètent pas la véritable valeur du travail fourni. Au-delà du cas extrême des personnes offrant du temps non rémunéré au sein du ménage ou de la communauté (en majorité des femmes), le malaise est général : les professions les plus utiles socialement, qui relèvent du « care » ou de l’entretien des communs, sont les moins valorisées.
Dans une étude sur les emplois devenus « essentiels » lors de la pandémie de Covid-19, l’OIT a constaté que les « travailleurs essentiels » (qui sont le plus souvent des travailleuses) gagnaient, en moyenne, 26 % de moins que les autres, alors qu’un tiers au moins de cet écart ne peut pas s’expliquer par des différences de qualifications. En d’autres termes, les travailleurs et travailleuses qui fournissent des services vitaux à la société, dans des secteurs tels que la production et le commerce de détail alimentaires, les soins de santé, le nettoyage et l’assainissement ainsi que les transports, sont sous-payés.
Manque de reconnaissance
Rien d’étonnant à cela : alors que la véritable contribution du travail au bien-être général ne peut se limiter à la valeur ajoutée monétaire, le pouvoir de négociation des travailleurs dépend en grande partie de ce que le consommateur final du bien ou du service paiera. Or, les bénéficiaires des services que fournissent les employés du « care » ne veulent pas ou ne peuvent pas payer davantage. C’est une raison supplémentaire du malaise : en raison de la manière dont la valeur du travail est actuellement estimée sur le marché du travail, celui-ci sera d’autant moins bien rémunéré qu’il répond aux besoins des personnes à faibles revenus, plutôt qu’à la demande qu’expriment les ménages les plus aisés.
Il vous reste 52.65% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.