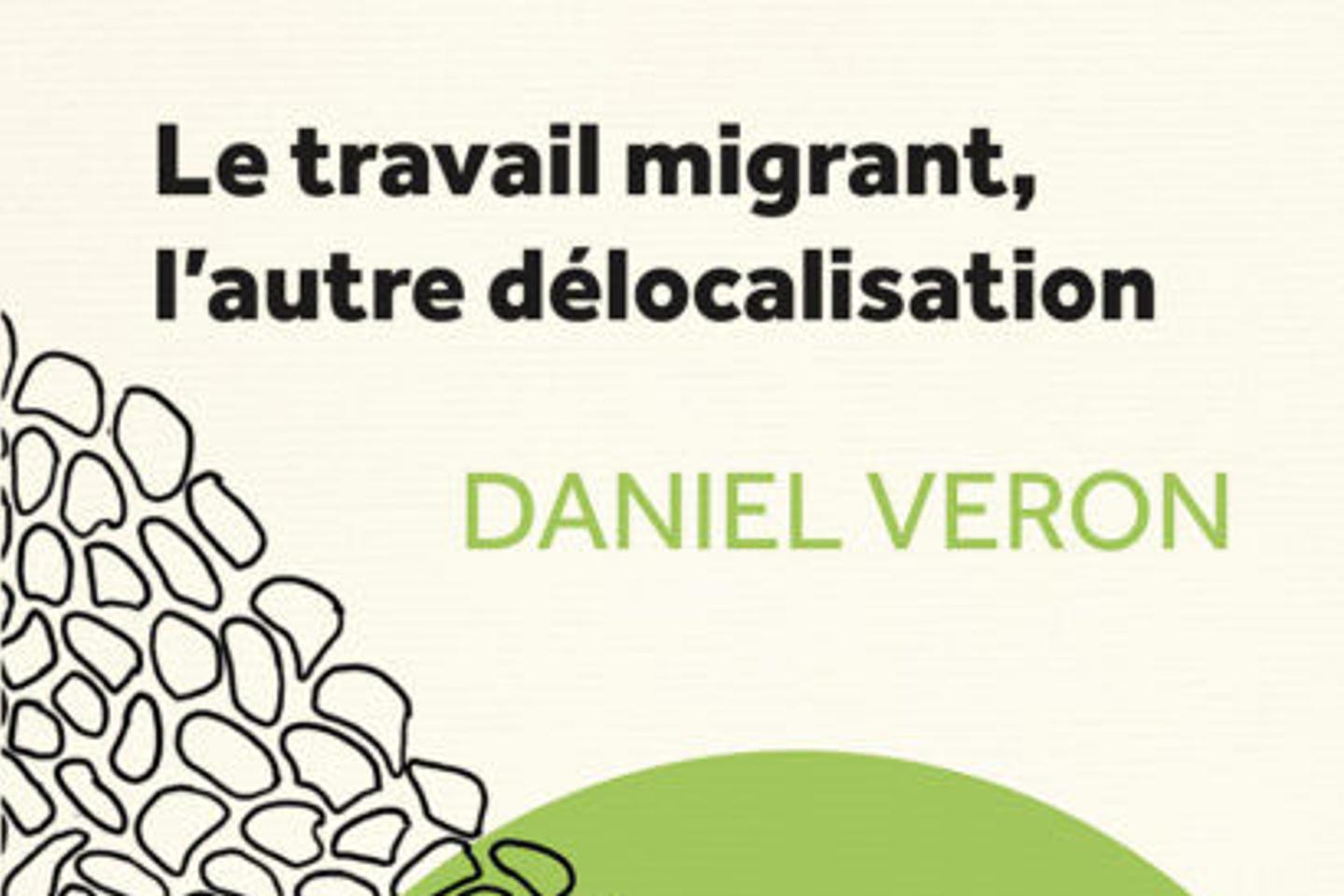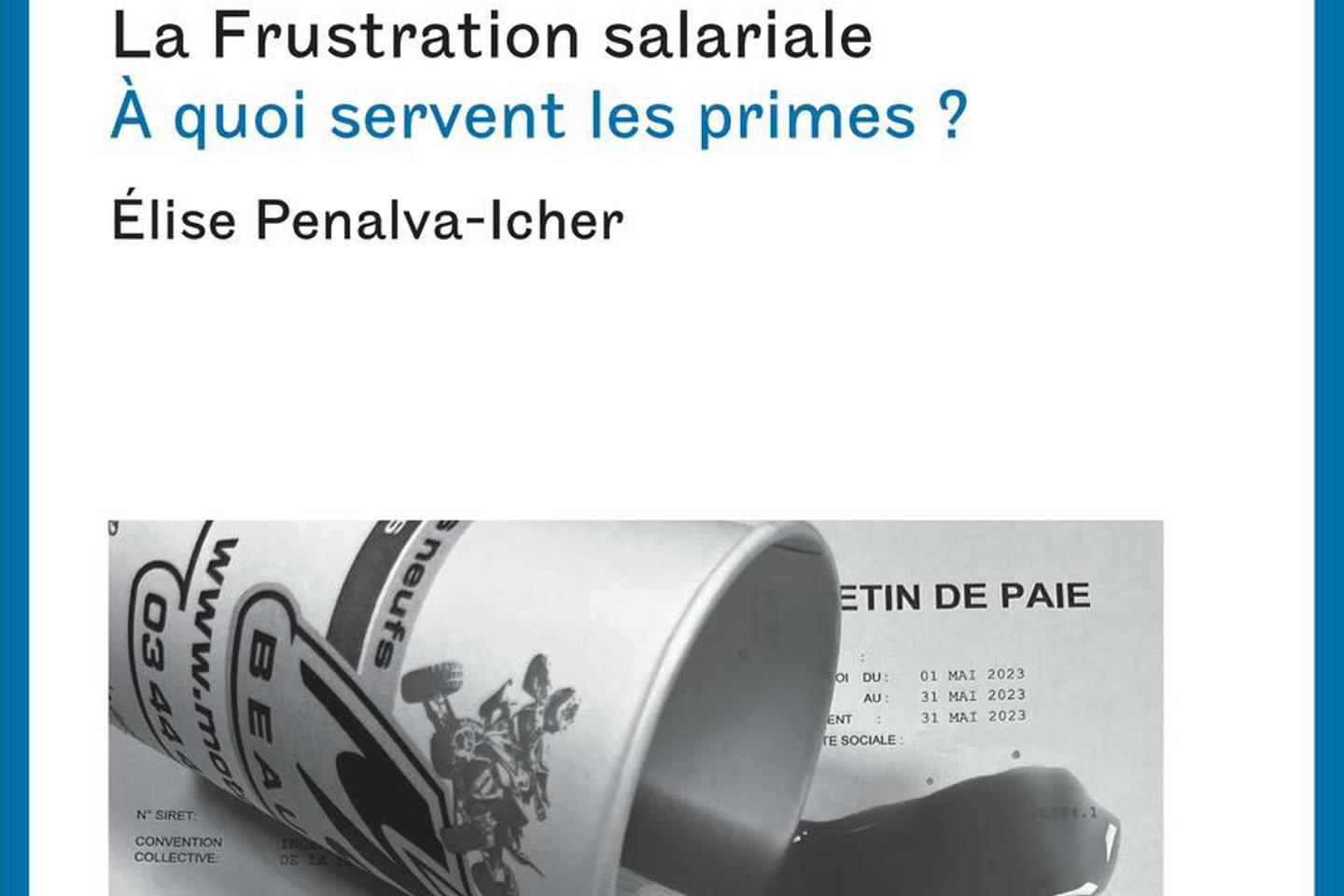La qualité de l’environnement social stagne en Europe, aux dépens des femmes

L’étude European Working Conditions Survey d’Eurofound couvre, depuis sa création en 1990 et tous les cinq ans, tous les éléments contribuant à la qualité du travail. De l’environnement social découlent le bien-être et la productivité des salariés. En positif, Eurofound évalue le degré de bienveillance de l’entourage professionnel.
En clair, celui-ci contribue-t-il au bien-être, à la progression et à l’épanouissement des salariés ? Dans l’édition 2024, 73 % des travailleurs en Europe affirment être soutenus la plupart du temps, voire toujours, par leurs collègues. Le satisfecit est moindre, mais encore majoritaire, dans leur rapport avec les manageurs : 64 % des hommes et 65 % des femmes affirment obtenir leur soutien.
Depuis 2005, la France a largement comblé son retard par rapport à la moyenne européenne : 74 % des répondants s’y sentent désormais soutenus par leurs collègues, 68 % par leurs manageurs. Mais « cela signifie tout de même qu’un tiers des manageurs ne font pas bien leur travail, ça représente un coût caché considérable pour les entreprises », relativise Laurent Cappelletti, enseignant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).
Danemark et management participatif
Autre constat de l’enquête, les pratiques managériales hexagonales impliquent moins les salariés, ajoute Agnès Parent-Thirion, directrice de recherche chez Eurofund : les salariés en France sont ainsi moins consultés sur les objectifs qu’on leur assigne, leurs conditions de travail ou leurs idées qu’au Danemark, un pays en pointe pour le management participatif.
De fortes différences entre activités émergent par ailleurs : 20 % des travailleurs des transports affirment recevoir rarement ou jamais de soutien de collègues, 15 % rarement ou jamais de leur manageur. Dans ce secteur, chacun tend donc à se débrouiller seul en cas de problème. Cette situation aggrave la pénibilité pour les personnes concernées, qui endurent souvent des horaires décalés ou des comportements hostiles de passagers. « Paradoxalement, ces métiers qui requièrent davantage de soutien managérial en obtiennent moins. Dans les transports, cela tient à une culture professionnelle viriliste, où il faut savoir encaisser et se taire », commente Laurent Cappelletti.
Il vous reste 51.83% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.