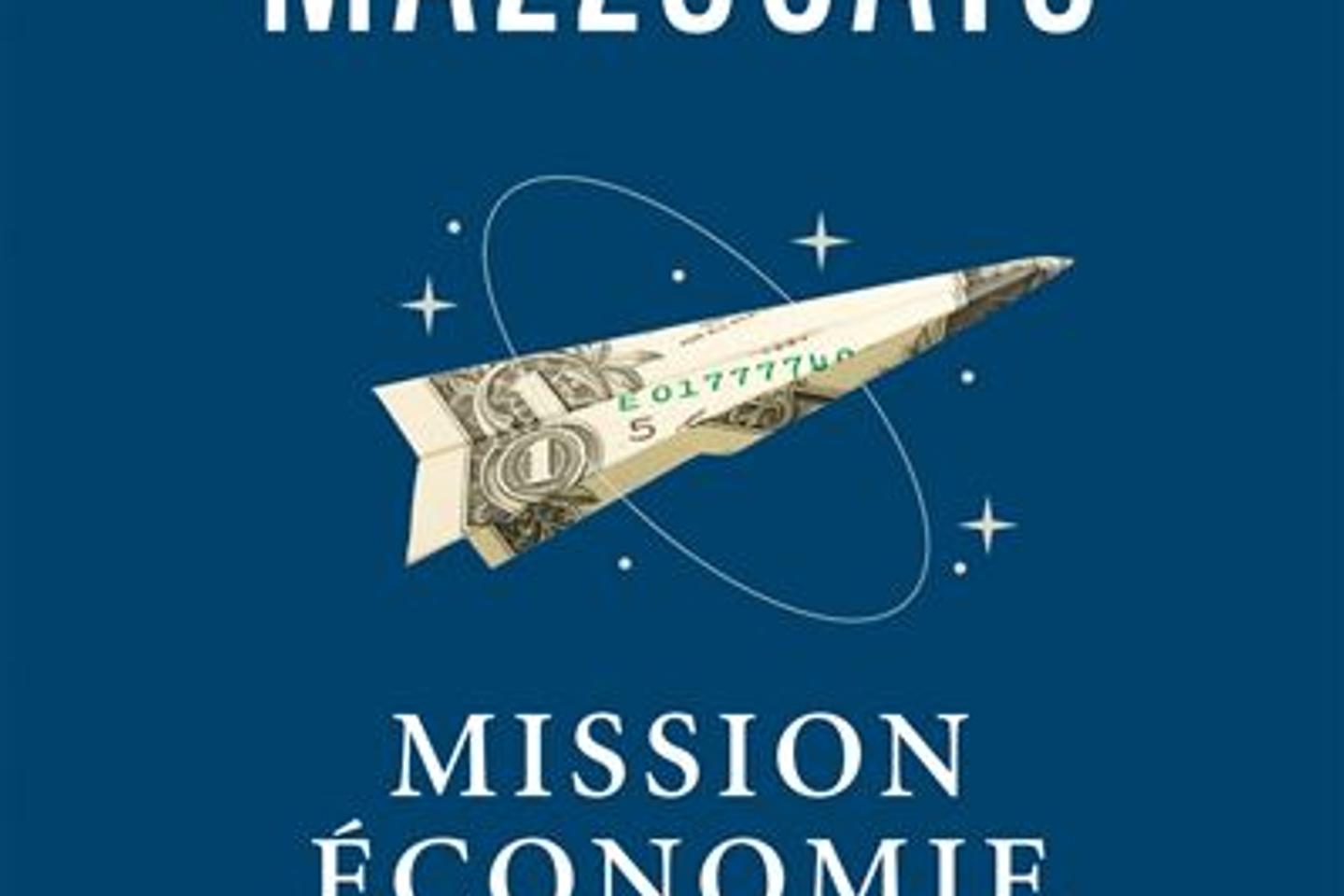Droit social. « La libre communication des pensées et des opinions est l’un des droits les plus précieux de l’Homme » (1789). Au pays de Voltaire, la jurisprudence se montre très libérale lorsqu’elle statue sur de très, très vifs propos tenus par les salariés. La situation des manageurs est spécifique, et de plus en plus en fonction de leur niveau hiérarchique.
Depuis la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise, le salarié-citoyen, hier avant tout subordonné, est devenu un citoyen-salarié (Pouvoirs du chef d’entreprise et libertés du salarié, de Laurence Pécaut-Rivolier, Yves Struillou et Philippe Waquet, Economica, 568 pages, 67 euros).
Toutefois, l’entreprise n’étant pas une place publique, mais un lieu de production par une communauté de travail, et les dérapages de quelques-uns pouvant coûter cher à tous : « Même si la bonne foi contractuelle n’implique pas une obligation de réserve entraînant la sujétion du travailleur aux intérêts de l’employeur, certaines manifestations du droit à la liberté d’expression qui pourraient être légitimes dans d’autres contextes ne le sont pas dans le cadre de la relation de travail » (cour de Strasbourg (CS), 12 septembre 2011).
C’est l’arrêt fondateur du 14 décembre 1999 de la Cour de cassation, qui a inversé la logique d’hier, résumée par un ancien ministre de l’industrie [Jean-Pierre Chevènement, en 1983] : « Un ministre, ça démissionne, ou ça ferme sa gueule. » Un directeur financier ayant diffusé un document fort critique au comité de direction est licencié pour faute : « Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Chargé d’une mission financière de très haut niveau, M. P. pouvait être amené à formuler, dans le cercle restreint du comité directeur dont il était membre, des critiques, même vives, le document litigieux ne comportant pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs. »
370 000 euros
L’injure ou la diffamation étant des infractions pénales, le débat judiciaire porte sur ce caractère « excessif », mais aussi l’audience éventuelle du message (risque maximum : Twitter). La formulation peut aussi jouer, a fortiori pour un cadre supérieur : « Les termes étant déloyaux et malveillants à l’égard de l’employeur, M. Y. , directeur artistique, avait abusé de sa liberté d’expression » (faute grave, CS, 11 avril 2018).
Il vous reste 31.34% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.