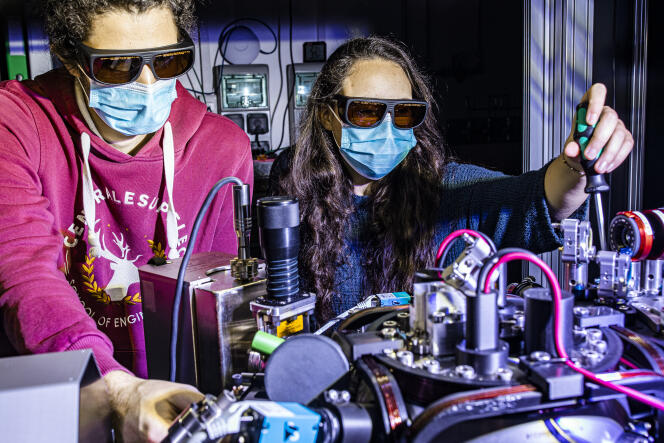Le premier ministre étend aux travailleurs sociaux les revalorisations salariales accordées aux soignants

La crise sanitaire a rendu très concrète, aux yeux de l’opinion, la difficile condition des personnels soignants et provoqué la grande consultation baptisée « Ségur de la santé ». Elle a abouti à plusieurs décisions, notamment à une revalorisation salariale d’au moins 180 euros net par mois pour les personnels soignants non médecins des secteurs public et non lucratif.
Le rôle – tout aussi essentiel – des travailleurs sociaux, qui, eux, prennent soin des personnes les plus vulnérables, handicapées, dépendantes, et assurent la protection de l’enfance, n’a pas joui de cette reconnaissance et la profession souffre, comme celle de soignant, d’une désaffection inquiétante : 15 % à 30 % des postes sont vacants, 70 % des employeurs rencontrent des difficultés de recrutement, enregistrent des démissions et déplorent un important turnover.
C’est ce dont semble avoir pris conscience l’exécutif à son plus haut niveau puisque le premier ministre, Jean Castex, accompagné d’une dizaine de membres du gouvernement (à commencer par Olivier Véran, le ministre de la santé et des solidarités, tutelle des professionnels du social), doit présider, vendredi 18 février, une Conférence des métiers de l’accompagnement social et médicosocial. A cette occasion, il devrait annoncer une revalorisation immédiate des salaires, à hauteur de celle accordée, en décembre 2020, aux soignants, soit 183 euros net mensuel.
Une longue et difficile négociation
Selon Matignon, ces augmentations concerneraient 140 000 éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, conseillers en économie sociale et familiale, tous salariés de structures associatives et publiques, et entreraient en vigueur à compter du mois d’avril, mais seraient versées en juin. Il en coûtera 540 millions d’euros en 2022, puis 720 millions d’euros en année pleine, une dépense prise en charge aux deux tiers par l’Etat et au tiers par les départements, employeurs de ces professionnels.
Au passage, M. Castex envisagerait de combler quelques failles du « Ségur de la santé », en particulier la rémunération des 20 000 aides à domicile employées par les centres d’action sociale, des salariés des centres de protection maternelle et infantile, mais aussi les 3 000 médecins coordonnateurs en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, soit une dépense globale supplémentaire de 140 millions d’euros en année pleine, partagée entre Etat (55 %) et départements (45 %).
Ces mesures sont le fruit d’une longue et difficile négociation entre l’Etat et les départements, représentés par leur assemblée, que dirige François Sauvadet, président (UDI) du conseil départemental de la Côte-d’Or. Les discussions ont duré jusqu’à l’avant-veille de cette conférence, elle-même repoussée maintes fois mais qui, dans le calendrier électoral serré, peut difficilement attendre encore.
Il vous reste 47.93% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.