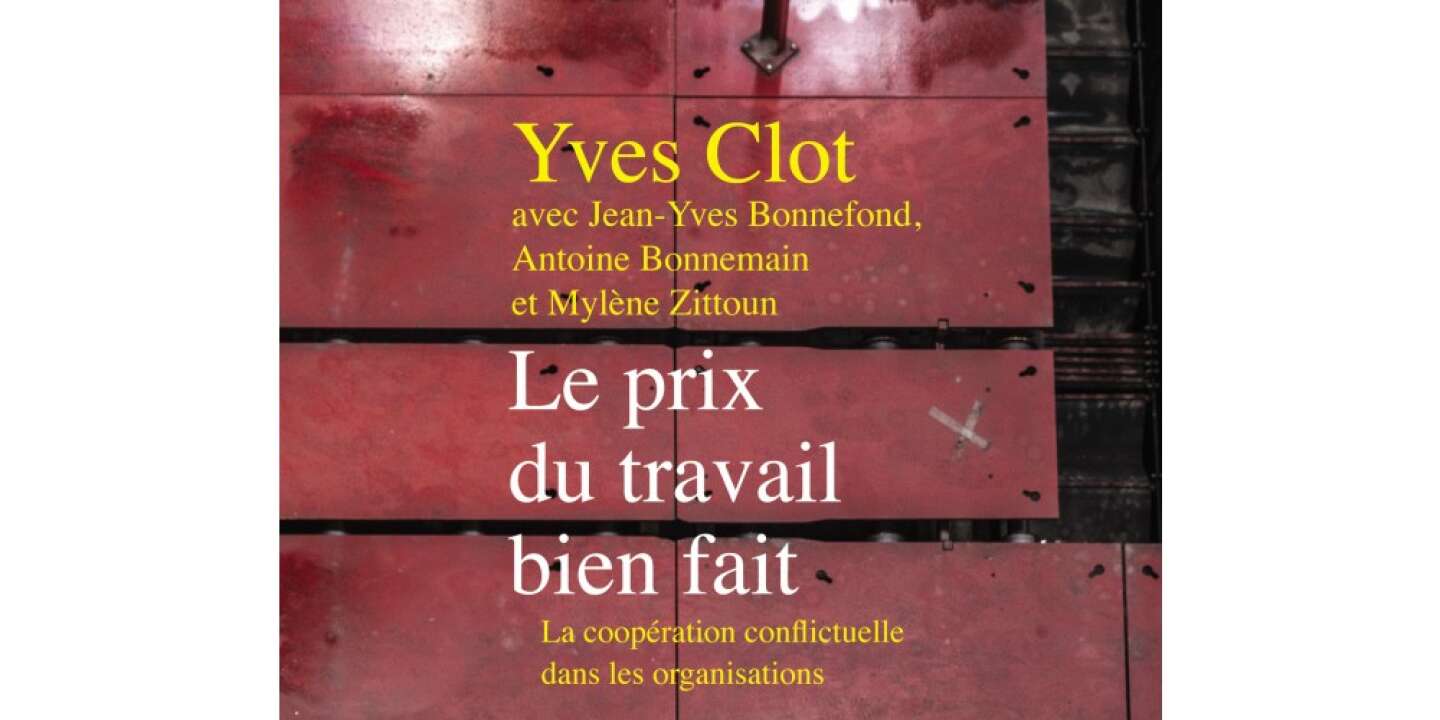Europe de l’Est, Turquie, Maghreb… La production française de voitures s’exile de plus en plus

Avis de gros temps sur les sites automobiles… A Renault Flins (Yvelines), qui n’assemblera plus de véhicules d’ici à la fin de vie de la Renault Zoe ; à Onet-le-Château (Aveyron), où l’usine Bosch aura perdu 1 300 emplois en moins de cinq ans ; à l’usine Stellantis de Rennes, qui, contrairement à la tradition, ne produira pas les nouvelles grandes DS9 et Citroën C5X ; à Caudan (Morbihan), où Renault vend la Fonderie de Bretagne.
D’autres fonderies, Alvance dans la Vienne et l’Indre, MBF Aluminium dans le Jura, sont en difficulté. Celle de Villers-la-Montagne (Meurthe-et-Moselle) vient d’être liquidée. Tandis que chez BorgWarner, à Eyrein (Corrèze), des ouvriers hongrois se forment sur les lignes d’assemblage de pièces pour boîtes de vitesse qui seront déménagées en Hongrie. Les 360 salariés du site français sont licenciés. Des cas parmi d’autres…
A l’heure du Covid-19 et de ses bouleversements économiques, c’est comme si une tornade s’abattait sur l’industrie automobile française et ses emplois. L’Union des industries métallurgiques et minières (UIMM), la branche du Medef englobant l’automobile, le dit elle-même dans une étude publiée mercredi 21 avril, où elle évoque une « dégradation considérable de la situation » depuis 2008.
« Le phénomène n’a rien de nouveau »
Les dirigeants du secteur craignent, si la dynamique négative demeure, de voir disparaître, d’ici à 2035, plus de 50 % des emplois industriels automobiles ; seuls 90 000 actifs demeureraient dans le secteur, contre un peu moins de 200 000 aujourd’hui. « Ce scénario ferait sortir la France des grandes nations de la construction automobile, y compris au seul niveau européen », assènent les auteurs.
Le Monde a cherché à dresser un tableau détaillé de cette crise. Nous avons compilé des données de la société d’études internationales IHS Markit, du Comité des constructeurs français d’automobiles et des industriels pour établir un historique de la production française de voitures. Sur l’évolution de l’emploi, outre des chiffres extraits de l’étude de l’UIMM, nous avons fait appel aux ressources du cabinet Trendeo, spécialiste de la veille en matière d’évolution de l’emploi dans l’industrie.
Les données révèlent un problème majeur. Les voitures vendues en France sont de moins en moins fabriquées dans l’Hexagone : une sur cinq aujourd’hui, contre une sur deux au début des années 2000. « Le phénomène n’a rien de nouveau, fait remarquer Denis Schemoul, directeur associé chez IHS Markit. Le gros de cette migration s’est produit au début des années 2000, avec une première vague importante de localisations en Espagne. Puis, il y a eu une période de stabilisation, avec même une hausse des volumes dans certaines usines françaises, entre 2016 et 2018. A partir de 2019, on retrouve cette tendance baissière et des destinations de production plus lointaines : Europe de l’Est, Turquie, Maghreb. »
Il vous reste 63.15% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.