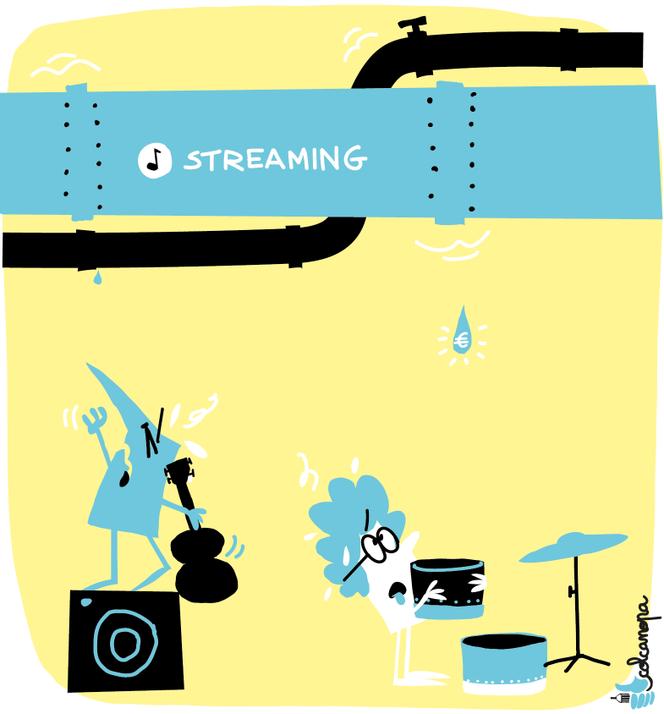« Ni le fric, ni le temps, ni la reconnaissance », les sages-femmes dénoncent des conditions de travail « infernales »

Elles se battent depuis des années, avec le sentiment de ne pas être entendues. La crise sanitaire et le sentiment d’être laissées pour compte pendant le Ségur de la santé ont servi de détonateur à la colère des sages-femmes. Des centaines d’entre elles (ce sont majoritairement des femmes) ont fait grève mardi 26 janvier, partout en France, à l’initiative de l’Organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF), de l’Union nationale et syndicale des sages-femmes (UNSSF) – les deux syndicats professionnels –, et de la Confédération générale du travail.
Devant les maternités et les agences régionales de santé, qu’elles travaillent dans l’hôpital public, dans le privé, ou en tant que libérales, elles se sont mobilisées pour que leur profession soit mieux reconnue et rémunérée.
« Sages-femmes : méconnues, méprisées, oubliées », « Métier formidable, statut fort minable ! », et « Cigogne, mais pas pigeonne », pouvait-on lire sur les banderoles et pancartes de la centaine de sages-femmes qui protestaient mardi à quelques pas du ministère de la santé à Paris. Bonnets et capuches sur la tête pour se protéger du froid glacial, les maïeuticiennes ont rappelé que leurs compétences ne se limitaient pas au suivi de grossesse et que leur mission ne se résume pas à l’accouchement. Depuis 2009, elles font également du suivi gynécologique. Et depuis 2016, elles peuvent pratiquer une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse.
Salaire moyen de 1 750 euros
« Nos compétences se sont élargies, mais on ne nous donne pas les moyens humains et financiers de pouvoir suivre », dénonce Caroline Combot, secrétaire générale de l’ONSSF. D’un côté, le décret de périnatalité n’a pas été mis à jour depuis 1998, ce qui signifie que les effectifs minimum fixés par l’Etat n’ont pas changé depuis vingt-trois ans, pointe la responsable syndicale. De l’autre, les sages-femmes souhaitent depuis plusieurs années la mise en place d’un statut médical qui leur permettrait une hausse de salaire. « Il n’y a qu’un seul endroit où notre caractère médical est reconnu, c’est dans un tribunal, car on peut être poursuivi en justice », s’agace Caroline Combot.
« On a la vie de l’enfant et de la maman entre les mains, mais on est invisibilisé et si peu considéré », se navre Naïs Mottet, qui exerce dans une clinique privée. « Est-ce que c’est parce qu’on est majoritairement des femmes au service des femmes ? », s’interroge-t-elle.
Après cinq ans d’études, le salaire moyen d’une sage-femme est de 1 750 euros nets en début de carrière, une rémunération bien inférieure aux médecins et chirurgiens-dentistes, classés dans la même catégorie au regard du code de santé publique. A l’issue du Ségur de la santé, les sages-femmes ont obtenu une revalorisation de 183 euros par mois, une prime similaire à celle accordée aux professions non médicales. Une provocation supplémentaire qu’elles jugent insupportables.
Epuisement émotionnel et physique
L’épuisement émotionnel et physique se fait sentir. En juin 2020, le Conseil national des sages-femmes dressait un bilan inquiétant dans une enquête : 40 % des cliniciennes salariées, 31 % des cliniciennes libérales et 37,5 % des enseignantes sages-femmes françaises souffrent de burn-out, peut-on lire.
Une fatigue généralisée et des conditions de travail dégradées qui finissent par avoir des conséquences sur l’aspect psychologique d’un métier profondément humain. « Par manque de temps, on passe à côté de dépressions postnatales qui pourraient être dépistées », se désole Sophie Nivault, sage-femme depuis 28 ans dans la région parisienne. « Plus le temps de poser une main sur l’épaule d’une patiente pour la réconforter », « d’avoir un regard ou un mot de compassion », toutes disent que ces petites attentions sont essentielles durant un accouchement.
La réalité d’une garde, c’est souvent trois accouchements à gérer, sans compter les urgences. En novembre 2020, la journaliste Clémentine Sarlat et la sage-femme Anna Roy ont donc lancé une pétition « 1 femme = 1 sage-femme », aujourd’hui signée par près de 70 000 personnes. A travers une vidéo, Anna Roy a aussi témoigné de son désarroi en lançant un mouvement de libération de la parole sur les réseaux sociaux à travers les mots-clés #JeSuisMaltraitante et #NousSommesMaltraitees.
« On n’a ni le fric, ni le temps, ni la reconnaissance, c’est normal que ça explose, dit au Monde Anna Roy, chroniqueuse de l’émission des Maternelles sur France 5 et autrice du podcast Sage-Meuf. C’est le plus beau métier du monde, mais je ne le souhaiterais jamais à ceux que j’aime car on travaille à des cadences infernales. »