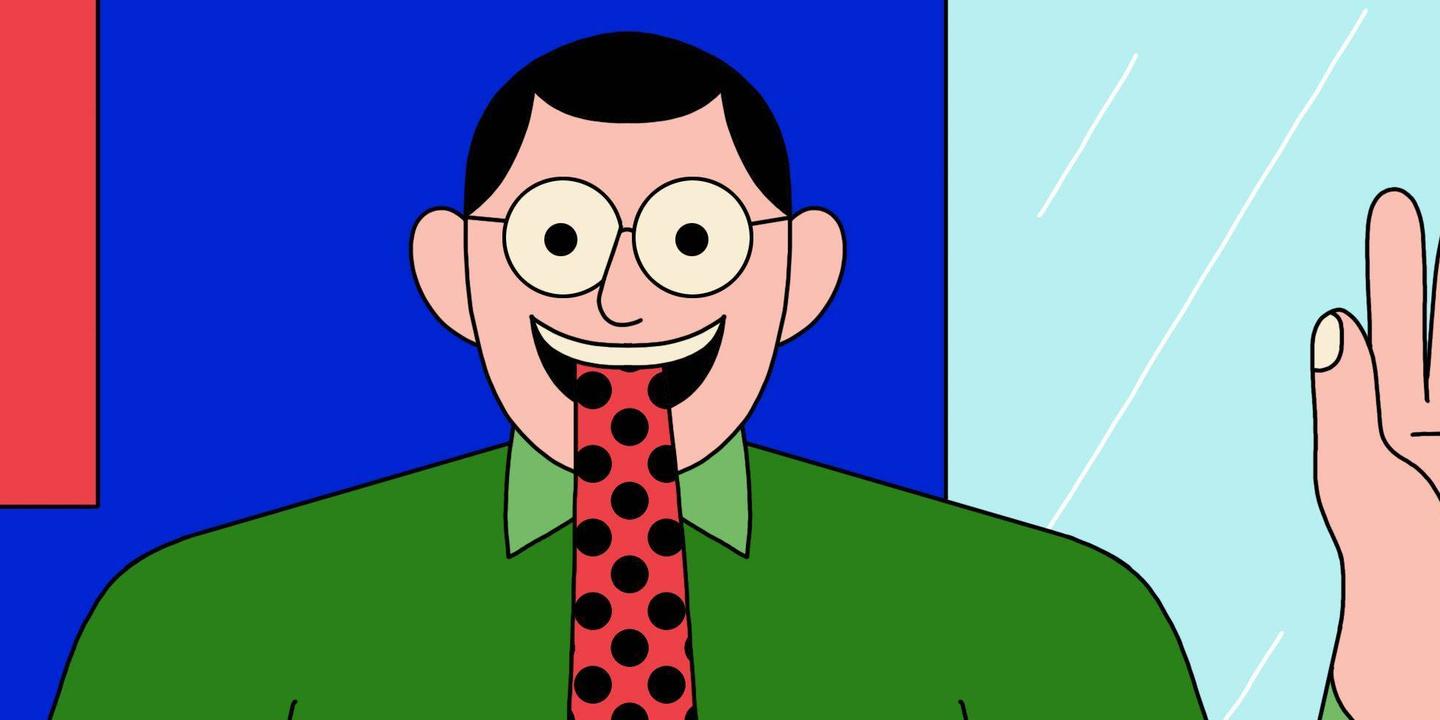« Sage-femme, tout le monde trouve ça formidable, mais personne ne souhaite que sa fille s’inscrive en maïeutique »

Avant de commencer ses gardes à l’hôpital, Natacha Fau avait pris une habitude : se regarder dans le miroir. « Je m’observais, et je me disais que j’étais maltraitante envers moi-même. J’avais le sentiment d’entrer en zone de guerre. » Pendant les douze heures de garde, la major de promo de l’école de sages-femmes d’Angers ne pouvait ni aller aux toilettes, ni manger. Chaque minute devait être rentabilisée.
« A l’école, on avait rebaptisé notre promo “Koh-Lanta” : seul le dernier survivant sera diplômé. La maltraitance fait partie des études en maïeutique. Nous vivons dans la crainte des “sages-femmes dragons”, des professionnelles qui sont censées nous encadrer et qui nous poussent à bout. Je suis attristée, et choquée par le nombre d’amies sous antidépresseurs, par le taux d’étudiantes qui vont voir des psychologues. Moi-même, j’ai terminé en burn-out », déroule la jeune de 27 ans, désormais en reconversion dans le monde de la petite enfance.
« Nous sommes les petites mains dociles et soumises de l’ensemble de la structure obstétricale. On nous infantilise. Dès l’école, on doit pointer une feuille de présence et on nous empêche de partir en cas d’absence du professeur. En salle de naissance, nous devons nettoyer le sang par terre et supporter des remarques quand il reste des traces de liquide amniotique », abonde Dominique, une ancienne étudiante en maïeutique qui souhaite rester anonyme.
Depuis le début de l’année, les sages-femmes multiplient les grèves et les manifestations. De nouveau, les sages-femmes se mobilisent samedi 27 et dimanche 28 novembre. Mille trois cents jeunes professionnels étaient présents à la dernière manifestation, en octobre à Paris, soit un quart des étudiants. Un mouvement inédit, selon Chantal Seguin, directrice de l’école de sages-femmes de Grenoble : « Les jeunes passent une sélection drastique pour accéder à l’école, endurent des années difficiles sur le plan théorique comme clinique, tous ces sacrifices pour se retrouver à multiplier les CDD à la sortie de l’école, avec un salaire de 1 700 euros net par mois à bac + 5. »
Stress et symptômes dépressifs
Selon la dernière enquête « Bien-être étudiant » de l’Association nationale des étudiants sages-femmes (Anesf), sept étudiants en maïeutique sur dix présentent des symptômes dépressifs, et huit sur dix souffrent d’un stress accru depuis leur entrée dans la formation. 27 % ont déjà pensé à arrêter leurs études ou à se réorienter. « L’étude date de 2018, mais on est en train de la mettre à jour car les chiffres augmentent sensiblement », précise Laura Faucher, présidente de l’Anesf, en cinquième année de maïeutique à Clermont-Ferrand.
Il vous reste 68.34% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.