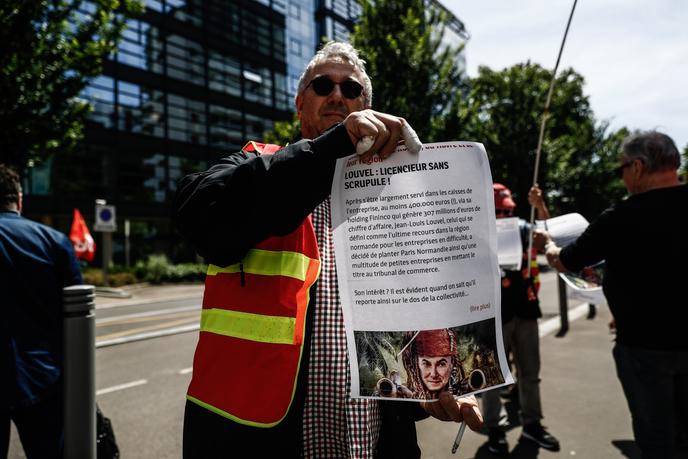Salariés polonais : le constructeur automobile PSA fait en partie marche arrière

Mardi 16 juin, il est peu probable que les 150 salariés polonais de PSA viendront travailler sur le site PSA d’Hordain (Nord), près de Valenciennes, comme la direction du constructeur automobile l’avait annoncé jeudi 11 juin, lors de son comité social et économique (CSE). PSA a fait en partie marche arrière après la fronde syndicale et politique suscitée par cette annonce et a prévu de réembaucher des intérimaires locaux.
Au total, 531 ouvriers polonais de l’usine de Gliwice étaient attendus dans le Nord d’ici la fin juin pour une mission de trois mois et assurer les commandes en cours, soit près de 30 000 véhicules utilitaires. Selon le principe de « solidarité industrielle », des salariés volontaires du site PSA (ex-Opel) de Gliwice, qui fait face à un faible niveau d’activité, devaient venir prêter main-forte à leurs collègues de l’usine d’Hordain qui bénéficient d’une forte activité, liée au dynamisme commercial des véhicules qu’ils produisent.
C’est déjà le cas à Metz, site qui fabrique des boîtes de vitesse, où « 50 Polonais de Gliwice ont commencé à travailler lundi », ainsi qu’« une quinzaine d’employés de Douvrin » (Pas-de-Calais) a indiqué à l’Agence France-Presse une porte-parole du site. Ces salariés sont payés selon les conventions collectives françaises le temps de ce renfort, a-t-elle précisé.
Pour le site d’Hordain, les salariés polonais devaient être logés par PSA sur Lille et Valenciennes, dans des appartements-hôtels, campings et gîtes. Mais dans la soirée de vendredi, les ministres du travail, Muriel Pénicaud, et de l’économie, Bruno Le Maire, ont demandé au groupe automobile de renoncer à son projet, et de privilégier l’embauche d’intérimaires locaux.
« Transformer les salariés en nomades »
Samedi matin, selon nos informations, M. Le Maire et le PDG du constructeur, Carlos Tavares, se sont téléphoné et entendu sur une solution intermédiaire. Le site PSA d’Hordain, qui a repris ses activités le 11 mai, a besoin de 531 personnes pour renforcer ses deux équipes de jour et relancer l’équipe de nuit. Le groupe avait fait appel à ses salariés polonais plutôt que d’avoir recours aux 500 intérimaires nordistes qui composent habituellement cette troisième équipe.
Des salariés de PSA sont toujours en chômage partiel. « Jusqu’ici, quand il y a eu des montées de production, on a toujours eu recours à des intérimaires ou des CDD, souligne Franck Théry, délégué CGT à Hordain. Mais le projet global de PSA, c’est la mobilité internationale pour transformer ses salariés en nomades. » Pas question pour lui de pointer du doigt les Polonais : « Ce ne sont pas des ennemis, pour eux c’est du volontariat forcé. »
« Certains intérimaires ont la haine. Comme ils sont toujours sous contrat, on les pousse à la démission », dénonce la CGT
Reste que les intérimaires sont dans l’expectative depuis quarante-huit heures. Chez Manpower près d’Hordain, par exemple, on dépeint une situation catastrophique. Sur les 500 intérimaires du site, 230 sont toujours sous contrat avec PSA, la plupart jusqu’à fin juillet. « Certains sont passés du chômage partiel payé 84 % à 50 %, dénonce la CGT. Certains intérimaires ont la haine. Comme ils sont toujours sous contrat, on les pousse à la démission. » Vanessa, intérimaire pendant deux ans chez PSA Hordain, explique : « J’ai été mise en fin de contrat en mars et j’attendais la reprise avec impatience. Quand j’ai découvert qu’on devait ramener nos toiles bleues et que des Polonais prenaient nos places, j’étais écœurée. »
« Esclavage des temps modernes »
A la suite de la fronde des salariés français, PSA a donc revu sa copie, sans toutefois renoncer complètement au principe de solidarité industrielle. En effet, une équipe constituée majoritairement d’intérimaires français toujours sous contrat, en substitution d’une partie importante des salariés de Gliwice, se dessine. Le constructeur devrait également faire appel à une partie des 270 intérimaires aujourd’hui sans contrat et à quelques salariés polonais volontaires.
« Cette équipe supplémentaire dépendra du maintien de la demande des clients dans un contexte économique incertain et de la poursuite des aides gouvernementales en soutien du marché automobile très fortement ébranlé par les conséquences du Covid-19 et les nouvelles réglementations en matière d’émissions. L’extrême gravité de ce qui frappe l’industrie automobile ne peut être ignorée », explique-t-on chez PSA. Lundi 15 juin, un CSE doit être organisé sur le site d’Hordain afin de détailler la composition de la troisième équipe.
« Je suis heureux de voir que l’on a obtenu que Muriel Pénicaud intervienne auprès du groupe PSA, déclarait samedi midi le député (PCF, Nord) Fabien Roussel. On ne peut pas accepter que des salariés français, polonais ou espagnols aillent travailler à 500 km de chez eux pendant plusieurs mois, au nom du Covid-19 et sous couvert qu’ils sont en CDI dans le même groupe. » L’élu a estimé qu’il s’agissait « d’esclavage des temps modernes ». Le secrétaire national du PCF a lancé : « Je vais demander à Muriel Pénicaud d’aller travailler six mois en Pologne ! Ce n’est pas la société que je souhaite pour mes enfants. »
Fusion PSA-FCA : Bruxelles inquiète d’un risque de position dominante dans les utilitaires
La Commission européenne est préoccupée par la part de marché élevée qu’aurait le groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler (FCA) dans les petits véhicules utilitaires (camionnettes), et elle pourrait demander aux deux groupes automobiles des concessions pour autoriser leur mariage, avance l’agence Reuters lundi 8 juin, citant des sources proches du dossier. PSA et Fiat Chrysler ont été informés de ces inquiétudes des services européens de la concurrence la semaine dernière, précise l’agence. L’exécutif européen, qui entend terminer cet examen préliminaire au plus tard le 17 juin, a refusé de s’exprimer sur le sujet, tout comme FCA et PSA.