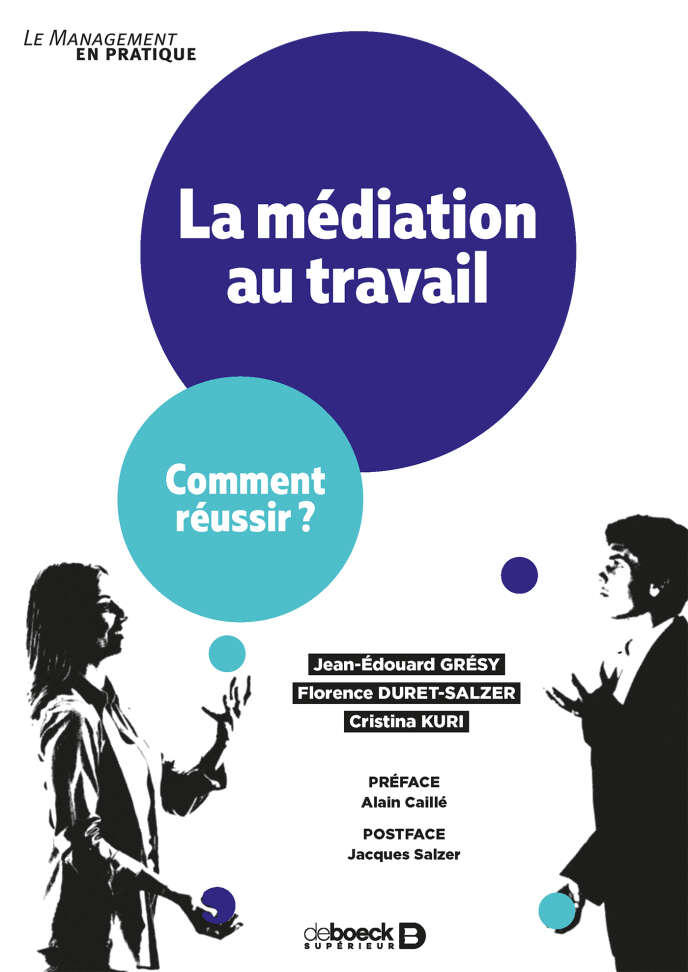Le distributeur de presse Presstalis au bord du dépôt de bilan

L’heure est grave pour les journaux français. Presstalis, qui distribue sur tout le territoire 75 % de la presse, est en grande difficulté. Malgré plusieurs plans de sauvetages, l’entreprise, détenue à 73 % par les magazines et à 27 % par les quotidiens, continue de subir de plein fouet la baisse des ventes au numéro des journaux. Lestées d’une dette comprise entre 500 et 600 millions d’euros, en déficit chronique, et en proie à la concurrence féroce de son concurrent, les Messageries lyonnaises de presse (MLP), les ex-Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP) seront confrontées, fin mars, à des échéances financières qu’elles ne peuvent honorer.
Nommé à la mi-février, son nouveau président, Cédric Dugardin, est chargé d’élaborer un énième plan de redressement, sous la surveillance du comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), autrement dit de l’Etat. Selon nos informations, M. Dugardin a déjà acté que le dépôt de bilan était inévitable, et a construit un plan dont le montant atteindrait 100 millions d’euros, reposant sur cette douloureuse étape. Elle est loin d’être neutre, même si ce type d’opération permet d’apurer une partie du passif. Une fois déclaré en faillite, Presstalis laissera une importante ardoise auprès des éditeurs, en particulier des magazines. Ces derniers vont perdre entre 120 et 140 millions d’euros, selon les estimations. Ces sommes sont liées aux dernières semaines de ventes en kiosque, dont le produit est reversé aux journaux avec un certain délai. Certains petits éditeurs indépendants pourraient ainsi ne pas survivre à cette faillite. Autre population mise en difficulté par cette défaillance, les kiosquiers et autres maisons de la presse, censés recevoir 17 millions d’euros en mars de la part de l’entreprise.
Deux nouvelles sociétés
Point le plus sensible du plan, la lourde restructuration à venir cristallise les inquiétudes. Plus de la moitié des 900 postes de Presstalis pourrait être supprimés. Les effectifs du centre de distribution situé à Bobigny et du siège pourraient être divisés par deux. Les dépositaires, qui distribuent les titres en région et perdent entre 20 et 30 millions d’euros chaque année, seraient fermés ou vendus.
Une saignée sans précédent pour l’entreprise. « On ne restera pas à l’extérieur du débat. L’organisation syndicale est contre le démantèlement », prévient Laurent Joseph, de la CGT-SGLCE. Par le passé, le syndicat a montré qu’il était capable de perturber pendant plusieurs semaines la distribution de la presse pour se faire entendre. Il a rappelé ces derniers jours sa capacité d’action en bloquant un centre de distribution du Parisien.